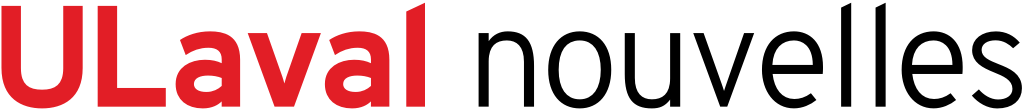— Getty Images/Nikkytok
Parmi les appareils domestiques qui assurent le confort du foyer, le chauffe-eau fait bande à part. Au cours des dernières décennies, les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation ont tous connu des améliorations substantielles qui ont contribué à augmenter l'efficacité énergétique des résidences. Le chauffe-eau, lui, est resté essentiellement inchangé. Le résultat est que la part du chauffe-eau dans la consommation totale d'énergie des résidences, qui est de 17% en moyenne au Canada, peut atteindre 38% dans les maisons récentes très efficaces sur le plan énergétique.
Louis-Gabriel Maltais et Louis Gosselin, du Département de génie mécanique de l'Université Laval, croient qu'il y a moyen de faire mieux en misant sur un meilleur contrôle de l'appareil. «Sur le plan de la conception, le chauffe-eau est très efficace et il y a peu d'économies d'énergie à espérer de ce côté. Par contre, même un chauffe-eau très bien isolé finit par perdre une partie de la chaleur de son eau. Pour un chauffe-eau de 60 gallons, ces pertes sont estimées à 780 kilowatts/heure par année. Si on assurait un meilleur arrimage entre les périodes où l'eau chaude est produite et celles où elle est consommée, on pourrait réduire ces pertes», explique Louis-Gabriel Maltais, qui a étudié la question dans le cadre de son doctorat.
L'idée semble simple, mais en pratique, prévoir les besoins en eau chaude des occupants d'une résidence n'est pas une mince tâche. Pour y arriver, les chercheurs ont eu recours à des données réelles provenant de 40 unités de logement situées dans la Cité verte à Québec. «Nous avons utilisé des relevés de consommation d'eau chaude faits toutes les 10 minutes pendant plusieurs mois pour développer, par apprentissage machine, un algorithme qui prédit la consommation future en eau chaude à partir de la consommation antérieure des occupants», résume Louis-Gabriel Maltais.
Les chercheurs ont ensuite évalué l'efficacité d'un système de contrôle reposant sur ce modèle prédictif. «Les décisions de ce contrôleur doivent respecter plusieurs contraintes, poursuit Louis-Gabriel Maltais, notamment celles imposées par les caractéristiques du chauffe-eau parce qu'elles influencent la vitesse à laquelle l'eau chaude peut être produite. Les décisions du contrôleur doivent également tenir compte de la règle canadienne qui exige que la température de l'eau soit toujours maintenue au-dessus de 60 degrés Celsius pour prévenir le développement de la bactérie du légionnaire.»
Les résultats des simulations effectuées par les chercheurs, qui sont rapportés dans la revue Energy Conversion and Management: X, montrent qu'une meilleure adéquation entre la production et la consommation d'eau chaude à l'aide d'un modèle de contrôle prédictif pourrait engendrer une réduction de 4% à 8% de l'énergie consommée par un chauffe-eau.
— Louis-Gabriel Maltais
«Pour un ménage, ça peut sembler peu, reconnaît Louis-Gabriel Maltais. Par contre, si on extrapole à l'ensemble du Québec, on parle d'économies énergétiques substantielles. Dans le contexte où nous cherchons collectivement des façons de réduire notre consommation d'électricité, c'est une avenue qui vaut la peine d'être explorée.»