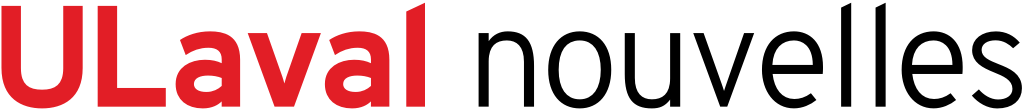12 mai 2022
L’innovation sociétale: comment penser la recherche autrement
Les modèles de la recherche universitaire favorisent les innovations dont les bénéfices sont immédiats et chiffrables. Que faire pour mieux soutenir et valoriser les innovations qui apportent des solutions à long terme à un problème social?

L’innovation technologique et son transfert de l’université à l’entreprise sont généralement bien balisés: partenariat, financement, brevet… Par contre, beaucoup de flou persiste autour de l’innovation sociétale.
La définition même de ce type d’innovation est large et fluctuante. À preuve l’activité «L’innovation sociétale: penser nos modèles autrement» présentée dans le cadre du Congrès de l’Acfas, qui s’est tenue à La Centrale – Espace entrepreneurial le mercredi 11 mai, s’est ouverte sur cette question au public: «Qu’est-ce que l’innovation sociétale?» Les réponses, données sous formes de mots-clés, ont tourné autour de thèmes comme qualité de vie, diversité, équité, changement, bien commun, ancrage dans un milieu, caractère durable, collaboration… Des termes positifs et rassembleurs, mais qui restent très généraux.
Le hic, en effet, c’est que l’innovation sociétale est aussi diverse que les défis sociaux auxquels elle répond. On la décrit généralement comme un processus qui vise à changer les pratiques habituellement employées pour faire face à un problème social dans un milieu précis. Souvent de gouvernance participative, elle réunit à la fois des chercheurs de divers domaines ainsi que des acteurs et des bénéficiaires du milieu dans lequel elle doit être implantée afin de maximiser son incidence sociale. «Chaque projet d’innovation sociétale est unique. C’est parfois un saut dans le vide», indique Stéphane Grenier, professeur en travail social à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).
Ce professeur a été invité à discuter avec Dahlia Jiwan, cofondatrice d’Élance, et Lyne Gosselin, conseillère en valorisation de la recherche à l’Université Laval, des enjeux de l’innovation sociétale. Les trois intervenants de la table ronde étaient tous d’accord pour dire qu’il faut revoir la valeur accordée à ce type d’innovation, puisque sa principale valeur n’est jamais économique, même si l’innovation permet parfois de faire des économies.
Étant donné que les retombées sont de nature culturelle, identitaire, sociale, environnementale ou humaine, celles-ci sont habituellement difficiles à mesurer, surtout que certaines ne se révéleront pleinement qu’après plusieurs années. D'après Lyne Gosselin, l’une des solutions pourrait résider dans une meilleure communication de la portée sociale de ces innovations. «Réunir plusieurs projets pour parler d’une même voix et communiquer de manière globales toutes les retombées de ces innovations auraient plus de poids. Pour ce faire, on pourrait créer des forums», explique-t-elle. Selon Stéphane Grenier, les universités et les organismes subventionnaires pourraient faire un pas en reconnaissant une valeur à la création d’innovations sociétales dans le curriculum vitae des professeurs. «Pour l’instant, dit-il, seul compte le nombre de publications. On ne tient pas compte des contributions à une innovation sociétale dans les accomplissements d’un professeur. C’est considéré comme un engagement social, du bénévolat extérieur aux activités de recherche.»
L’un des autres éléments sur lesquels les trois intervenant s'accordaient est que la grande force de ces solutions est de réunir des expertises variées. «L’innovation sociétale fait habituellement appel aux savoirs et aux talents de gens de divers domaines et cette diversité est essentielle pour parer aux angles morts et assurer le succès des solutions proposées. Il est important aussi de reconnaître que l’expertise vécue est une forme d’expertise valable», a déclaré Dahlia Jiwan.
Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, a d’ailleurs donné le ton à cette table ronde en parlant, lui aussi, dès le discours qu’il a prononcé au début de la rencontre, de l’importance d’impliquer des experts de tous les domaines dans la recherche de solutions. «Par exemple, a-t-il raconté, au début de la pandémie, je me suis trouvé à discuter d’un nouveau virus que personne ne connaissait avec des médecins et des scientifiques. Ces expertises étaient celles qu’il fallait mettre à profit au début. Mais au fil du temps, les expertises sont relativement restées les mêmes autour de la table, alors que, progressivement, il aurait fallu faire davantage appel à des spécialistes en sciences humaines et sociales.»
Soucieux de mieux adapter les programmes pour soutenir l’innovation sociétale, Rémi Quirion a d’ailleurs profité de cette activité pour révéler que dans la nouvelle Stratégie québécoise sur la recherche et l’innovation, qui sera présentée au public très prochainement, il y aura un chapitre sur l’innovation sociétale. Il a également rappelé l’existence du programme Engagement, qui encourage les citoyennes et citoyens à proposer une idée de recherche et à la réaliser en étroite collaboration avec une chercheuse ou un chercheur.
Les échanges ont été animés par Jessica Veillet, gestionnaire de projets d’innovation – Société et culture chez Axelys.
Des exemples d’innovation sociétale
L’événement a aussi permis de faire connaître quatre innovations sociétales et leurs répercussions positives sur leur milieu.
La première est l’œuvre de Dahlia Jiwan. Son entreprise Élance propose des solutions numériques pour accompagner des entreprises dans le développement de la diversité, de l’équité et de l’inclusion et créer des espaces inclusifs en milieu de travail.
La seconde a été créée par Alex Cheezo, étudiant à la maîtrise en travail social à l’UQAT. Membre de la Nation anishnabe de Lac Simon, ce travailleur social propose un processus de guérison par la reconnaissance et la valorisation de la culture anishnabe.
Mise au point par Marie Vézina et Véronique Nault, la troisième innovation sociétale, Mots d’enfants, est un programme de stimulation du langage destiné aux tout-petits de 18 mois à 5 ans. Au départ conçu pour les enfants épaulés par les services de protection de la jeunesse, ce programme est aujourd’hui utilisé dans les CLSC, et éventuellement dans les CPE et autres milieux de garde.
Finalement, le jeu sérieux Cogni-Actif, réalisé par Laurie Simard, vise à contrer l’inactivité physique chez les enfants et à restreindre les symptômes du TDAH par l’activité physique. Cette innovation sociétale propose aux enfants d’apprendre en bougeant.