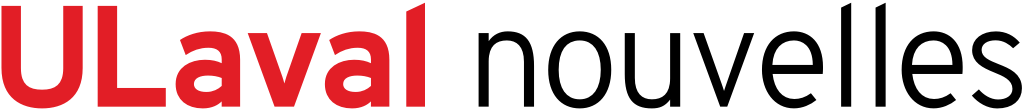12 mai 2021
Catastrophe de Fort McMurray: les hommes moins enclins à demander de l'aide psychologique
Le recours à des services d'aide psychologique a été presque deux fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes dans l'année qui a suivi l'évacuation de cette ville

— DarrenRD
Les feux de forêt qui ont dévasté le nord de l'Alberta il y a cinq ans, forçant l'évacuation des 88 000 résidents de Fort McMurray, ont-ils été plus éprouvants pour les femmes que pour les hommes? Ou la propension masculine à refouler leurs problèmes émotifs a-t-elle sévi une fois de plus? Quoi qu'il en soit, le résultat est le même: la demande pour les consultations psychologiques chez les personnes évacuées de Fort McMurray a été 1,9 fois plus forte chez les femmes que chez les hommes dans l'année qui a suivi ce drame.
C'est l'un des constats rapportés dans des études publiées récemment au sujet des répercussions psychologiques de ces feux chez les personnes évacuées. Ces travaux, dirigés par la professeure Geneviève Belleville, de l'École de psychologie de l'Université Laval, reposent sur des informations recueillies lors d'entrevues téléphoniques menées entre mai et juillet 2017 auprès de 1510 personnes qui ont dû quitter Fort McMurray en catastrophe au début de mai 2016.
Dans un article publié par Frontiers in Public Health, les chercheurs rapportent qu'un an après l'évacuation, 38% des répondants affichaient encore des symptômes typiques de certains troubles psychologiques. Leur condition suggérait la présence probable d'insomnie (29%), de stress post-traumatique (15%), de dépression (15%), d'anxiété généralisée (14%) ou d'un trouble lié à la consommation d'alcool ou de drogue (8%). Un répondant sur cinq éprouvait des symptômes suggérant la présence d'au moins deux de ces problèmes psychologiques.
L'autre étude, publiée dans la revue Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, montre que, dans l'année qui a suivi l'évacuation, 17% des répondants ont reçu de l'aide psychologique et 12% ont pris des médicaments pour des troubles liés aux émotions, à la santé psychologique ou à la consommation d'alcool ou de drogues. Parmi les répondants qui avaient au moins un diagnostic probable de problème psychologique, à peine le tiers a reçu de l'aide psychologique ou de la médication.
«C'est comparable à ce qui a été rapporté après l'ouragan Katrina ou après les attentats du 11 septembre 2001, constate la doctorante en psychologie et première auteure de l'étude, Émilie Binet. Il existe des traitements efficaces qui pourraient aider les personnes affectées par de telles catastrophes, mais seulement une minorité y fait appel, malgré un besoin évident.»
— Émilie Binet
Dans l'année qui a suivi les incendies, la probabilité d'avoir pris des médicaments ou d'avoir reçu de l'aide psychologique était respectivement 1,6 et 1,9 fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes parmi la population évacuée. «C'est cohérent avec la littérature scientifique relative à la santé psychologique en général, commente Émilie Binet. Les femmes reconnaissent plus facilement les signes de détresse émotionnelle ou les symptômes de problèmes psychologiques. De plus, elles ont une attitude plus positive et plus ouverte par rapport aux services de santé psychologique.»
La raison la plus souvent invoquée pour ne pas demander d'aide psychologique ou pour ne pas prendre de médicaments est la même tant chez les hommes que chez les femmes. Elle peut être résumée ainsi: je préfère gérer ça par mes propres moyens. «Si on souhaite aider davantage de personnes après des traumatismes de la sorte, il faut développer des interventions qui respectent le désir d'autonomie, en offrant, par exemple, des traitements en ligne», estime Geneviève Belleville.
— Geneviève Belleville
La professeure et son équipe sont passées de la parole aux actes en développant RESILIENT, une plateforme de traitement en ligne destinée aux personnes qui ont vécu un événement traumatique. «Nous l'avons testée auprès d'un groupe d'évacués de Fort McMurray et les résultats sont très encourageants. Nous travaillons maintenant à l'optimiser et nous allons en évaluer l'efficacité auprès des victimes d'agressions sexuelles. On pourrait aussi l'utiliser pour aider les hommes ou les personnes marginalisées ou racisées, des groupes habituellement moins enclins à faire appel aux services d'aide psychologique.»
L'équipe qui signe ces deux articles regroupe Émilie Binet, Marie-Christine Ouellette, Jessica Lebel, Charles Morin et Geneviève Belleville, de l'Université Laval, Jessica Békés (Yeshiva University), Nicolas Bergeron et Stéphane Guay (U. de Montréal), Tavis Campbell (U. de Calgary), Sunita Kosh et Frank MacMaster (Alberta Health Services) et Stéphane Bouchard (UQO).