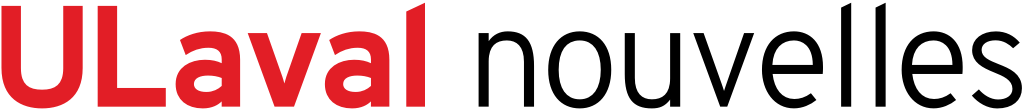— Cephas
Une étude menée par des chercheurs de l'Université Laval conclut que les oies des neiges ne sont pas porteuses du virus responsable de la COVID-19 et que la chasse et la consommation de ces oiseaux demeurent sécuritaires.
En mai, ces chercheurs ont capturé 500 oies des neiges près de Montmagny, à proximité de Québec, afin de procéder à des prélèvements visant à déterminer la présence du virus responsable de la COVID-19 dans leurs sécrétions buccales et leurs excréments. Les analyses effectuées au Laboratoire des maladies infectieuses et immunitaires du CHU de Québec – Université Laval n'ont révélé aucune trace du virus chez les 500 oiseaux testés.
Les membres de l'équipe de terrain ont été testés pour le virus de la COVID-19 avant, pendant et après l'échantillonnage et ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher la contamination des oiseaux, qui ont été relâchés après la prise des prélèvements.
Sécurité alimentaire
C'est pour répondre aux inquiétudes de leurs partenaires autochtones et des habitants des régions côtières du Québec que les chercheurs ont décidé de vérifier la présence ou non du virus SARS-CoV-2 au sein de la population d'oie des neiges de passage au Québec. La sécurité alimentaire des familles autochtones dans le Nord est un enjeu bien réel et il était important de confirmer la sécurité de cette ressource. Signalons que l'équipe de recherche effectuait déjà un suivi démographique et virologique de la population d'oie des neiges et elle était en mesure d'ajouter le SARS-CoV-2 aux virus déjà étudiés.
L'oie des neiges est un gibier très prisé à la fois au Québec et dans le Nord, notamment dans la région Eeyou Istchee, au Nunavik et au Nunavut. Cette espèce contribue de façon importante à la sécurité alimentaire en contexte autochtone, qui est déjà précaire dans plusieurs communautés. Par ailleurs, les aliments traditionnels sont importants pour la santé, la cohésion sociale, l'identité et la continuité culturelle ainsi que la souveraineté alimentaire des communautés autochtones. En plus, les prix des aliments du marché sont beaucoup plus élevés dans les communautés éloignées et nordiques que dans le sud du pays.
Perspectives de recherche collaborative
«La pandémie a transformé nos activités de recherche habituelles et nous a forcés à trouver de nouvelles façons de faire et à mettre sur pause différents projets», explique Pierre Legagneux, professeur au Département de biologie et un des responsables de l'étude. Ce contexte a également permis de sortir des chemins battus et d'investiguer un sujet de façon spontanée, innovatrice et en réponse directe aux demandes de partenaires autochtones. Le projet a su mobiliser des fonds et du personnel dévoué en un temps record, car il fallait tester et analyser les échantillons avant que les oiseaux arrivent dans le Nord. Espérons que cette réussite pourra servir d'inspiration pour nos collaborations futures et pour prioriser davantage les enjeux réels des communautés», ajoute le professeur Legagneux, qui est aussi titulaire de la Chaire de recherche Sentinelle Nord sur l'impact des migrations animales sur les écosystèmes nordiques.
«Pour la suite, nous poursuivons notre collaboration afin de caractériser l'ensemble des virus, incluant d'autres coronavirus, portés par l'oie des neiges», poursuit Catherine Girard, chercheuse postdoctorale au Laboratoire de découverte et d'écologie virale de l'Université Laval et coauteure de l'étude. «La pandémie actuelle nous démontre l'importance de la biosurveillance des réservoirs animaux, et une meilleure connaissance de ces virus nous informera sur de possibles futures épidémies», conclut celle qui joindra cet automne l'Université du Québec à Chicoutimi à titre de professeure de microbiologie.