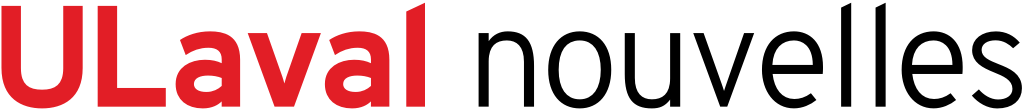Dans le milieu des services correctionnels, les femmes exécutent les mêmes tâches que leurs collègues masculins.
Sophie Brière enseigne au Département de management. Ses principaux champs d'intérêt comme enseignante et comme chercheuse sont la gestion de projets internationaux, le genre et le développement, et l'entrepreneuriat dans les pays en développement. Elle est également titulaire de la Chaire de leadership en enseignement – Femmes et organisations.
Contact est le magazine des diplômés de l'Université. Le 19 septembre, la professeure Brière publiait son premier billet sur cette plateforme. Son blogue, qu'elle compte enrichir régulièrement, a pour titre général Dialogue sur l'égalité au travail. Son premier texte s'intitule «Égalité hommes-femmes: que nous apprennent les organisations?». Le 26 septembre, elle signait un deuxième texte, cette fois sur la place des femmes dans le monde juridique. Son plus récent billet, en ligne depuis le 11 octobre, porte sur les agentes de services correctionnels dans les centres de détention au Québec.
À l'Université, la chercheuse dirige une vaste enquête sur les femmes dans des métiers et professions traditionnellement réservés aux hommes. Son équipe est composée d'une dizaine de professeurs rattachés à diverses facultés. «Nous avons commencé à publier nos résultats, dit-elle, on a du matériel, le timing est bon.»
Selon Sophie Brière, les agentes à l'emploi de centres de détention constituent un incontournable. «On en trouve beaucoup, même dans les prisons pour hommes, souligne-t-elle. Et le taux de rétention en emploi est d'environ 95%. Nous avons voulu savoir ce qui expliquait cette statistique.»
Dans leur enquête, les chercheurs ont interviewé une quarantaine d'agentes et d'agents de services correctionnels ainsi que des membres de la direction des centres de détention. Il est ressorti que, sur le plan de la répartition du travail, les femmes exécutent les mêmes tâches que leurs collègues masculins. Sur le plan des protocoles d'intervention, le personnel recourt maintenant davantage au dialogue qu'à l'usage de la force physique.
«Cette mixité dans les interventions profite à tout le monde, même aux hommes, qui ont plutôt envie de dialoguer pour régler un conflit, écrit Sophie Brière dans son blogue. Cela permet également d'exercer plus facilement un certain travail communautaire auprès des détenus.»
Dans ce milieu, les efforts mis à améliorer le climat de travail se sont traduits notamment par un langage plus convenable, par des réunions de débriefing après des événements difficiles et par des directives claires concernant le harcèlement sexuel. «Au début, raconte la chercheuse, il y avait de la résistance au changement. Des agents rencontrés rappelaient avoir dit que les femmes ne sont pas fortes physiquement, qu'elles ne sont pas formées pour ce type de travail. Ils se demandaient ce qu'elles venaient faire ici. Mais les dirigeants ont cru au changement et ont favorisé l'évolution de l'organisation, notamment en revoyant les protocoles d'intervention.»
En règle générale, il existe encore beaucoup d'inégalités et d'obstacles à la progression et à la rétention des femmes sur le marché du travail, surtout dans les organisations qui ont toujours été majoritairement masculines. Dans ces milieux de travail, les femmes sont sous-représentées dans des postes de décision, ont un revenu inférieur à celui des hommes et se heurtent à des défis relatifs à la parentalité. «Je souhaite, dit-elle, que mes billets se distinguent par la description des différentes interventions et pratiques organisationnelles expérimentées pour pallier ces lacunes.»
Sophie Brière insiste sur la généreuse participation des organisations à ses travaux de recherche. «Leurs dirigeants, poursuit-elle, souhaitent jeter un nouveau regard sur ce qui se fait présentement et faire émerger des pratiques porteuses d'égalité, de diversité et de mixité des talents.»
Au cours des prochains mois, la professeure Brière amènera les lecteurs de son blogue dans une grande diversité de milieux de travail. Elle publiera des billets notamment sur les femmes dentistes, les femmes en coopération internationale et les femmes inspectrices. «Le monde de l'inspection n'est vraiment pas connu, explique-t-elle. On y observe une très forte progression des femmes. Ces inspectrices vont sur les chantiers de construction, dans les abattoirs et sur les fermes.»
Lorsqu'elle était jeune, Sophie Brière voulait parcourir le monde comme journaliste. «Finalement, conclut-elle, je suis une professeure d'université qui parcourt les organisations aux quatre coins du monde afin non seulement de connaître leur réalité, mais aussi de travailler à instaurer une meilleure égalité et une plus grande diversité dans les différents milieux de travail.»
Consultez le blog de Sophie Brière