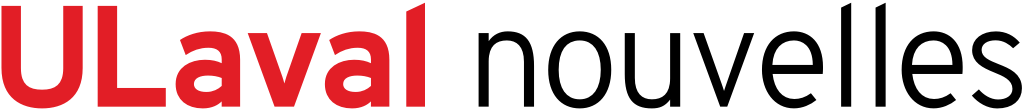Ce montage montre Élizabeth Lecavalier au travail sur la zone A1 sud et Jean-Marc Poulin faisant une pause sur la zone A1 nord. Ce dernier vient de finir une section du mur en terre derrière lui. Il s’accoude à ce qui semble être le début de l’extérieur d’une maison, possiblement un entrepôt.
«J’ai eu la chance de vivre une expérience unique en Israël, une expérience en lien direct avec mes études. Ce fut merveilleux et très positif. C’était prodigieux de rencontrer des gens de différents pays qui s’unissent dans un même but: faire de l’archéologie. Voir le site de Tel Azekah qui regorge de vestiges très anciens, c’était un cadeau qui m’était offert sur un plateau d’argent.»
Jean-Marc Poulin est inscrit au baccalauréat intégré en sciences des religions. Il se dirige vers la maîtrise et prévoit se spécialiser en philologie des textes bibliques. Dans la seconde moitié de juillet, il a participé, comme six autres étudiantes et étudiants de l’Université Laval, à l’École d’été Tel Azekah, une activité mise sur pied par le professeur Jonathan Bourgel, de la Faculté de théologie et de sciences religieuses. Pendant deux semaines, les étudiants ont été intégrés à un groupe international de fouilleurs, constitué d’une quarantaine d’étudiants universitaires et de bénévoles, sur le site biblique de Tel Azekah, un lieu en forme de monticule de 80 mètres de hauteur situé à une trentaine de kilomètres de Jérusalem, en Israël. L’intérêt de l’endroit pour les archéologues réside dans sa très ancienne histoire, laquelle remonte à quelque 3500 ans. Ce qui fut le point de contrôle d’une jonction stratégique de routes fait l’objet depuis 2012 d’un projet de fouilles mené par un consortium international dirigé par quelques universités, dont celles de Tel Aviv, en Israël et de Heidelberg, en Allemagne. Le projet, nommé Lautenschläger Azekah Expedition, en était, cet été, à sa neuvième saison.
Tout comme Jean-Marc Poulin, Elizabeth Lecavalier a fait ses premières armes en archéologie à Tel Azekah. Inscrite à la maîtrise en théologie, cette étudiante se définit comme croyante et pratiquante. Comme lui, elle a visité des lieux touristiques de grande valeur durant les fins de semaine, mais aussi pendant la semaine qui a suivi les fouilles.
«Pour moi, dit-elle, de visiter les lieux derrière les récit bibliques qui sont d’une valeur extraordinaire, d’aller sur place, de ne pas ignorer la géographie et l’histoire de l’endroit et les enjeux qui perdurent, ce fut inestimable comme expérience. Cette expérience me permet de croître dans ma compréhension des textes bibliques que j’étudie, de comprendre les contextes; elle aide vraiment à l’interprétation. Ce voyage, c’était aussi le goût de l’aventure. Plus jeune, comme enfant, je rêvais de faire de l’archéologie.»
Dans sa visite du pays, l’étudiante a vu, entre autres, le Vieux Jaffa à Tel Aviv, la vieille ville de Jérusalem, la ville palestinienne de Jéricho, ainsi que le lac de Tibériade en Galilée. L’étudiant, lui, a entre autres visité la vieille ville de Jérusalem. «C’était de toute beauté de voir les trois religions qui ont déjà très bien coexisté», souligne-t-il.
Du kibboutz au site archéologique
L’ensemble des participants logeaient au kibboutz Nétiv Ha-Lamed Hé, une exploitation agricole collective située à quelques kilomètres du site. Du dimanche après-midi au vendredi matin, leur semaine de travail se déroulait selon un horaire quasi militaire qui commençait par le lever à 4h. Suivait, à 4h45, le départ en bus ou en minibus en direction du site. Les fouilles débutaient à 5h, sous les filets d’ombre, et se poursuivaient jusqu’à midi, avec une pause déjeuner vers 9h30.
«L’idée était d’en faire le plus possible avant qu’il ne fasse trop chaud, indique Elizabeth Lecavalier. Cet été, la température, l’après-midi, dépassait les 35 degrés Celsius et le taux d’humidité était élevé.»
La journée n’était pas terminée pour autant. Une fois rentrés au kibboutz, les fouilleurs dînaient avant de consacrer une heure à laver les fragments de poteries mis au jour le matin même. Le lavage avait pour objectif d’identifier d’éventuels sceaux ou inscriptions anciennes. Les lundis et mercredis, les archéologues amateurs avaient la possibilité d’assister, au kibboutz, à des conférences données par des archéologues et des biblistes réputés. La première présentation offerte a porté sur la divinité vénérée par les Israélites dans le royaume de Juda à l'âge du fer. Les mardis, des visites guidées étaient organisées vers des sites archéologiques à proximité.
Un emplacement stratégique
Emplacement stratégique, Tel Azekah a été occupé dès l’âge du bronze. Au fil des siècles, plusieurs peuples se sont installés là, notamment les Cananéens, les Israélites, les Perses et les Romains. Les fouilles archéologiques ont mis au jour des vestiges de temples, de fortifications et d’habitations. Pas moins de 15 strates d’occupation ont été identifiées.
Deux spécialistes internationaux, les professeurs Oded Lipschits de l’Université de Tel Aviv et Manfred Oeming de l’Université de Heidelberg, dirigeaient les fouilles. Chacune des zones de fouilles était occupée par 6 à 10 personnes. Jean-Marc Poulin et Élizabeth Lecavalier ont été assignés à des carrés de fouilles situés respectivement sur les versants nord et sud.
«Une journée typique de travail sur le site, explique l’étudiante, consistait à faire différentes tâches dans un carré de fouilles, selon le jugement de nos superviseurs, le travail étant entrecoupé de pauses et du «vidage» de nos seaux remplis de terre.»
En alternance ou en équipes de deux, les fouilleurs se servaient de la pioche et de la houe afin de creuser la terre pour descendre dans un carré. L’étape du «sectionnage» se faisait à l’aide d’une truelle et d’une petite pioche pour délimiter nettement le carré et étudier les différentes strates. Le nettoyage des éléments d’architecture trouvés nécessitait une petite pioche et une truelle lorsqu’il y avait beaucoup de terre. Sinon une brosse et un porte-poussière suffisaient pour les détails. Plusieurs seaux servaient à récupérer l’excès de terre des carrés. D’autres tâches communes consistaient, entre autres, en la confection de sacs de sable, la préparation du café et le déplacement des outils au début et à la fin de chaque journée de travail.
«Dans mon secteur, précise-t-elle, nous avons fait plusieurs trouvailles. Les plus fascinantes étaient des morceaux de figurines, comme celle d’une sorte de déesse mère, merveilleusement préservée, ainsi qu’une pièce d’un ancien jeu de société.»
Une expérience surprenante
Être en contact direct avec des objets confectionnés il y a très longtemps s’avère une expérience surprenante, soutient Jean-Marc Poulin. «C’est comme déballer un cadeau, dit-il. Dès la première journée, on découvre de petites pièces, petites mais importantes. Plus on en trouve, plus on a envie de creuser. Et être en contact avec des objets qui ont 3000 ans est assez incroyable. Cela démontre le savoir-faire de l’être humain à travers le temps.»
Pour sa part, Élizabeth Lecavalier parle d’émerveillement. «Même si l’artefact est plus petit que nous, on se sent plus petit que lui, soutient-elle. On se sent minuscule en contemplant l’ampleur de l’histoire qui nous dépasse depuis très longtemps. Et on considère les mains qui ont façonné cet objet-là. On considère la grande créativité que l’on voit. Même réaliser d’où ça vient. Par exemple, sur un autre carré, les fouilleurs ont trouvé un scarabée égyptien. Dans ma zone, on a retrouvé des fragments d’une espèce de vase que les experts, pendant la lecture, ont pu avancer qu’il provenait de Chypre ou de Malte. Oh, wow! Il ne provenait pas de la région, il a été importé. C’est impressionnant de réaliser que chaque objet a une histoire.»
L’École d’été Tel Azekah de l’Université Laval a été mise sur pied par le professeur Jonathan Bourgel, de la Faculté de théologie et de sciences religieuses. Titulaire de la CLE Maurice-Pollack en études juives, celui-ci a préparé les étudiants et les a accompagnés lors des fouilles du site de Tel Azekah. Il les a aussi guidés à Jérusalem lors d'une excursion. Les frais de voyage des étudiants ont été en partie couverts par une subvention de la fondation Maurice-Pollack. Pour plus d’information, écrire à l'adresse telazekah@ulaval.ca.
Voir la vidéo de la saison 1 des fouilles:

Les fouilles débutaient à l’aube et se poursuivaient jusqu’à midi. Une pause déjeuner avait lieu vers 9h30.

Une zone de fouilles du site Tel Azekah avec, au premier plan, deux pioches, une truelle et des seaux.

Moisson d’une semaine de fragments de poteries découverts sur le site de Tel Azekah et exposés pour lecture sur quatre tables placées bout à bout au kibboutz Nétiv Ha-Lamed Hé, après avoir été lavés. L’analyse des morceaux était effectuée par Oded Lipschits de l’Université de Tel Aviv et son assistante Sabine Kleiman. Telle pièce était-elle de l’âge du fer, l’âge du bronze, ou bien provenait-elle de la période hellénistique?

Deux artefacts découverts cet été, sur le site de Tel Azekah. À gauche: fragment d’une lampe à huile de la période byzantine avec une inscription grecque. À droite: figurine de l’âge du bronze tardif.
— Lautenschläger Azekah Expedition