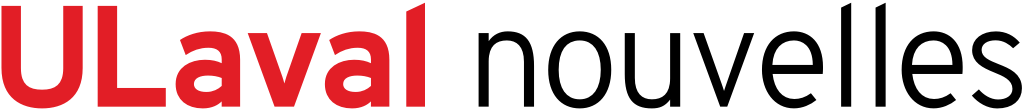Mgr Alphonse-Marie Parent
— Lida Moser
Pour éduquer, il faut d’abord avoir appris. Alphonse-Marie Parent, ce fils de Saint-Jean-Chrysostome, fait ses études classiques à l’École apostolique Notre-Dame, au Séminaire de Québec, de 1917 à 1924, et au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de 1924 et 1925. Se vouant à la prêtrise, il entre ensuite au Grand Séminaire de Québec. L’année 1929 est faste pour lui: il obtient un doctorat en théologie, il est ordonné prêtre, il enseigne désormais la philosophie et la rhétorique au Séminaire de Québec. Parent part pour Rome en 1933, puis termine en 1936 à l’Université catholique de Louvain un autre doctorat, cette fois en philosophie, avant de revenir à l’Université Laval.
Ce parcours lui procure une connaissance intime du monde universitaire. Dès cette période, ce disciple de Saint Thomas fréquente les universités d’Europe et d’Amérique du Nord, compare les modèles en matière d’enseignement et de recherche, rapporte son expérience du terrain et échange avec ses collègues, dont Charles De Koninck, Georges-Henri Lévesque, Ernest Lemieux et Cyrias Ouellet. Pour Mgr Parent, ces connaissances acquises le confortent dans une conviction: l’éducation est fondamentale, car elle forme l’être humain dans sa totalité. Dès lors, il lui importe d’ordonner le monde de l’éducation au Québec, afin de répondre «aux conditions concrètes de ce lieu et de notre temps» et «à toute l’exigence du meilleur accomplissement humain », selon son collègue philosophe Jacques de Monléon.
Bâtisseur
Mgr Parent est un esprit pratique, ne se cantonnant pas dans le ciel bleu des idées. Il voit que les universités deviennent des foyers intellectuels et scientifiques rayonnant dans leurs communautés respectives. À cette fin, il faut mobiliser sur terre des ressources humaines et financières en créant des réseaux et des institutions.
Secrétaire de la Faculté de philosophie, il met sur pied avec Jeanne Lacerte, les cours d’été destinés notamment aux étudiants étrangers. Il dirige la nouvelle École de pédagogie en 1943, où Arthur Tremblay, futur sous-ministre de l’Éducation, enseigne. Il sait que, pour demeurer pertinent, le haut savoir doit être diffusé grâce au réseautage des talents. À cette fin, il fonde en 1945 avec Charles De Koninck la revue savante Laval théologique et philosophique, puis dirige les Presses de l’Université Laval de 1960 à 1964.
Pour que l’Université Laval remplisse pleinement «son rôle émancipateur», de nouvelles infrastructures sont nécessaires dans l’après-guerre. Lancé par Ernest Lemieux, le projet de la Cité universitaire sur les hauteurs de Sainte-Foy est porté entre autres par Mgr Parent. Pour financer la construction, il convainc en 1947 les autorités du Séminaire de lancer une souscription publique de 10 millions de dollars sur 5 ans. Comme vice-recteur et bras droit du recteur Ferdinand Vandry, il prône aussi la diversification du financement de l'établissement, avec une commission des finances chargée du budget. Devenu recteur en 1954, il veille à l’édification des pavillons de l’École de médecine et du Grand Séminaire.
Réformateur
Au moment de la Révolution tranquille, la société québécoise a un urgent besoin de réformer son système d’éducation afin d’élargir son accès. Pour planifier ce chantier, Jean Lesage et Paul Gérin-Lajoie se tournent en 1961 vers un entrepreneur énergique possédant une expérience certaine en la matière: Alphonse-Marie Parent.
Avec plusieurs experts, dont Jeanne Lapointe et Guy Rocher, la commission Parent entreprend une large consultation. Les cinq volumes de son rapport proposent d’importantes innovations: création d’un ministère de l’Éducation dès 1963, réforme des cycles primaire et secondaire, fin des collèges classiques, instauration des cégeps et du réseau des Universités du Québec. Les bouleversements sont profonds: l’esprit pragmatique de Mgr Parent lui fournit le tact nécessaire pour assurer leur acceptation.
Après le dépôt du rapport en 1967, Alphonse-Marie Parent revient dans son alma mater pour servir de nouveau. Malgré une santé chancelante, il occupe la fonction de doyen de la Faculté de philosophie jusqu’à son décès en 1970.