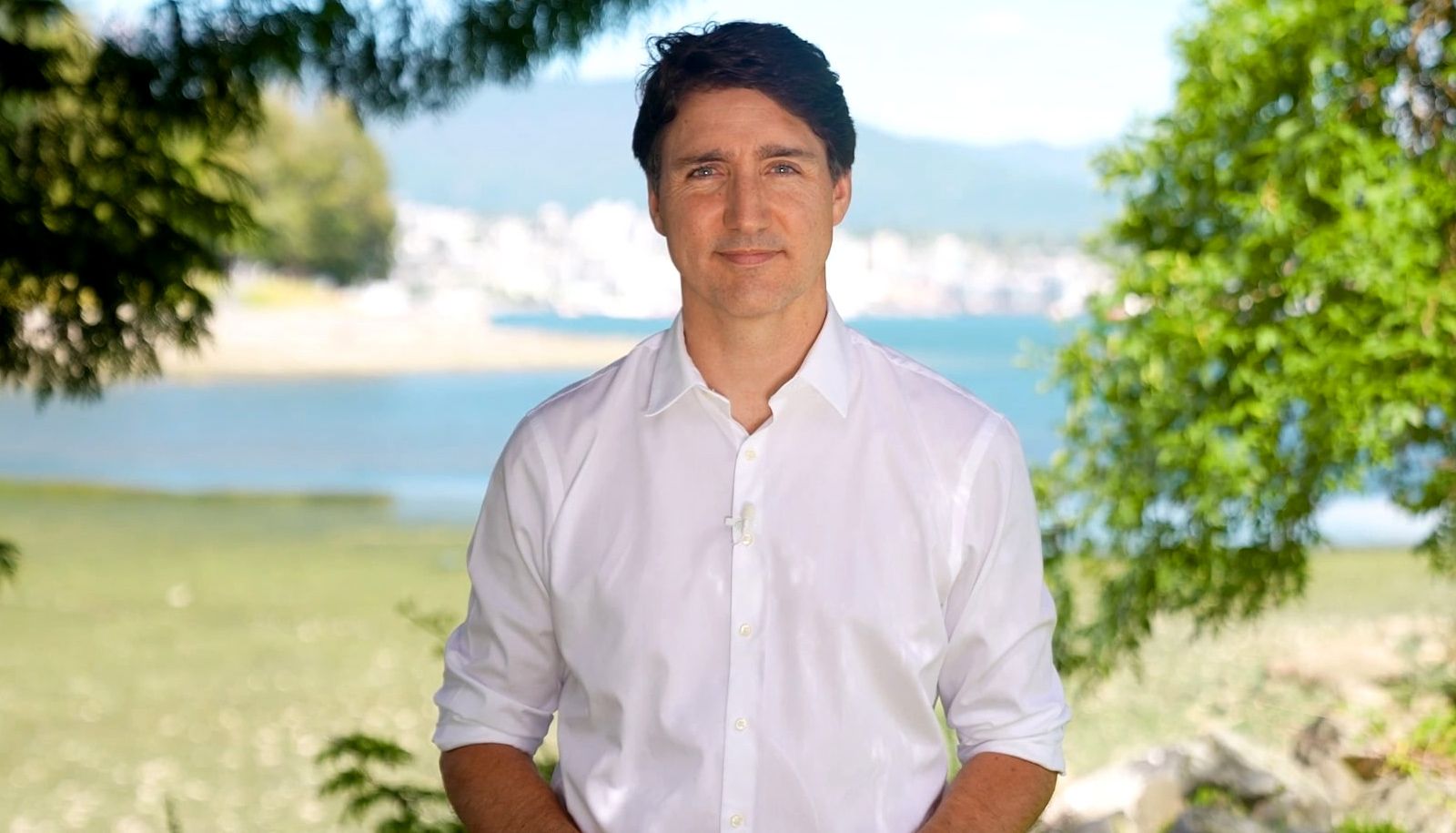Des milliers de manifestants occupent la Plaza Baquedano au centre-ville Santiago le 25 octobre 2019.
— Hugo Morales
Grève générale en Colombie, manifestations monstres au Chili, protestations contre la hausse du prix de l’essence en Équateur, élections anticipées et exil forcé du président en Bolivie : les mouvements sociaux se multiplient en Amérique latine. La géographe Nathalie Gravel, dont les recherches portent notamment sur le Brésil et la Colombie, en fait l’analyse.
La Colombie entre à son tour dans un mouvement de contestation contre le pouvoir, après une grève générale le 21 novembre. Comment s’explique cette mobilisation?
J’étais à Bogota à la fin octobre, quand les étudiants ont commencé à manifester. Au départ, ils dénonçaient la corruption à l’université publique. En effet, un fonctionnaire a acheté des voitures de luxe et il s’est payé des voyages durant 10 ans avec une carte de crédit de son établissement. Avec l’argent, on aurait pu financer les études de 6000 Colombiens. Au lendemain de cette nouvelle, les étudiants d’une trentaine d’universités de la capitale se sont mobilisés. Ils ont décidé de faire grève tous les vendredis. La police a réagi très fortement, en lançant des gaz lacrymogènes et en bloquant les routes. Un véritable état de siège pour la population. Durant la grève générale, les gens craignaient même de se faire attaquer chez eux par des gangs criminels, qui auraient pu profiter du chaos pour voler en toute impunité. Certains ont même pensé que l’État utilisait cette méthode pour semer la terreur et pour les inciter à rester à la maison. Des habitants de Bogota ont commencé à s’armer et à tirer de la mitraillette dans la rue. Dans le pays, la violence monte notamment parce que le gouvernement n’a pas respecté l’aide financière découlant des accords de paix avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Sans oublier l’arrivée massive d’un million de Vénézuéliens, qui constitue aussi un facteur d’instabilité.
Depuis quelques semaines, il suffit de la hausse du prix du billet de métro ou du carburant pour provoquer une véritable effervescence sociale dans plusieurs pays du continent…
Je pense que ces mouvements s’expliquent par les politiques néolibérales de plusieurs gouvernements, qui s’attaquent aux droits des citoyens. En Colombie, par exemple, un de mes étudiants au doctorat, qui travaille pour la mairie de Bogota, m’expliquait que les employés ne disposent plus de contrats permanents. Les gens ne peuvent plus compter sur des protections sociales. Pas plus qu’ils ne savent s’ils auront encore un salaire dans six mois. À la moindre augmentation, l’insécurité pousse les gens à descendre dans la rue. Ce phénomène survient alors que la droite a pris le pouvoir dans plusieurs pays, jusque-là gouvernés par la «nouvelle gauche» latino-américaine. Finalement, il n’y a jamais eu de consensus dans ces sociétés, même s’il semble plutôt sain que le pouvoir politique alterne selon les intérêts des uns et des autres. Cependant, les changements sont toujours vécus de manière brutale. Ils touchent particulièrement des populations qui ont coussin financier restreint et qui disposent de très peu de protection sociale. La moindre diminution du filet social les atteint de plein fouet. Cela peut expliquer cette mobilisation simultanée dans plusieurs pays.
Que pensez-vous de la réaction violente de certains gouvernements face à ces mouvements sociaux?
J’ai l’impression qu’ils se sentent menacés et qu’ils cherchent à conserver le pouvoir. Actuellement, il y a un réel danger d’assister à une montée de l’autoritarisme sur le continent, notamment au Brésil. Il n’y a pas longtemps, le président Bolsonaro a nié qu’il y ait eu une dictature dans ce pays. Il a même rendu hommage à Augusto Pinochet pour avoir mis fin au gouvernement de gauche au Chili, en 1973. De chaque côté du spectre politique, on assiste souvent à des réactions extrêmes en Amérique latine. Nés dans la violence avec les guerres d’indépendance, il y a 500 ans, ces pays n’ont pas vraiment appris à vivre avec la démocratie. Les partis restent cloisonnés chacun dans leur idéologie. En Colombie, la guerre civile a duré 50 ans. Les libéraux et les conservateurs s’y affrontaient sur fond de violence extrême pour gagner le pouvoir et avoir de l’influence. Sans parler des droits des autochtones, qui ne sont pas assurés dans plusieurs pays. En Bolivie, la présidente par intérim a même affirmé qu’ils sont le diable alors que ces communautés forment 65% de la population dans ce pays! Pour qui gouverne-t-elle?

Nathalie Gravel
— Martine Lapointe