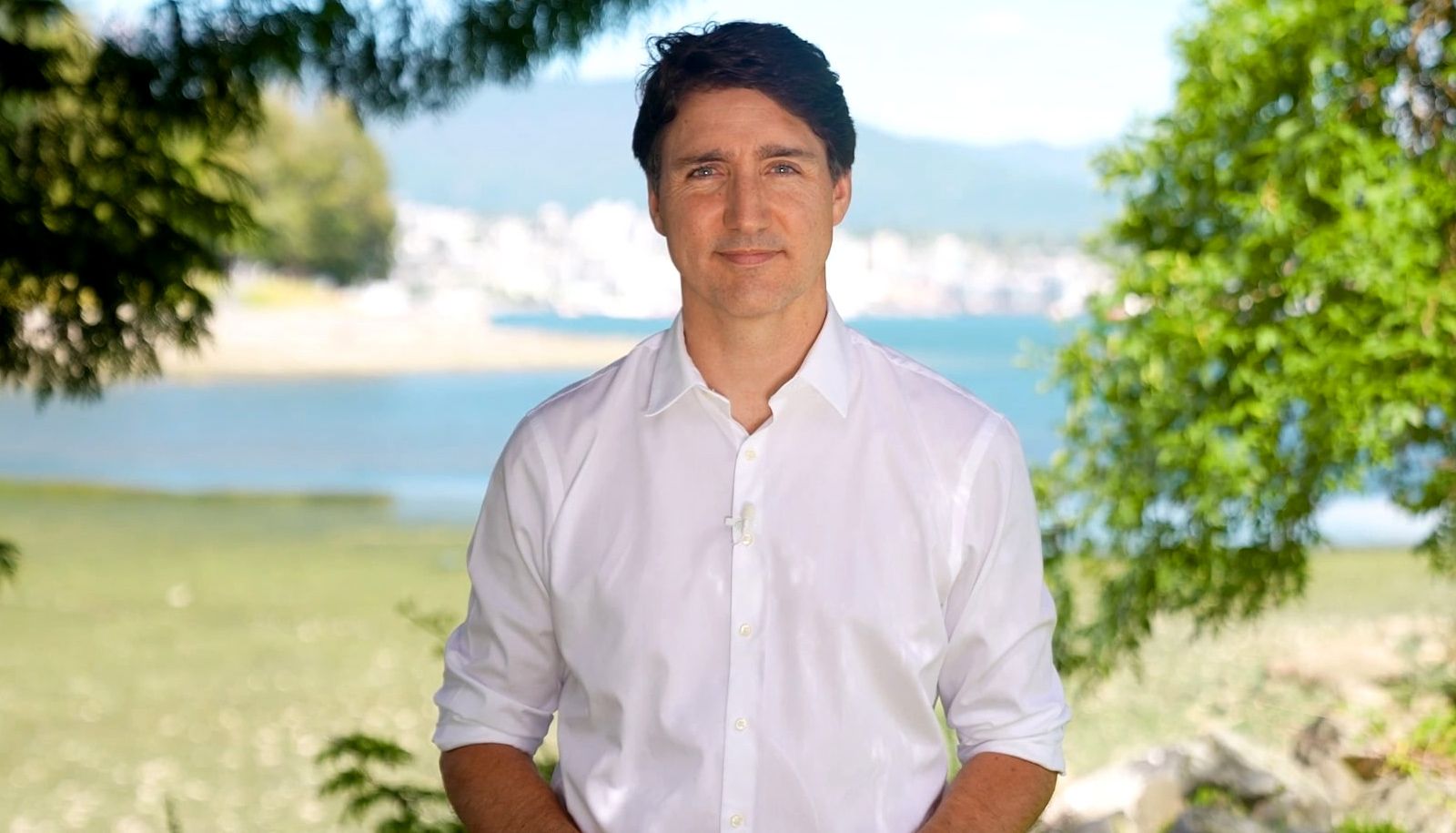15 juillet 2022
Conférence de Montréal: revoir les façons de faire pour contrer la crise alimentaire
«Il faut repenser les systèmes alimentaires pour assurer une plus grande autonomie nationale ici comme ailleurs, tout en demeurant ouvert sur le monde», croit la professeure de droit Geneviève Parent

De gauche à droite, Ken Seitz, de Nutrien, Martin Caron, de l'Union des producteurs agricoles, Lloyd Day, de l'Institut interaméricain de coopération en agriculture, et Geneviève Parent, professeure à l'Université Laval, lors d'une table ronde à la Conférence de Montréal.
— Éric Carrière
Une personne sur 10 souffre de la faim, selon un récent rapport de l'ONU. Nous entrons dans la plus grande crise alimentaire que l'humanité ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale, annoncent le secrétaire général des Nations unies et le directeur du Programme alimentaire mondial. La guerre en Ukraine a exacerbé la situation, déjà galopante avec la pandémie de Covid-19, la crise énergétique, les changements climatiques, la perte de biodiversité et l'inflation.
Sur cette toile de fond peu réjouissante, mais réaliste, Geneviève Parent, professeure et titulaire de la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires, animait une table ronde à la Conférence de Montréal du Forum économique international des Amériques, le 13 juillet, à l'hôtel Bonaventure. L'objet de la rencontre: nourrir la planète de façon plus durable et sécuritaire.
Sur scène, elle a réuni Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles (UPA), Lloyd Day, directeur général adjoint de l'Institut interaméricain de coopération en agriculture (IICA), et Ken Seitz, président délégué et directeur général de Nutrien, une multinationale de fertilisants.
Comment traverserons-nous cette crise? D'abord en protégeant l'humain, en aidant les plus vulnérables, ensuite en protégeant le marché, a lancé d'entrée de jeu Lloyd Day.
«L'agriculture, c'est le socle de la sécurité alimentaire, a pour sa part élaboré la professeure Parent, en marge de la table ronde. Des pays ont tendance à se refermer sur eux-mêmes, à revenir à des politiques plutôt protectionnistes. C'est ce que fait l'Europe en ce moment, ce qu'on peut comprendre. La dépendance était tellement grande face aux approvisionnements russes et ukrainiens. Mais il faut rester ouvert sur le monde. L'alimentation, comme les autres domaines, s'est mondialisée. On est dans une réalité de libre marché, tout est imbriqué. Impossible du jour au lendemain de fermer les frontières et de ne s'alimenter que chez nous. D'ailleurs, on ne produit pas tout ce qu'il faut pour s'alimenter comme on le souhaiterait. L'autarcie et le protectionnisme auraient des conséquences dramatiques sur la sécurité alimentaire mondiale.»
— Geneviève Parent
En contrepartie, poursuit-elle, il faut repenser davantage les mécanismes pour assurer une plus grande autonomie alimentaire nationale, ici comme ailleurs. «La guerre en Ukraine a mis au grand jour des incohérences.» Elle donne l'exemple de l'Italie, royaume des pâtes et de la pizza, qui importe 60% de blé russe et ukrainien, alors que c'est un produit à la base de l'alimentation traditionnelle italienne. «Il est étonnant que ce pays ne soit pas en mesure d'être plus autonome pour un produit qui lui est aussi essentiel!», s'étonne la professeure.
Toutes puissantes, les ententes commerciales
De son côté, le président de l'UPA souligne qu'il faudra un changement en profondeur pour permettre plus d'autonomie. Il déplore la toute-puissance des ententes commerciales, qui priment au détriment des nations. «Ça va prendre une convention internationale au niveau de l'alimentation», plaide Martin Caron.
«Il y a clairement une disproportion avec les accords de libre-échange. Comment peut-on permettre aux États d'adopter des politiques, des cadres réglementaires qui leur permettent d'aller vers plus d'autonomie tout en restant concurrentiels sur les marchés internationaux? Comment rétablir un équilibre qui soit effectif pour tous les acteurs et les consommateurs, surtout les plus vulnérables?», soulève Geneviève Parent.
La sécurité alimentaire ne se limite pas à produire suffisamment de nourriture pour tout le monde, souligne la professeure à la Faculté de droit. Elle englobe aussi notamment la protection de l'environnement, la santé humaine, l'accès économique aux denrées. «On a beau avoir des aliments plein les tablettes, est-ce qu'on a les moyens de les payer? C'est un enjeu qu'on vit au Québec et au Canada», dit-elle alors qu'on annonçait cette semaine de nouvelles hausses de prix dans les épiceries cet automne.
«Réfléchir en systèmes alimentaires»
Pour se sortir du marasme, les panélistes, des acteurs de milieux parfois opposés, ont mis en lumière l'importance de «réfléchir en systèmes alimentaires». «L'agriculteur seul, il peut faire son bout de chemin. Un consommateur seul peut faire son bout de chemin. L'entreprise seule peut faire son chemin. Si on assoit tous ces gens-là ensemble, on va être encore plus efficace», croit Geneviève Parent.
Dans la grande chaîne alimentaire, tout est relié, insiste la professeure. «Si les agriculteurs ne vont pas bien, mon entreprise ne va pas bien», a d'ailleurs illustré Ken Seitz, de la multinationale de fertilisants Nutrien, aussi affectée par la guerre en Ukraine, alors que la Russie et la Biélorussie produisent de grandes quantités de potasse, d'azote et de phosphore.
Le fardeau des agriculteurs
Le fardeau de cette transition alimentaire repose beaucoup sur le dos des agriculteurs, a fait valoir Martin Caron, qui en est un lui-même. Leur réalité n'est déjà pas rose, alors qu'ils jonglent avec la pénurie de main-d'œuvre, la hausse des coûts du carburant, des fertilisants et d'une panoplie d'intrants. Et voilà qu'on leur demande d'assurer l'autonomie alimentaire, d'être efficaces pour exporter et de faire du développement durable!

Les agriculteurs jonglent avec la pénurie de main-d'œuvre, la hausse des coûts du carburant et des fertilisants et on leur demande d'assurer l'autonomie alimentaire, d'être efficaces pour exporter et de faire du développement durable.
— GETTY IMAGES/OlenaMykhaylova
L'agriculture est peu représentée dans les accords internationaux en environnement. Elle est perçue comme une activité polluante, au même titre que les pétrolières et les minières, s'indignait Lloyd Day. Mais «elle pollue pour nourrir l'humanité», ont nuancé les invités, qui aimeraient que les prochaines Conférences des parties (COP) en tiennent réellement compte.
Ils ont aussi fait valoir que l'agriculture peut faire partie de la solution aux problèmes climatiques, par l'innovation scientifique. Lloyd Day a vanté une nouvelle technologie qui évite l'évaporation des sols et retient l'eau. Geneviève Parent croit aussi à l'innovation sociale, comme l'amélioration de plus petits systèmes alimentaires, plus directs, entre les producteurs et les consommateurs, notamment appuyés par l'économie solidaire.
Si les agriculteurs ont besoin d'outils, de soutien et de politiques pour les aider, ils travaillent également à éduquer et à sensibiliser les consommateurs. Alors que plus du tiers de l'alimentation produite est perdue, le gaspillage alimentaire est l'une des principales causes d'émission de gaz à effet de serre, rappelle le président de l'UPA.
Des collaborations qui se poursuivent
L'Université Laval, partenaire de la Conférence de Montréal, a un grand rôle à jouer sur toutes ces questions. Par la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires, par la Faculté d'agriculture, par l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels et par l'Observatoire sur la qualité de l'offre alimentaire, «on a une grande force de frappe en matière de sécurité alimentaire», indique Geneviève Parent. Elle se réjouit des ententes passées avec l'IICA et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui permettent aux chercheurs de Québec «d'appuyer la réflexion des États et des décideurs».
Lloyd Day, de l'IICA, se dit très heureux de travailler avec la professeure Parent depuis une dizaine d'années et salue l'expérience et le leadership canadien en recherche pour aider l'agriculture à progresser dans ses 34 États membres à travers l'Amérique et les Caraïbes.