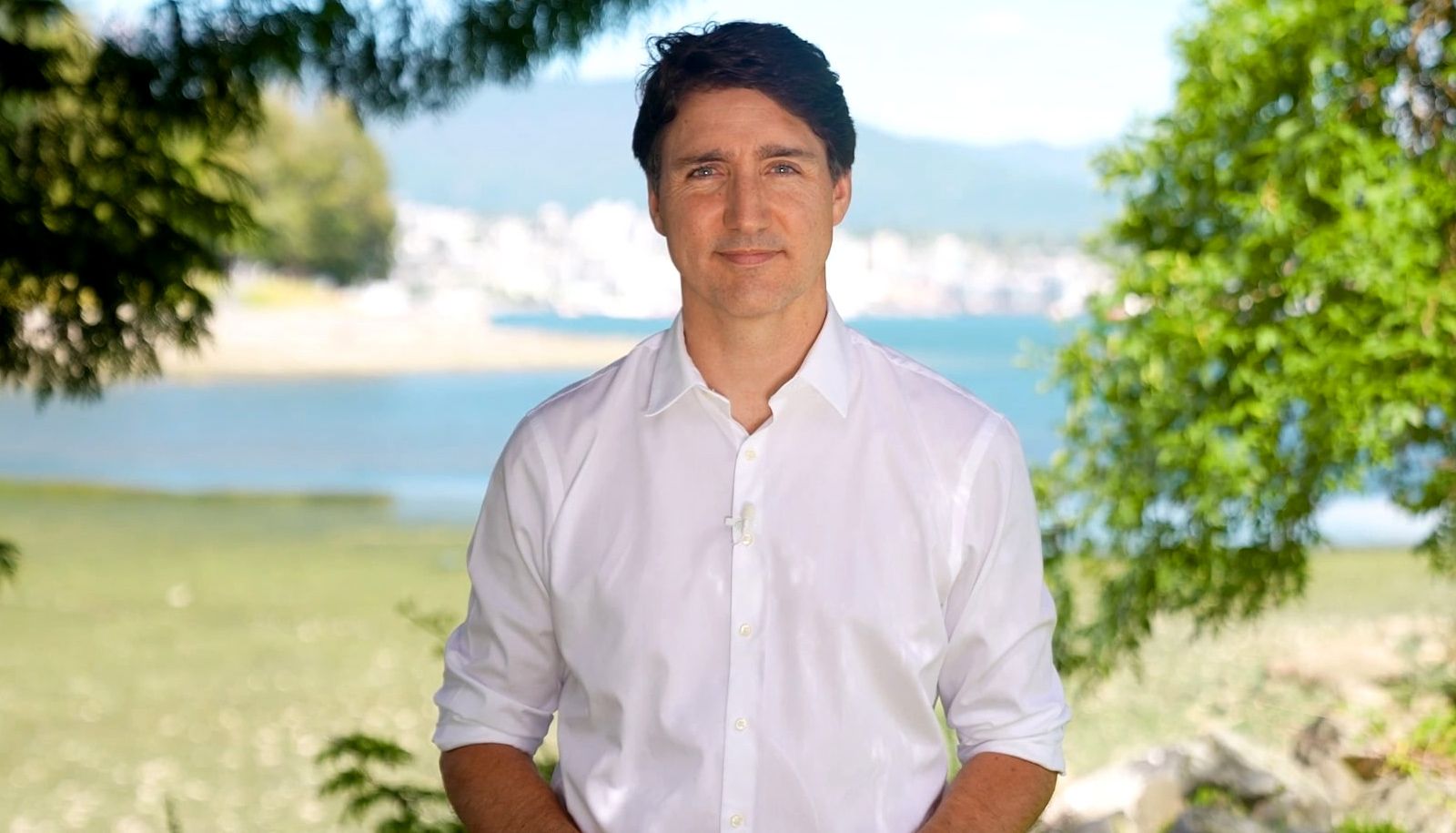— GETTY IMAGES/PAKIN JARERNDEE
Quand une personne contrevenante sort de prison, elle doit se loger, développer des compétences pour trouver un emploi, parfois suivre un traitement. Comment s'y retrouver à travers les politiques et programmes existants en matière de réinsertion sociale? Peut-on s'inspirer de ce qui se fait ailleurs? Une équipe de l'Université Laval, avec des partenaires externes, a développé une plateforme de recension pour trier, analyser et regrouper toutes ces informations.
Fraîchement lancé, l'Observatoire de la réinsertion sociale est né de deux constats, indique la responsable du projet, Elsa Euvrard. «Il y avait un manque d'accessibilité des connaissances sur les programmes dans le domaine. On prenait aussi beaucoup en exemple certains pays, comme en Europe du Nord, mais sans vraiment savoir comment ils fonctionnent», explique la professeure à l'École de travail social et de criminologie et titulaire de Chaire de recherche en réinsertion sociale des personnes contrevenantes de l'Université Laval.
En partenariat avec les ministères de la Sécurité publique et de la Justice, la Chaire a répertorié les pratiques au Québec, dans différentes provinces canadiennes et dans des pays comme la Suède, les Pays-Bas, les États-Unis et la Norvège. En résulte une plateforme en ligne comptant déjà une soixantaine de grilles d'analyse, sorte de fiches à consulter. «On vise une centaine d'ici la fin de la session», souligne la professeure Euvrard.
Chaque grille décrit une politique ou un programme en matière de réinsertion sociale, ses objectifs, son fonctionnement et fournit les références. L'équipe de recherche s'est inspirée d'outils similaires pour surveiller les initiatives existantes dans d'autres disciplines, comme en santé publique ou en environnement, mentionne la responsable.
Pour les intervenants, les chercheurs et les décideurs
L'Observatoire de la réinsertion sociale a plusieurs visées. Il peut servir de guide aux intervenantes et aux intervenants dans leur pratique, quand ils veulent avoir accès à une liste de références rapidement pour diriger une personne contrevenante vers un programme adapté à ses besoins, illustre la professeure.
Un moteur de recherche permet de naviguer dans la plateforme par thèmes (dépendance, délinquance sexuelle, violence familiale, santé mentale, par exemple), par population visée (hommes, femmes, population carcérale, personnes en situation d'itinérance…) ou par lieu (provinces canadiennes et une douzaine de pays), précise Sabrina Bourget, coordonnatrice de la Chaire.
Cet outil a aussi de l'intérêt pour les chercheurs, poursuit Elsa Euvrard. «L'un des objectifs de l'Observatoire est de comprendre les rationalités derrière la création d'un programme, son assise théorique et la conceptualisation de la réinsertion sociale, des éléments de la grille d'analyse.»
Il y a différentes façons d'envisager la réinsertion sociale, exposent les chercheuses. Certains programmes travaillent sur la récidive, d'autres favorisent l'intégration sociale. «Ça permet de voir une palette très large», estime la professeure, qui utilise aussi la plateforme et les grilles dans un séminaire de maîtrise pour amener les étudiants et les étudiantes à analyser ce qui est offert et à réfléchir à la théorie.
— Elsa Euvrard, en montrant une utilité de l'Observatoire
Elle ajoute que l'Observatoire a aussi une visée plus comparative, notamment pour les décideurs politiques. «S'ils veulent mettre en place un projet pilote, il y a moyen de faire une recension, de savoir ce qui se fait et ne se fait pas. Ultimement, on veut s'inspirer des meilleures pratiques», dit-elle.
Le modèle Logement d'abord, qui découle du programme Pathway Housing, lancé à New York en 1992 et qui s'est répandu au Canada, aux États-Unis et en Europe, a particulièrement intéressé l'équipe de la Chaire, dont l'assistante de recherche Mégane Brochu. L'objectif principal de cette approche est de lutter contre l'itinérance en fournissant un logement autonome et permanent dans les délais les plus brefs et sans condition préalable. Une fois le logement trouvé, une gamme de services de soutien est déployée. Différentes provinces canadiennes ont des programmes qui reposent sur ce modèle, mais pas le Québec, peut-on constater en consultant l'Observatoire.
Maintenant que l'outil existe, de nouvelles grilles sont créées en continu. «Il y a des programmes et des projets pilotes qui sortent tout le temps; on est à l'affût des nouveautés», indique Sabrina Bourget.
Outre le partenariat avec les ministères de la Sécurité publique et de la Justice, ce projet de la Chaire a été fait en collaboration avec le (RÉ)SO 16-35.