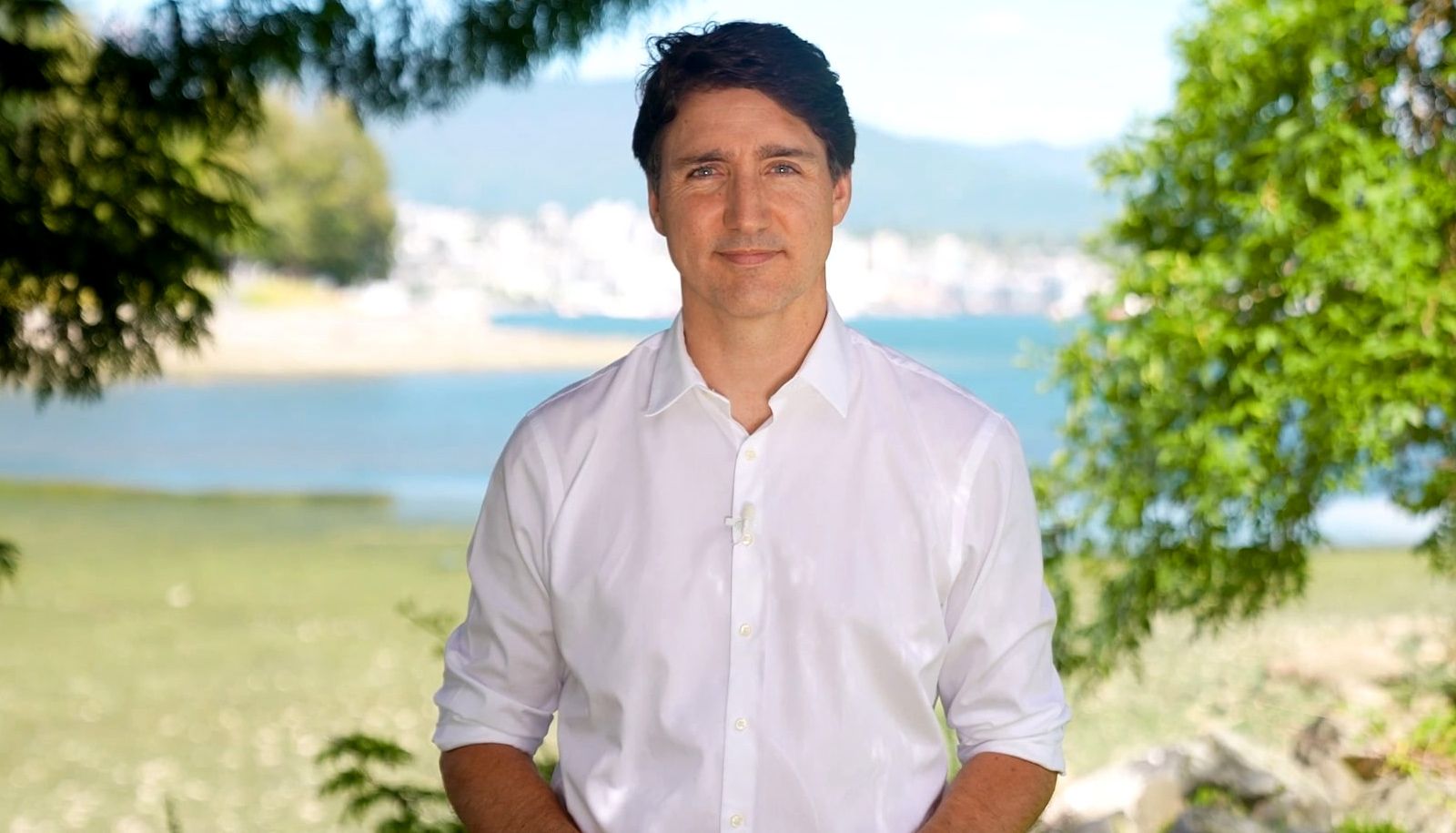La professeure Francine Saillant à la station Langelier du parcours Illumina.
L'un se découvre un peu partout dans le quartier Saint-Roch jusqu'au 8 septembre, l'autre se déploie au Centre de recherche CERVO, avenue d'Estimauville, de façon permanente. Illumina et À visage humain sont deux parcours-expositions complémentaires auxquels Francine Saillant a agi comme directrice de projets. Les thèmes communs: la mémoire, l'art, la déstigmatisation.
«Ça veut dire ouvrir les publics, favoriser le lien social au-delà des différences, créer du liant, diminuer les préjugés», indique la professeure émérite d'anthropologie à l'Université Laval.
Francine Saillant nous a donné rendez-vous à la station Langelier du parcours Illumina. Sur un panneau devant elle, quatre magnifiques portraits, dont celle d'une dame tenant son chat. La professeure connaît son histoire et évoque avec émotion les séances photo ouvertes aux gens du quartier. «On ne s'attendait pas à ce que des itinérants et une telle diversité de personnes avec d'autres problématiques viennent à ce point à notre rencontre pour se faire photographier.»
Donner de la visibilité
Certes, il y avait la promesse de donner la photo aux participants. Mais il y avait aussi un besoin de reconnaissance, d'être vu par un photographe qui prend le temps et qui jase. «L'idée était de donner de la visibilité, de l'espace, une occasion d'échanger et aussi de créer de la beauté dans le quartier», indique la professeure.
Illumina compte sept stations d'actions sociales et artistiques à travers Saint-Roch, dont celle avec les portraits au collodion humide du photographe Yves Lavoie, rétroéclairés le soir venu. Ils sont accompagnés de citations tirées d'ateliers de mémoire réalisés l'hiver dernier, durant lesquels les gens étaient amenés à réfléchir à leur vie de quartier. «De façon surprenante, la vision était plutôt positive, pondérée et critique par rapport aux investissements qui pourraient être faits en termes de logement et de sécurité», retient Francine Saillant.

Enfilade de portraits de gens du quartier Saint-Roch par le photographe Yves Lavoie. À voir jusqu'au 31 juillet, alors que le reste du parcours se poursuit jusqu'au 8 septembre.
Un balado permet aussi aux visiteurs d'entendre des voix du quartier à propos de la cohabitation.
Mêler chercheurs, intervenants, participants et artistes
Pour la professeure Saillant, chaque station du parcours urbain est une «cathédrale». «C'est de la cocréation avec des personnes dans toutes sortes de conditions, qui mêlait chercheurs, intervenants, participants, avec à chaque fois une intention de l'artiste invité», poursuit-elle en soulignant que 200 personnes ont contribué au projet.
Par exemple, Angela Marsh, qui travaille la fibre, a animé un atelier de création de nids avec entre autres des gens du Centre multiethnique de Québec, pour la plupart des réfugiés. «Il y a derrière la métaphore de la fragilité de l'habitat et de soi», explique Francine Saillant, en ajoutant que les petits nids sont installés au jardin Jean-Paul-L'Allier.
Sur un mur extérieur de la coopérative Méduse, on peut observer le fruit de la collaboration de trois organismes qui offrent l'art au service de la santé mentale comme forme d'intervention et d'accompagnement, soit Vincent et moi, l'Atelier de la mezzanine et Pech-Sherpa. Encore là des portraits, mais cette fois retravaillés de manière fantaisiste sous la direction de Fanny H. Levy.

Détail de la station Méduse, une action collaborative de l'artiste Fanny H. Levy et de ses collaborateurs.
— Kessler Bien-Aimé
«On a fait de l'observation et des entretiens autour de tous les processus pour évaluer l'impact sur les participants, sur les citoyens et sur les intervenants, qu'est-ce que ça produit, travailler de cette manière-là, sur la déstigmatisation», indique la professeure Saillant qui compilera les résultats de sa recherche cet automne.
Que la lumière soit
La lumière est partout dans cette vaste démarche financée par la Ville de Québec, CERVO, Desjardins et l'Université Laval. En plus des portraits, le clocher du Monastère des Augustines, qui jouxte l'Hôpital général, a aussi été illuminé. Francine Saillant signera en septembre sa propre exposition en mémoire de ce premier endroit où, jusqu'en 1845, des personnes vivant avec des troubles de santé mentale ont été enfermées.
Le parcours À visage humain commence quant à lui en 1845, quand 13 malades de l'Hôpital général ont été transportés du côté de Beauport et de ce qui allait devenir l'Hôpital Saint-Michel-Archange, aujourd'hui l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ). «Ce sont deux institutions hospitalières en lien avec la mémoire de la santé mentale», souligne la professeure, qui a voulu rappeler l'histoire de ces milieux oubliés.
«On avait besoin de créer une ville pour enfermer la folie», glisse-t-elle dans une vidéo sur l'exposition, qui montre l'évolution de la psychiatrie de cette époque à aujourd'hui.

Portion muséale et artistique du parcours-exposition À visage humain au Centre de recherche CERVO.
— CIUSSS Capitale-Nationale
Son équipe a plongé dans les archives de l'IUSMQ, a travaillé avec des chercheurs en neurosciences, a dynamisé l'image de neurones avec des artistes. Les corridors et deux salles du Centre de recherche CERVO exposent les œuvres collaboratives qui en résultent dans une signature très contemporaine.
«Ça vaut la peine de voir ces expositions et de transformer son regard sur les réalités de la santé mentale», invite Francine Saillant en parlant de ces deux projets «extrêmement émouvants et stimulants».