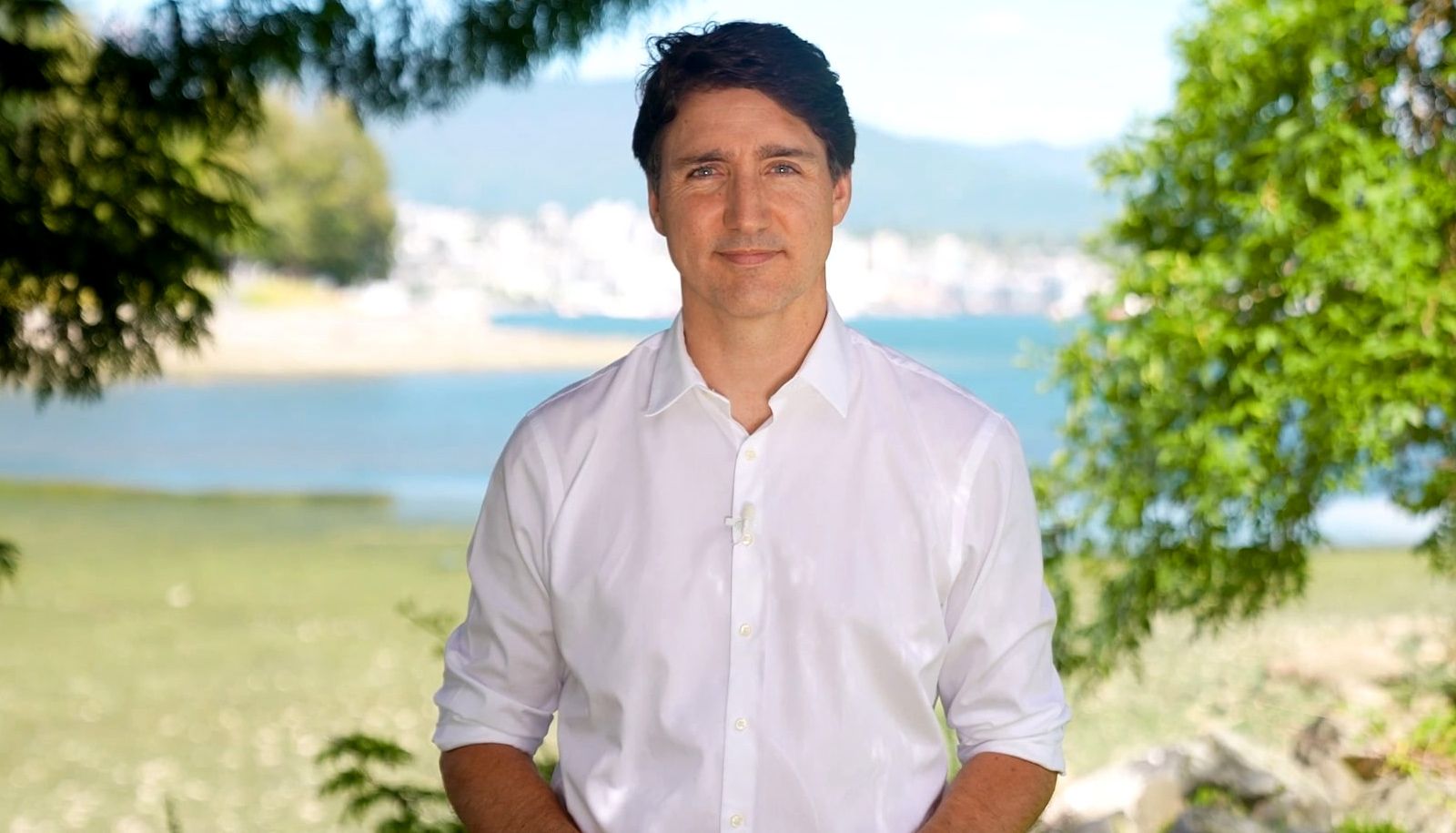Les porcs sont des animaux sociaux qui vivent en groupe. Ils ont besoin d’espace, puisqu'une réduction de la surface allouée augmente les interactions agressives et les lésions cutanées. Leur offrir un environnement plus naturel contribue au bien-être animal et à une production durable.
— GETTY IMAGES/ViktorCap
Planchers d'étable qui imitent la terre, la paille ou le gazon. Absence de contention pour les animaux. Espace pour les laisser vivre en groupe et se coucher de tout leur long. Lumière naturelle. Contrôle et conditionnement de l'air. Récupération de chaleur et de CO2 pour faire pousser des légumes… Voilà ce qui se dessine pour la prochaine génération de bâtiments agricoles.
«Est-ce qu'on va vraiment intégrer tous ces aspects-là? Peut-être pas, mais on tend vers ça dans la décennie 2050. Les producteurs sont de plus en plus conscientisés; le gouvernement fédéral, c'est l'une de ses priorités. Les producteurs se sont mis des cibles de carboneutralité pour 2050 et cette année, ça s'est accéléré», indique Sébastien Fournel, professeur en ingénierie des infrastructures et équipements agroalimentaires et titulaire de la Chaire de leadership en enseignement (CLE) des bâtiments agricoles durables à l'Université Laval.
Il est en Alberta ces jours-ci pour participer au Banff Pork Seminar et parler des fermes de l'avenir. Alors que le secteur de l'élevage est souvent pointé du doigt pour ses effets négatifs sur le bien-être animal ou son empreinte environnementale, il présentera des pratiques et des technologies qui pourraient renverser la vapeur. Un discours qu'il reprendra la semaine suivante au Salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe.
L'expertise de Sébastien Fournel en ingénierie du bâtiment agricole est assez unique au Canada. Le professeur a aussi grandi sur une maternité porcine dans Lanaudière, ajoutant une couche de sensibilité à son bagage. «Quand je parle à un producteur, je suis capable de comprendre sa réalité.»

Sébastien Fournel, professeur en génie agroenvironnemental
Sa CLE vise à former des ingénieurs en agroenvironnement et des agronomes spécialisés en infrastructures performantes pour répondre aux besoins modernes. Quant aux projets de recherche de la Chaire, ils portent sur de nouveaux concepts en production animale durable, comme les aires d'exercice vertes pour bovins laitiers, des volières à faibles émissions pour poules pondeuses ou des systèmes de ventilation évolués pour poulets de chair et porcs.
Bien-être animal: ce que le consommateur veut
La pression vient beaucoup du consommateur, indique le professeur Fournel. «Ultimement, ça se transpose sur les détaillants et les politiciens.» Il donne l'exemple des grandes chaînes comme McDonald's et Walmart, qui disent s'approvisionner auprès de fermes respectueuses du bien-être animal. «Les producteurs ont à répondre aux demandes sociétales.»
L'un des grands objectifs à atteindre en construction rurale est la «naturalité». «On veut essayer de créer un environnement intérieur qui se rapproche le plus possible de ce que l'animal vivrait à l'extérieur, dans la nature», explique Sébastien Fournel. Il dépeint de grands espaces de vie ouverts, sans séparation ni contention, avec des éléments pour jouer ou mâchouiller et des surfaces variées qui permettent de gratter ou de creuser.
— Sébastien Fournel
Actuellement, les vaches laitières et les porcs se promènent sur des planchers de béton ou des caillebotis avec des fentes qui laissent passer le lisier. Ces surfaces dures, parfois inégales, peuvent causer des problèmes aux membres, comme de la boiterie, voire de petites coupures, illustre le professeur. Il indique qu'en Europe, des surfaces un peu molles, mais tressées pour drainer l'urine (ce qui empêche les émissions d'ammoniac, source d'odeurs) sont à l'étude. Les fientes qui restent en surface sont ramassées par un robot.
Il parle aussi de systèmes de litière compostée, une surface plus organique et naturelle. Les vaches font leurs déjections dans un grand espace recouvert de copeaux de bois absorbants. En raclant le sol deux fois par jour pour brasser, alimenter et oxygéner les bactéries, on aide la décomposition, on réduit les émissions de méthane et d'ammoniac, on chauffe l'espace et ce n'est pas dangereux pour les maladies, indique le professeur Fournel.
Le bien-être animal passe également par un accès à l'extérieur ou, du moins, un aperçu de l'extérieur. Les sorties au grand air viennent toutefois avec des défis: prédateurs, maladies et biosécurité. Sans compter les normes à respecter en ce qui concerne les excréments. «On ne peut pas polluer les sources d'eau avoisinantes.»
Donner de l'espace aux animaux à l'intérieur et les laisser vivre en groupe demande par ailleurs d'augmenter la superficie et implique de construire de grandes structures plus coûteuses. Le défi devient alors économique.
La ventilation et le contrôle de l'air dans les bâtiment agricoles ont aussi connu des avancées. Le professeur parle d'«entrée unique» pour limiter l'entrée de virus, comme la grippe aviaire ou différents syndromes respiratoires porcins. La «sortie unique» limite quant à elle la propagation d'odeurs dans le voisinage.
En cette ère de réchauffement climatique, la climatisation de l'air prend également de l'importance. «L'air passe à travers des filtres et des rideaux avec de l'eau et va se refroidir. Il est ensuite acheminé par des trappes dans différentes salles.» La géothermie (l'air entrant refroidi en passant sous le bâtiment) est également utilisée au Québec, en France et en Chine, souligne le professeur Fournel.
Des tomates engraissées à l'air de porcheries?
Au-delà du bien-être animal, la recherche se penche sur l'économie circulaire, pas encore très répandue au Canada. «Les animaux chauffent l'air et rejettent du gaz carbonique. Plutôt que d'envoyer la chaleur et le CO2 à l'extérieur, pourquoi ne pas les utiliser pour faire pousser autre chose, puisqu'il s'agit des principaux intrants de la production végétale?» expose le professeur Fournel.
Ce processus limiterait la consommation énergétique des combustibles fossiles (utilisés pour chauffer les serres) et profiterait à une culture d'appoint qui permettrait d'aller chercher un revenu supplémentaire.
L'idée n'est pas si utopique. Un producteur avec qui Sébastien Fournel collabore lui a demandé d'installer une serre à côté de sa porcherie. Un projet pourrait voir le jour pour évaluer la capacité de filtrer la chaleur et le CO2, «mais pas le reste». «Il y a un enjeu de sécurité alimentaire. Est-ce que des tomates peuvent être engraissées à l'air de porcheries? Il y a des aspects à vérifier.»
Toits vitrés ou qui laissent passer la lumière dans les bâtiments de ferme, système de traitement de l'air, système d'énergie solaire… toutes ces technologies doivent être étudiées et validées. Il faut vérifier leurs avantages et leur rendement pour qu'elles soient ensuite adoptées par les producteurs, indique le professeur en parlant d'une belle ouverture de leur part.
Des protéines au coût environnemental le plus bas
Pour Sébastien Fournel, le vaste débat qui oppose les protéines végétales aux protéines animales dans la lutte contre les changements climatiques est plein de nuances et souvent mal compris. «Si tout le monde devenait végétalien au Québec, notre bilan de gaz à effet de serre s'améliorerait de 8%», a-t-il calculé grossièrement, en mentionnant que laisser tomber l'une des deux voitures dans un couple a beaucoup plus de retombées positives sur l'environnement.
Il ajoute que la production animale «fait partie des mœurs», qu'elle dynamise les régions et l'économie, qu'elle offre des fertilisants organiques aux végétaux cultivés sans pesticides, que la qualité nutritionnelle de la viande sort les gens de la malnutrition et que la demande mondiale va croître dans les prochaines années.
«C'est aux gens de faire leur choix en fonction de leurs convictions, on n'est pas là pour juger. Le but est de produire des protéines pour nourrir la population de la planète qui augmente de plus en plus. Faisons-le le mieux possible pour limiter l'impact sur notre planète, qui se dégrade à vitesse grand V», conclut le professeur.