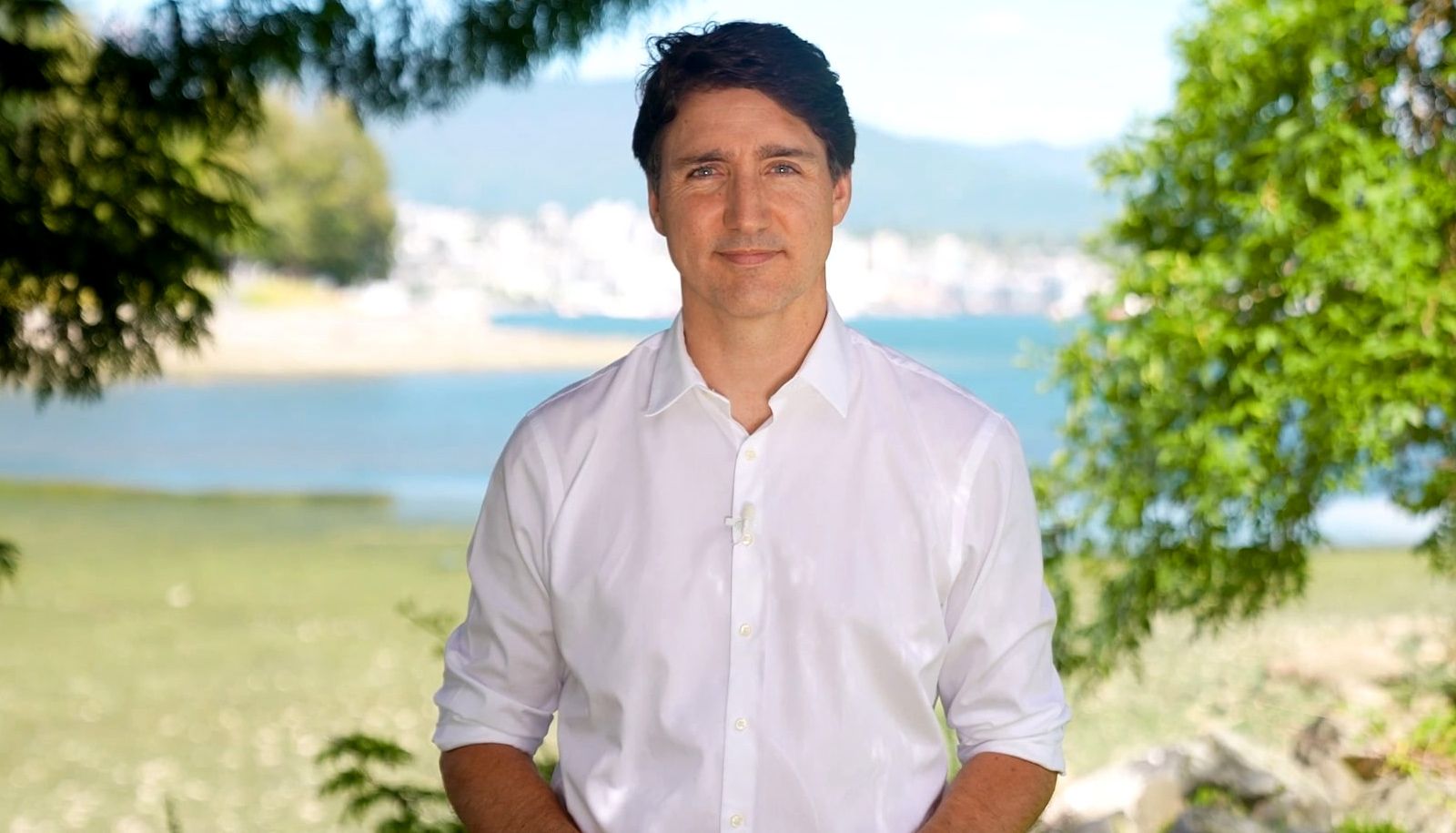Les stoïciens sont ceux qui ont le plus approfondi cette idée que l’humain est une partie, et seulement une partie, de cette Terre et qu’il ne peut en être détaché. Ils voyaient le monde comme une cité, voire un système composé du ciel, de l’air, de la terre et de la mer dans lequel des liens unissent les parties, ce qui assure une cohésion au monde.
— Getty Images
«Les stoïciens étaient sans doute loin de penser que l’action de l’humain pourrait un jour épuiser les ressources de la Terre et du monde. Mais si leur école avait vécu assez longtemps pour en être témoin, il est clair qu’ils auraient été horrifiés par la surexploitation de la Terre et la disparition progressive de la biodiversité, et qu’ils auraient jugé l’action de l’humain moderne fondamentalement contraire à la nature, au sens où l’usage de la nature par l’humain, selon eux, est de promouvoir la diversité et la beauté de celle-ci et donc de préserver la biodiversité.»
C’est sur ces mots que le professeur de philosophie ancienne à la Faculté de philosophie, Bernard Collette, a mis fin à son exposé du mercredi 7 décembre au pavillon Félix-Antoine-Savard. Le thème de sa conférence était «Philosophie antique et écologie: l’hypothèse Gaïa des stoïciens». L’activité a eu lieu dans le cadre des midis du Laboratoire de philosophie ancienne et médiévale de la Faculté.
«L’idée, explique-t-il, que l’activité humaine puisse un jour avoir un impact sur notre climat et bouleverser les conditions de survie des diverses espèces vivant sur Terre, y compris bien sûr la nôtre, une telle idée était tout simplement inimaginable pour un penseur de l’Antiquité.»
Le professeur rappelle que toutes les grandes philosophies de l’Antiquité avaient une vue globale sur la réalité et une position sur la plupart des dimensions de la vie. Une ces positions consistait à considérer la planète Terre comme un être vivant.
«Cette thèse n’était pas si rare à l’époque, dit-il. On la trouve dans la tradition socratique, elle a été développée par Platon. On peut dire que les stoïciens sont ceux qui ont le plus approfondi cette idée que l’humain est une partie, et seulement une partie, de cette Terre et qu’il ne peut en être détaché. Ils voyaient le monde comme une cité, voire un système composé du ciel, de l’air, de la terre et de la mer dans lequel des liens unissent les parties, ce qui assure une cohésion au monde. Pour les stoïciens, les parties du monde sont interdépendantes et dépendent du tout. En ce sens, la pensée stoïcienne peut continuer à nourrir la réflexion écologique d’aujourd’hui.»
Cette vision globale et unifiée très ancienne apparaît paradoxalement comme très actuelle. Selon lui, la philosophie antique est encore pertinente pour réfléchir sur les défis environnementaux de notre temps.
«Depuis une dizaine d’années, souligne Bernard Collette, on voit de plus en plus d’articles scientifiques établir un lien entre les questions relatives à l’environnement et les stoïciens. J’envisage d’aller plus loin dans cette comparaison dans le cadre de mes travaux de recherche futurs. On observe que plusieurs penseurs de l’écologie moderne aiment faire référence aux penseurs de l’Antiquité. Le biologiste et écologiste britannique James Lovelock, récemment décédé, était l’un de ceux-là.»
Une entité autorégulatrice
James Lovelock est l’auteur de Gaïa, a New Look at Life on Earth dans lequel il développe l’«hypothèse Gaïa». Gaïa était l’un des noms que les Grecs donnaient à la Terre dans leur mythologie. Dans ce livre publié en 1979, le scientifique décrit la biosphère terrestre comme «une entité autorégulatrice dotée de la capacité de préserver la santé de notre planète en contrôlant l’environnement chimique et physique». Pour lui, la Terre est un «organisme unique» composé de parties structurées, un «système complexe» ayant un «pouvoir autorégulateur».
«Cette hypothèse, rappelle le professeur Collette, fut accueillie au départ avec froideur et scepticisme dans la communauté scientifique. On trouvait cette idée en contradiction, semblait-il, avec la doctrine de l’évolution de Darwin, qui affirme que la vie n’implique aucun dessein intelligent. Selon Lovelock, le système Terre est orienté vers un but, à savoir la préservation des conditions vitales de la planète, sans pour autant que cela n’implique l’hypothèse d’un dessein intelligent. Au contraire, l’hypothèse Gaïa conserve la théorie de l’évolution, mais entend la resituer dans un contexte plus global que celui d’une espèce donnée.»
L’hypothèse Gaïa s’est progressivement imposée et n’est plus très choquante de nos jours. Dans son livre, Lovelock souligne que l’idée que la Terre serait un être vivant était encore vivace au 18e siècle. James Hutton, le père de la géologie, comparait le cycle global de l’eau sur Terre avec la circulation sanguine d’un animal. Selon l’auteur, la spécialisation toujours plus poussée des branches du savoir aurait fait perdre de vue la Terre dans son unité. En revanche, l’exploration spatiale aurait contribué à ranimer une approche holistique des sciences de la Terre.
«Selon Lovelock, il faut en finir avec une vision parcellaire de la Terre, une vision départementaliste, indique le professeur. Il faut avoir une vision holistique, celle d’un être vivant qui possède une unité.»
Voir la Terre comme un tout cohérent, unifié, dont les parties sont interdépendantes, peut s’illustrer simplement par l’exemple de la coupure au doigt. «C’est l’ensemble de l’être vivant qui souffre», souligne Bernard Collette.
Il explique que dans la pensée stoïcienne, le rôle de l’humain consiste à réaliser deux tâches. D’abord, contempler le monde, l’étudier et apprendre grâce à cette contemplation. Ensuite, imiter la nature.
«Étudier la nature, dit-il, révèle aux humains que la nature possède une grande beauté et une grande variété. L’imitation de la nature renvoie à l’industrie humaine par le biais des arts, comme l’art agricole. Comme Aristote avant eux, les stoïciens voient dans les productions techniques humaines, une manière d’imiter la nature. Leur fonction est de révéler la variété insoupçonnée du monde.»