
Mary Travers (La Bolduc), Jean Grimaldi et Rudy Vallée
L'une est considérée comme la première auteure-compositrice-interprète du Québec, l'un a ouvert à la voie aux chanteurs de charme et l'autre s'est imposé parmi les plus grands directeurs de tournées de théâtre burlesque. Mary Travers, Rudy Vallée et Jean Grimaldi sont au cœur de Mille après mille: célébrité et migrations dans le Nord-Est américain.
Dans cet ouvrage, qui vient de paraître chez Boréal, Pierre Lavoie aborde le parcours de ces trois artistes en Nouvelle-Angleterre. À travers leurs pérégrinations, il dresse un portrait de l'histoire de l'identité francophone dans cette région des États-Unis. «Mary Travers, Rudy Vallée et Jean Grimaldi sont des figures exemplaires; par leur célébrité et leur renommée dans les médias, ils représentent des groupes, des identités, des collectivités, indique Pierre Lavoie. Ces trois artistes ont vécu la migration ou sont des descendants de migrants, comme c'est le cas de Rudy Vallée.»
De fait, les grands-parents paternels de Rudy Vallée étaient Canadiens français. Ils ont émigré en Nouvelle-Angleterre au cours du 19e siècle. Dans son ouvrage, Pierre Lavoie s'intéresse au rapport du célèbre crooner à ses racines familiales. Un rapport un peu complexe influencé par le contexte sociopolitique de l'époque.
Mary Travers, de son côté, a émigré à Springfield avec sa famille avant de revenir à Montréal en 1922. À partir des années 1930, cette Gaspésienne d'origine a effectué de nombreuses tournées en Nouvelle-Angleterre, modelant ses spectacles pour le public franco-américain.
La chanteuse fera la rencontre de Jean Grimaldi, un immigrant corse qui deviendra son directeur de tournées. Pendant plus de 40 ans, le «patriarche du show-business québécois» travaillera avec un nombre impressionnant d'artistes, contribuant à leur succès au Canada et aux États-Unis.
De ces trois parcours, un constat émane: «L'identité n'est pas un concept figé, mais un processus complexe et changeant, même à l'intérieur d'un groupe dont on a l'impression qu'il est homogène. C'est particulièrement le cas pour les francophones du Nord-Est américain», résume l'auteur.
Outre le thème de l'identité, son livre porte sur l'histoire d'une époque marquée par la démocratisation de l'automobile et l'avènement des industries du disque, de la radio, du cinéma et de la télévision, qui ont contribué à l'essor des trois artistes. «Comme historien, le fait de travailler sur l'identité à partir des médias me permettait d'avoir une nouvelle porte d'entrée pour étudier les nuances et voir de quelles façons les identités sont toujours en mouvement, même lorsqu'elles se forment.»
— Pierre Lavoie
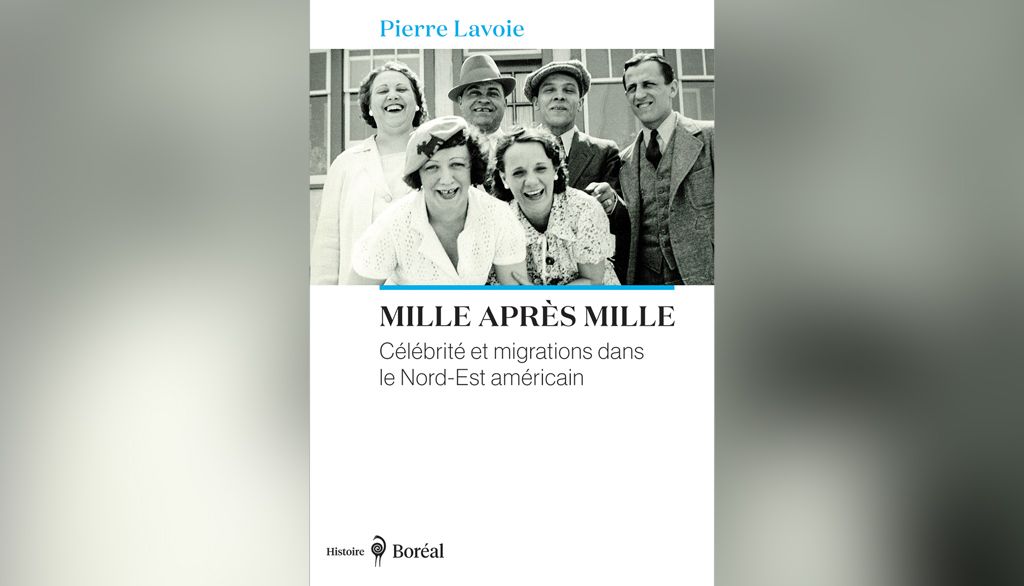
Cet essai de 326 pages est issu d'une thèse de doctorat effectuée à l'Université de Montréal. Pour les besoins de sa recherche, Pierre Lavoie a effectué de nombreux séjours à travers le Québec et aux États-Unis, où il a épluché divers fonds d'archives, en plus d'avoir rencontré la petite-fille de Grimaldi, qui a partagé avec lui archives et souvenirs familiaux.
Des recherches qui se poursuivent
Pierre Lavoie travaille sur un autre projet de recherche en tant que chercheur postdoctoral à l'Université Laval avec les professeurs Martin Pâquet, du Département des sciences historiques, et Sandria P. Bouliane, de la Faculté de musique. Cette fois, il s'intéresse aux répercussions des vedettes françaises du music-hall sur la francité aux États-Unis. On pense ici à Maurice Chevalier, Lucienne Boyer, Édith Piaf, Jean Sablon et Charles Trenet, entre autres.
«Mon but est de comprendre de quelles façons les artistes du music-hall ont contribué à forger ou à changer l'image de la France aux États-Unis. Cette recherche s'inscrit dans la poursuite méthodologique de mon livre. Je continue à travailler sur cette intersection entre des populations qui bougent, des identités qui se forment et des médias qui se développent», conclut le chercheur.


























