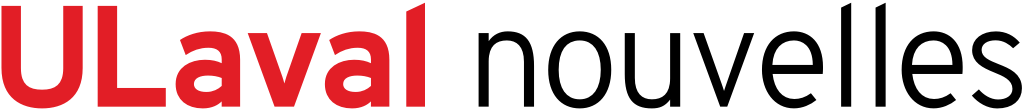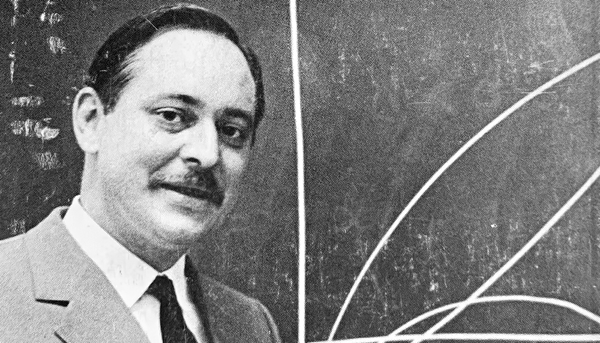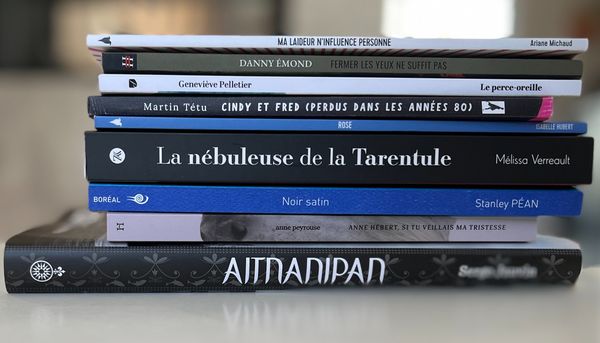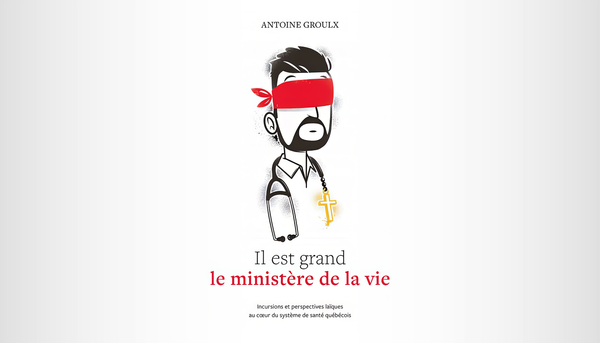Le premier reportage de la journaliste Gabrielle Roy, avant sa carrière d’écrivaine, sur les communautés immigrantes de l’Ouest canadien portait sur une communauté huttérite du Manitoba.
— Ressources numériques de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
«Le village m’enserra de sa paix chaude et imprévue. Il ne possède ni magasin, ni gare, ni pompe à essence, ni même de rues, encore moins d’enseignes; il s’élève dans les champs de blé, parmi les vergers, les ruches, la couleur des avoines et le tenace parfum du trèfle d’odeur; il est dans la lumière et l’abondance comme un riche au milieu de ses biens. Mais ses gens ne font montre d’aucun luxe. Ils sont vêtus, tous, avec une simplicité extrême; les femmes, d’une jupe fort longue et d’une veste fleurie sur un corsage de lustrine noire; les hommes, de blouse bleue.»
C’est ainsi que débutait le reportage de la journaliste Gabrielle Roy sur un village huttérite du Manitoba publié en novembre 1942 dans Le Bulletin des agriculteurs. Ce texte figure parmi une centaine de longs articles publiés par une cinquantaine de journalistes dans les journaux du Canada français entre 1870 et 1945, textes que la doctorante Charlotte Biron a étudiés dans le cadre d’une thèse en cotutelle en études littéraires sur le reportage littéraire au Québec. La soutenance a eu lieu début mars.
«Durant la période étudiée, explique-t-elle, le journaliste est souvent écrivain et vice-versa. En faisant ma recherche, je découvrais des textes publiés dans des journaux peu connus qui me frappaient. J’ai eu accès à des textes que je trouve incroyables avec beaucoup de relief.»
Dans la seconde moitié du 19e siècle, les grands reporters français et les journalistes littéraires américains couvraient de grands événements. Pensons notamment à la guerre franco-prussienne ou à la guerre de Sécession. Au Canada, sur un immense territoire très peu peuplé et stable politiquement, les sujets de reportage étaient d’un autre ordre.
La thèse de Charlotte Biron vient combler un vide dans l’histoire de la littérature québécoise en révélant la richesse du grand reportage durant trois quarts de siècle. On peut penser notamment aux articles sur le tour du monde que Lorenzo Prince et Auguste Marion, deux journalistes de La Presse, ont réalisés en 1901 à l'occasion d’un concours international inspiré du roman Le Tour du monde en quatre-vingts jours, de Jules Verne. Ou bien à l’enquête que Jules Fournier, journaliste au journal Le Canada, a menée en 1905 sur les Franco-Américains immigrés en Nouvelle-Angleterre. Cette enquête a donné lieu à 18 articles.
«Des travaux de recherche ont été menés sur les journalistes canadiens-français, précise la doctorante, mais rien sur les reportages eux-mêmes.»
Buies, l’ancêtre du grand reportage au Québec
Deux «écrivains journalistes» se distinguent dans son corpus: Arthur Buies et Gabrielle Roy. Selon elle, Buies incarne l’ancêtre du grand reportage au Québec. Il a été particulièrement actif entre 1870 et 1890. La série d’articles qui a attiré l’attention de la doctorante s’intitule Deux mille deux cents lieues en chemin de fer. Son périple, Buies l’entreprend à Montréal. Il se rend jusqu’en Californie puis revient au Québec, plus précisément à Québec. Son premier texte paraît dans L’Opinion publique du 30 juillet 1874. «On le connaît beaucoup comme le chroniqueur du Canada français de son temps, souligne Charlotte Biron. À son époque, le journalisme était beaucoup basé sur l’éloquence et le dialogue. Buies, un homme cultivé, s’adressait à une petite partie de la population, elle-même instruite. Dans ses reportages, il avait un rapport important et documenté au territoire. Ce rapport était problématique. Buies plaçait le réel entre un passé colonial français très idéalisé et un futur meilleur pour les Canadiens français. Il a notamment fait la promotion de la colonisation en Abitibi dans ses articles. On retiendra la densité introspective de ses voyages.»
L’extrait suivant est tiré du premier texte de Deux mille deux cents lieues en chemin de fer. À cette époque, le terme «reportage» n’est pas encore pleinement en usage. Le texte se lit comme une sorte de voyage journalistique, une forme très répandue dans les journaux. L’ensemble de la série est paru en plusieurs livraisons après le voyage de Buies, et ce, dans deux périodiques différents, L’Opinion publique et Le National.
«Ce n’est qu’arrivé sur les hauteurs de la Sierra Nevada, entre l’Utah et la Californie, que cette grande nature tant promise, tant attendue, s’est révélée enfin. Oui, c’est beau, certes, ce passage à huit mille pieds au-dessus de la mer, sur le bord de précipices effrayants, lorsqu’on est entouré de pics couverts de neiges éternelles et que, sous le regard, s’ouvrent subitement des abîmes qui ont quinze cents pieds de profondeur; mais je n’aurais pas donné pour tout cela le petit coteau de la Malbaie, ce paradis de notre pays, cette oasis oubliée parmi les rudesses grandioses et choquantes du Canada.»
Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale
La série de grands reportages réalisée par Gabrielle Roy dans la première moitié des années 1940, et qui a piqué la curiosité de Charlotte Biron, a pour titre général Peuples du Canada. La future écrivaine documente la vie des communautés immigrantes de l’Ouest canadien. «Ces articles, publiés dans Le Bulletin des agriculteurs, sont très beaux, soutient la doctorante. On remarque la lucidité et l’intimisme de son écriture. Elle est dans une logique de montrer le réel, dans un rapport assez objectif.»
La période couverte par la thèse inclut les deux guerres mondiales. Le corpus contient des textes de deux journalistes qui se sont enrôlés sous les drapeaux durant le conflit de 1914-1918. Il contient aussi des articles des journalistes Marcel Ouimet et Simone Routier réalisés durant la guerre de 1939-1945. «Les textes de Marcel Ouimet paraissent dans La Revue moderne, explique Charlotte Biron. Ce correspondant de guerre de Radio-Canada faisait du journalisme écrit en même temps que de la radio. Simone Routier vivait à Paris lorsque le conflit a éclaté. Elle est rentrée au Canada en 1940. Son journal d’évacuation a paru en journal, avant d’être publié en livre sous le titre Adieu, Paris!»
Lisez deux reportages intégraux en format PDF
Peuples du Canada (Gabrielle Roy)
Ohé! Draveurs (Eva Senécal)