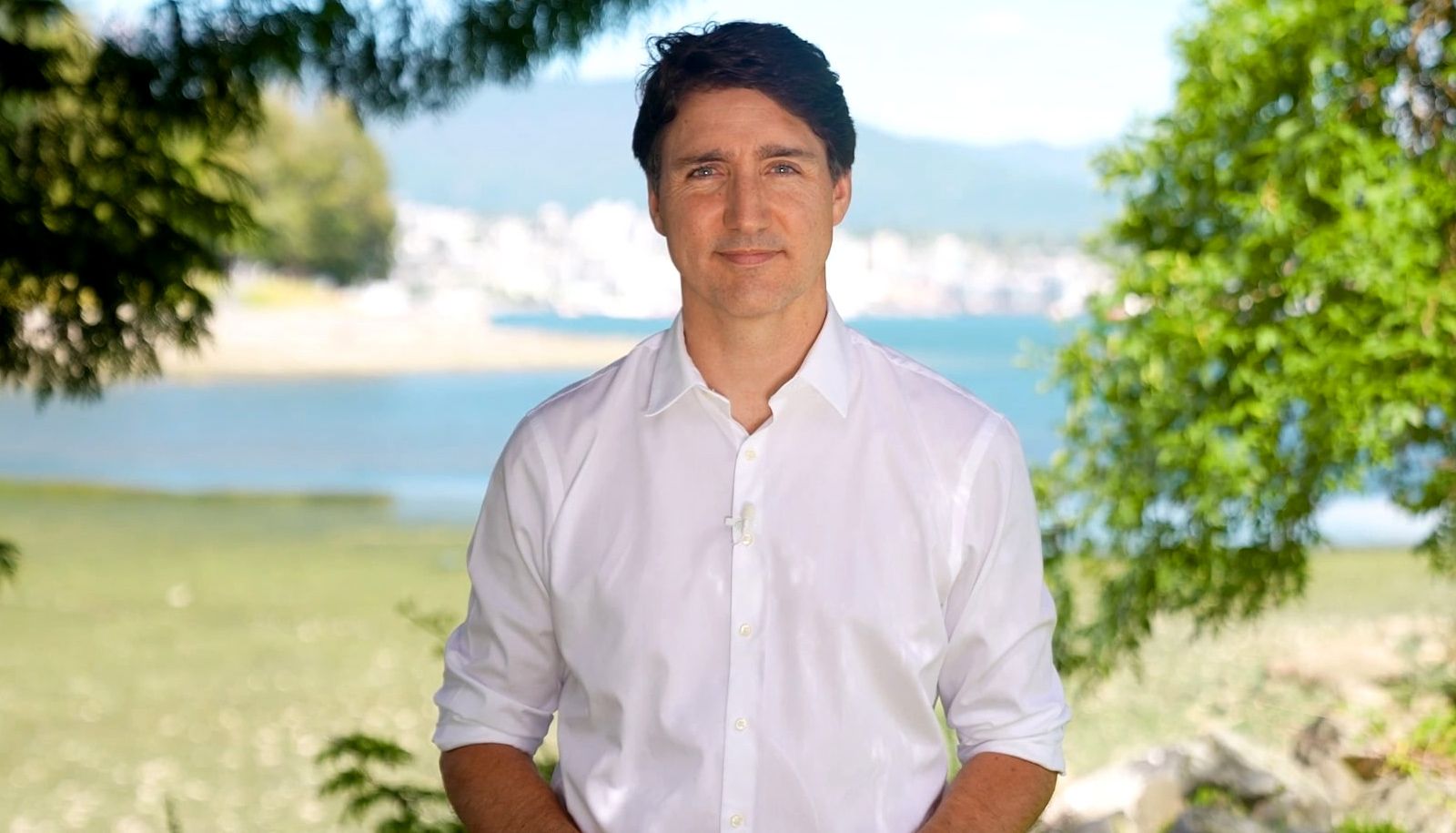Situé en basse-ville de Québec, le quartier Saint-Sauveur connaît une revitalisation qui séduit plusieurs jeunes familles et professionnels.
L'étudiante, dont le projet est encadré par la professeure Émilie Raymond, a interviewé 15 résidents, commerçants et acteurs communautaires. Les participants ont pris part à des entrevues individuelles de même qu'à une rencontre de groupe. Les échanges ont permis d'aborder diverses facettes de ce sujet qui soulève les passions. «Souvent, les médias présentent la gentrification comme étant soit négative, soit positive. En réalité, ce phénomène n'est pas noir ou blanc. Comme j'ai pu le constater dans mes entrevues, il est beaucoup plus complexe», soutient celle qui a été marquée par le fort sentiment d'appartenance qui unit les gens au quartier.
Qu'ils soient pour ou contre, tous s'entendaient sur une chose: la gentrification a ses bons côtés. Entre autres, des projets de verdissement ont été réalisés, de nouvelles places publiques éphémères ont fait leur apparition et l'offre de transport en commun a été améliorée. L'image de marque ayant fait son œuvre, plusieurs utilisent désormais le terme «St-So» pour faire référence à tous ces changements. «Le terme “St-So” est un bon exemple de la revalorisation symbolique qui s'effectue dans le quartier, remarque l'étudiante. Des préjugés subsistent sur Saint-Sauveur, notamment par rapport à la criminalité et à la pauvreté. L'utilisation de ce terme vient marquer la renaissance du quartier et démontrer que les choses ont changé.»
Si la gentrification n'est pas «mauvaise en soi», pour reprendre l'expression de l'une des résidentes interviewées, il n'empêche que cette tendance ne fait pas que des heureux. Certains participants ont déploré que les nouveaux commerces ne s'adressent qu'à une clientèle plus aisée. D'autres se sont inquiétés de la transformation massive du secteur avec l'arrivée de gros projets immobiliers. De petites maisons, témoins de l'histoire ouvrière du quartier, sont rasées pour faire place à des condos et des logements en hauteur. «L'importance de rénover et non de démolir est un gros enjeu. Les gens ne veulent pas que le paysage se transforme complètement. Ils veulent conserver la mixité entre les bâtiments à l'origine de l'identité de Saint-Sauveur. Plusieurs belles maisons centenaires se font démolir, ce qui suscite de la frustration et des craintes que la situation dégénère davantage», relate Héloïse Baril-Nadeau.
À maintes reprises, il a été question de la démolition du Centre Durocher. Il y a deux ans, ce centre communautaire a été détruit pour y construire un immeuble d'habitation. «À la base, je n'avais aucune question sur le Centre Durocher dans ma grille d'entrevue, mais pratiquement tous les participants m'en ont parlé. Ils sont encore très émotifs par rapport à sa disparition. Pour eux, le Centre Durocher était le cœur du quartier; il avait une fonction historique et symbolique. Sa démolition est l'un des exemples de changements qui ne sont pas souhaités par plusieurs personnes.»
Pour l'étudiante, ces entretiens ont permis aux participants de se faire entendre et de réfléchir, tous ensemble, aux moyens d'atténuer les effets néfastes de la gentrification. «Il y a des craintes par rapport à l'avenir, mais il y a aussi beaucoup d'optimisme. Saint-Sauveur peut être considéré comme étant au début de son processus de gentrification; les cartes ne sont pas toutes jouées. Il y a possibilité pour les différents groupes d'acteurs de se rencontrer et de discuter afin de s'assurer d'avoir une vision commune du quartier», conclut-elle.