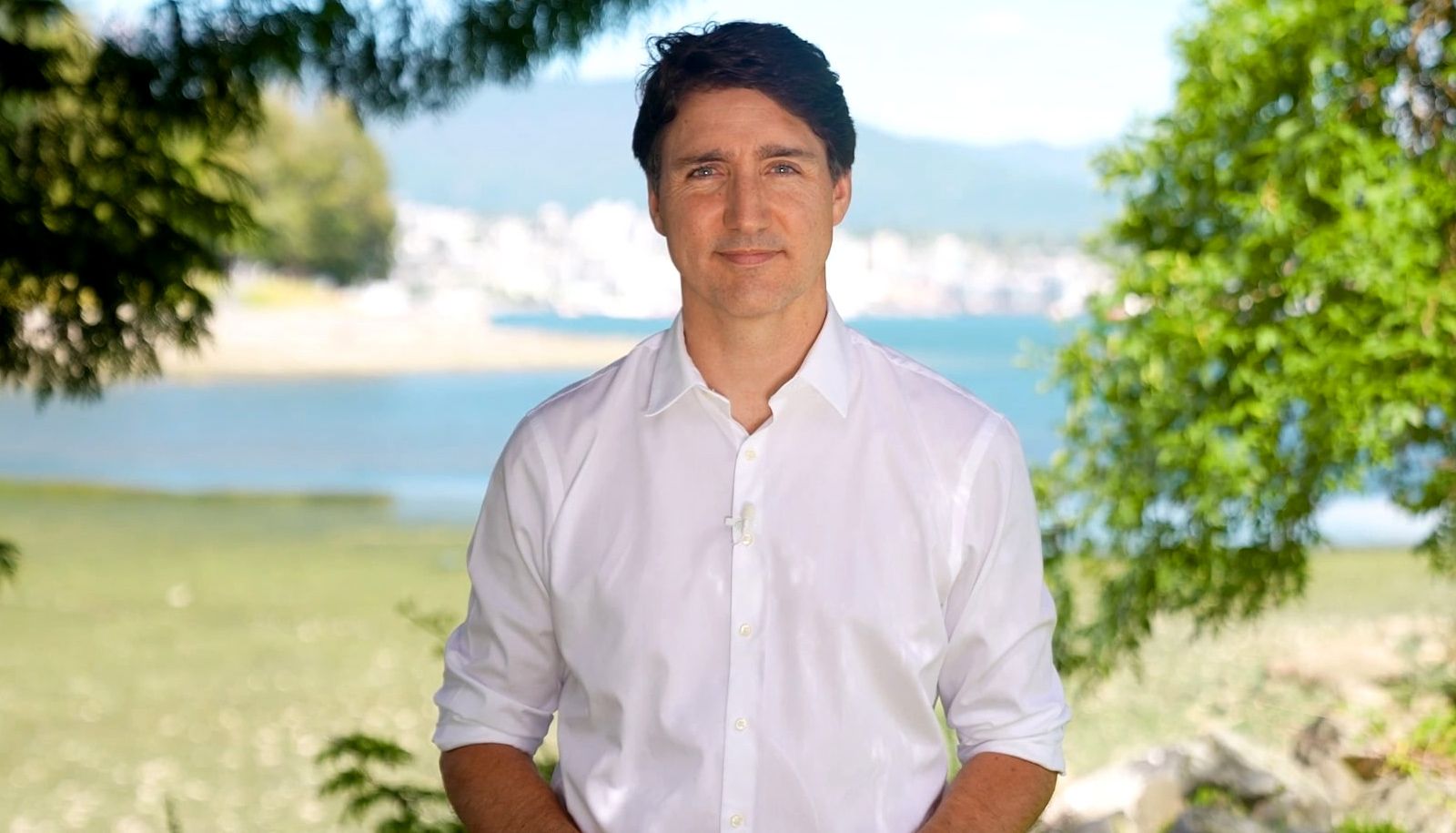Bien qu'elle constate qu'une certaine période de «transition» soit amorcée, la présidente du Conseil du statut de la femme, Julie Miville-Dechêne, estime qu'il reste tout de même du chemin à faire pour atteindre l'égalité des sexes au Québec.
— Marc Robitaille
Julie Miville-Dechêne a nommé plusieurs manifestations de ce déséquilibre entre droit et faits, dont certaines touchaient particulièrement la réalité étudiante. «Dans les facultés universitaires, les femmes comptent pour 60% des effectifs étudiants. En contrepartie, le revenu d'emploi des femmes qui travaillent à temps plein correspond à 75% de celui des hommes», a mentionné la présidente. Autre fait: les finissantes au MBA à la recherche de leur premier emploi se voient proposer un salaire annuel de 8 000$ inférieur à celui offert aux finissants masculins. «Historiquement, la société a accordé une valeur différente à certains métiers associés aux hommes. Devant ces croyances qui perdurent, les lois sont impuissantes», a constaté la conférencière.
Comme difficulté supplémentaire, Julie Miville-Dechêne a fait état de la discrimination qui s'exerce, au moment d'entretiens d'embauche, envers les travailleuses ayant des enfants ou en âge d'en avoir. Elle s'appuyait sur des extraits du livre de la journaliste Nathalie Collard, Qui s'occupe du souper?, qui traite de la conciliation travail-famille et dans lequel une chasseuse de tête révèle que les gestionnaires hésitent à embaucher une femme en âge de procréer. La présidente n'a pas manqué de mettre en garde ses auditrices: «Je ne veux pas vous décourager, mais vaut mieux préparer vos stratégies, car cette réalité, bien que difficile à prouver, existe.» Un meilleur partage des congés parentaux pourrait diminuer une telle forme de discrimination, croit-elle.
Cela dit, aux yeux de Julie Miville-Dechêne, l'aspect le plus troublant de l'inégalité homme-femme se situe du côté de la violence sexuelle. «Sur les 5 500 agressions dénoncées à la police en 2013, 80% des victimes étaient des femmes, relate-t-elle. En outre, on estime qu'une agression sur 10 est rapportée aux autorités. On a beau avoir renforcé les textes de lois entourant les notions de viol et de consentement, tant que la dénonciation demeure aussi ardue, on cesse d'avancer», a fait valoir la présidente.
Réagissant à la présentation, l'étudiant à la maîtrise en droit, Christophe Achdjian, a souligné la nécessité de confronter perception et réalité lorsqu'il est question d'égalité homme-femme: «On entend dire que l'égalité entre les sexes est une affaire réglée au Québec. Pourtant, quand on appuie notre réflexion sur des données chiffrées, on se rend compte qu'elle ne l'est pas tant que ça». Étudiante au même programme, Catheryne Bélanger s'est sentie concernée en tant que juriste: «On constate que malgré les lois, des situations d'abus demeurent. Comment faire pour que l'application du droit et l'équité homme-femme se complètent mieux?»
À plusieurs reprises, Julie Miville-Dechêne a parlé de période de «transition» pour qualifier notre époque en matière d'égalité des sexes. Relevant au passage des initiatives qu'elle juge encourageante, comme le récent mouvement Agression non dénoncée, qui a donné l'occasion aux femmes de prendre la parole sur les médias sociaux, la présidente admet toutefois qu'il reste du chemin à faire. «Les hommes comme les femmes sont encore enfermés dans des stéréotypes. Réalité historique, éducation, il y a plusieurs raisons à cela. À cet égard, ce ne sont pas les lois qu'il faut changer, mais les mentalités. Et cela demande beaucoup de temps», a-t-elle conclu.