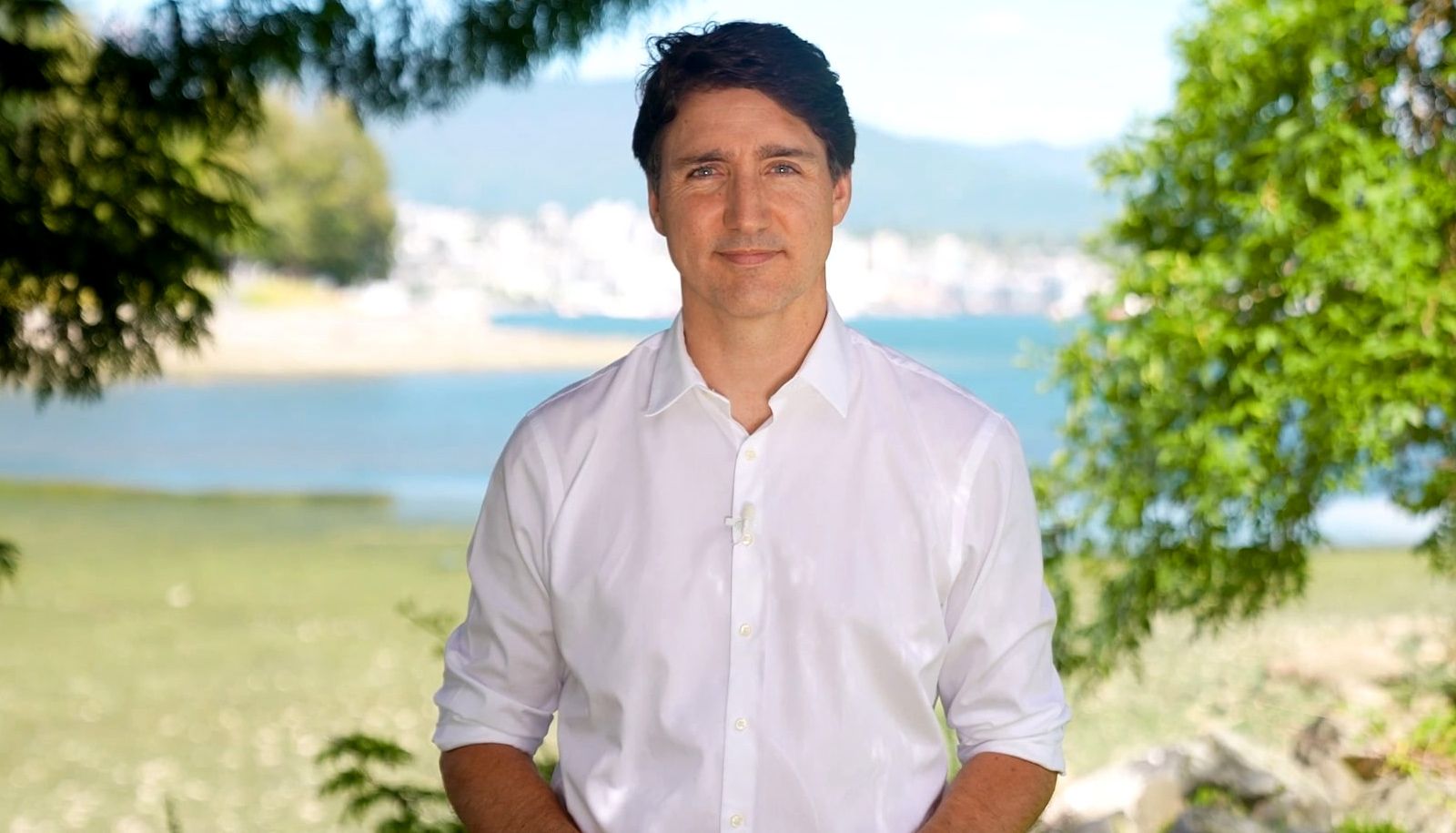L'artiste peintre paysagiste Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté posant dans son atelier parisien en juillet 1904. Il a vécu en France de façon quasi ininterrompue entre 1897 et 1907.
Le vendredi 5 novembre au Musée de la civilisation, Katarzyna Basta fera un exposé sur l’exil volontaire en France de plusieurs artistes québécois, ainsi que sur l’importance que l’institution muséale accorde à ce séjour. Elle fera sa communication à l’occasion d’un colloque international sur l’histoire des migrations des francophones. Vers la fin du 19e siècle, quelque 200 artistes canadiens francophones et anglophones ont choisi Paris comme destination pour leur formation artistique. «Durant cette période, rappelle-t-elle, les peintres canadiens sont très bien représentés au Salon officiel de Paris, car plus de 200 œuvres sont attribuées à une soixantaine de peintres d’ici.»
Chez ces artistes, la notion d’exil n’avait pas toujours le sens habituel et négatif de perte du pays et de déracinement. «L’exil ou le séjour prolongé à l’étranger peut aussi prendre une forme plus poétique et romantique, et être représenté par l’image de l’artiste qui quitte son pays à la recherche d’inspiration et de liberté d’expression», souligne Katarzyna Basta. L’exil ou le séjour prolongé à l’étranger peut même avoir un effet positif sur la construction de la reconnaissance artistique et publique. «Par exemple, dit-elle, Suzor-Coté et Clarence Gagnon (1881-1942), ce dernier passant au total 17 années en France, ont réussi à tirer profit de leur séjour à l’étranger pour se construire une carrière au Québec.»
Selon Katarzyna Basta, ce n’est pas un hasard si les artistes québécois choisissent la France comme terre d’accueil pour leur exil artistique, et principalement Paris comme lieu de formation. «Outre l’excellence de l’enseignement artistique français, indique-t-elle, les liens historiques communs qui unissent les deux peuples sur les plans linguistique, religieux et culturel ont favorisé cette migration.» Pour certains, comme Rodolphe Duguay (1891-1973) qui passa sept ans à Paris dans les années 1920, le déracinement fut plutôt pénible. «Duguay, précise-t-elle, était conscient de l’importance d’un séjour à Paris pour sa carrière. Issu d’un milieu rural et catholique, il souligne plusieurs fois, dans ses carnets intimes, le danger que représente pour sa foi la vie dans une ville aussi moderne.»
Après la guerre
Après la Seconde Guerre mondiale, les artistes québécois qui s’exilaient en France l’ont fait davantage pour s’affranchir d’une société qui brimait leur liberté d’expression. «Même si Paris a perdu, avec les années, son prestige et sa position de capitale symbolique de l’art, pour les artistes québécois de cette génération, la Ville lumière reste pour eux synonyme de liberté», explique Katarzyna Basta. Selon elle, la situation sociopolitique du Québec, la politique du gouvernement de Duplessis, la censure et les restrictions liées au pouvoir du milieu catholique se reflétaient dans la vie culturelle. «De plus, poursuit-elle, l’enseignement de l’art est encore très académique, les critiques d’art, les collectionneurs et les institutions muséales sont peu nombreux, le marché de l’art est trop petit, enfin les commandes publiques sont vraiment rares.»
Signataire du manifeste du Refus global, l’artiste peintre Marcelle Ferron (1924-2001) quitte le Québec en 1953. Elle vivra 13 ans en France avant de rentrer dans un Québec en mutation. Elle a déclaré: «Il n’y a jamais une seule raison pour émigrer. Le moteur de notre pensée, c’était place à la création, place à la magie, place à l’amour, place au changement. Il fallait vivre, se nourrir intellectuellement. Et la nourriture, on la cherche là où elle se trouve.»