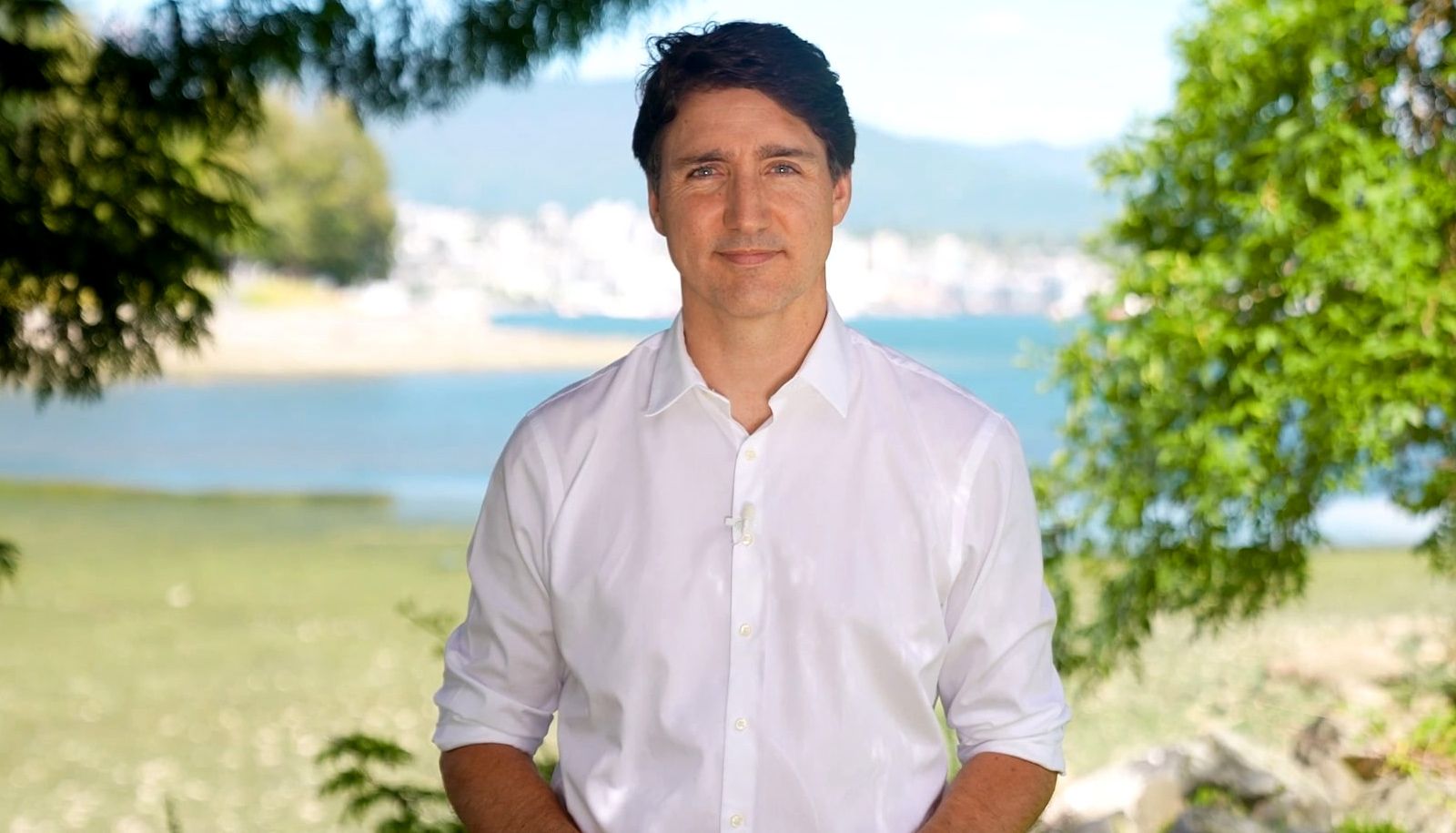Les figures de Louis Cyr, Dédé Fortin, Robert Piché et Karla Homolka sont comparables. Elles sont durables et leur visibilité est étendue. Ce sont des symboles, des incarnations de l’exceptionnel qui doivent leur exposition médiatique non pas à leur profession, mais à ce qu’elles font, sont ou créent. Elles ont aussi en commun d’avoir généré de fortes réactions collectives et affectives. C’est en cela qu’elles sont à la fois des célébrités et des figures de la grandeur. Leurs récits le disent clairement: le Québec a fait de Fortin un génie, de Piché un héros, de Cyr un champion et d’Homolka un monstre. Cette dernière est grande dans le mal comme les trois autres le sont dans le bien.
— Photo de Robert Piché: robertpiche.com
En 2000, à Montréal, André «Dédé» Fortin, chanteur du groupe québécois Les Colocs, est trouvé mort dans son appartement. Un an plus tard, au-dessus de l’Atlantique, Robert Piché pilote un avion qui tombe subitement en panne. En 2005, Louis Cyr, célèbre homme fort de la fin du 19e siècle québécois, fait l’objet d’une biographie. La même année, Karla Homolka, qui a participé au meurtre de deux adolescentes, sort de prison.
Ces quatre figures célèbres ont marqué l’actualité québécoise. Elles se trouvent au cœur de l’essai Les métamorphoses de la grandeur. Cet ouvrage de 584 pages a été publié récemment aux Presses de l’Université de Montréal.
«Dans mon livre, j’ai cherché à comprendre l’imaginaire de la société québécoise, explique Alex Gagnon, chercheur postdoctoral au Département de littérature, théâtre et cinéma de l’Université Laval. Les figures célèbres sont des objets de recherche privilégiés parce qu’elles suscitent des réactions fortes. Elles fournissent à une société l’occasion d’exprimer ses affects, ses valeurs, ses obsessions. Bref, à cristalliser les préoccupations de leur époque.»
Selon lui, les quatre personnalités étudiées n’ont rien en commun au premier regard. «Sur le plan fonctionnel, soutient-il, tout les distingue: l’artiste, l’aviateur et l’athlète appartiennent à des univers sociaux radicalement différents et sont presque aussi loin les uns des autres qu’ils le sont ensemble de la criminelle. Au-delà de ces disparités, les quatre figures ont beaucoup de choses en commun. Elles ont atteint au Québec, et parfois aussi au Canada, une célébrité durable. Leur visibilité est étendue. Ce sont des symboles, des incarnations de l’exceptionnel qui doivent leur exposition médiatique non pas à leur profession, mais à ce qu’elles font, sont ou créent. Elles ont aussi en commun d’avoir généré de fortes réactions collectives et affectives.»
Le chercheur a construit un corpus impressionnant dans sa recherche documentaire. Rien n’a été laissé au hasard dans tout ce qui a fait exister les quatre personnages dans l’espace public québécois, de la toute première apparition médiatique jusqu’au 31 décembre 2019. Des articles de journaux aux émissions de radio, des photographies de presse aux caricatures, des romans aux films, des cérémonies aux événements publics, jusqu’aux lettres d’admirateurs déposées à la porte de Dédé Fortin ou envoyées à Robert Piché, rien n’a été exclu.
Le cas de Dédé Fortin est éloquent à cet égard. «Le suicide d’André Fortin, dit-il, a laissé dans le deuil un cortège de fans affligés. On lui a rendu régulièrement hommage par des spectacles ou d’autres événements. Les journalistes de la presse écrite ont publié des rétrospectives et souligné la force et les richesses de son œuvre, tout en manifestant leur tristesse, voire leur détresse. Mais surtout, ses fans lui ont écrit. De nombreux admirateurs et admiratrices ont déposé devant son appartement des poèmes, des lettres d’adieu, des mots variés dans lesquels ils remerciaient l’artiste pour son œuvre, dans lesquels ils exprimaient leur amour, leur détresse, leur sentiment de solitude. Son suicide, alors qu’il était au sommet de sa gloire, a empêché son personnage public de vieillir. En associant grandeur et malheur, ce geste fatal en a fait une figure sacrée, il l’a fait entrer dans le groupe des artistes maudits.»
Le «héros», le «champion» et le «monstre»
Au service d’Air Transat, le pilote et commandant de bord Robert Piché a sauvé 305 passagers en faisant atterrir son avion en panne aux Açores. Les réactions collectives se manifestent dès la semaine suivant son exploit, en août 2001, alors que les journaux dévoilent son incarcération aux États-Unis pour trafic de drogue au début des années 1980.
«Le public s’indigne fortement à l’égard des médias, accusés de “salir le héros”, explique Alex Gagnon. Piché reçoit de ses admirateurs de nombreuses lettres d’appui, et plusieurs lecteurs écrivent aux journaux pour dénoncer leur traitement “indigne” de l’affaire, et pour célébrer le pilote “héroïque”. Après la publication de sa biographie en 2002, Piché devient un modèle de détermination et une source d’inspiration pour le public. Ce phénomène se renforce après 2005, alors que son alcoolisme, qu’il combat, est dévoilé publiquement. Il devient un modèle de l’individu fort et déterminé, capable de vaincre ses démons et de surmonter les difficultés de son destin.»
Louis Cyr devient une grande vedette vers 1890. Sa popularité découle de ses exploits sportifs relayés par l’avènement du journalisme de masse et la diffusion de la photographie dans les journaux. À Montréal, l’homme fort est consacré par les institutions politiques et reçoit des récompenses honorifiques. Ses spectacles sont vus par des milliers d’admirateurs. Il est célébré dans les journaux. «Pour nombre de ses contemporains, indique le chercheur, et notamment pour une partie de l’élite francophone de l’époque, il incarne la puissance de la “race” canadienne-française et l’affirmation nationale sur une scène largement dominée par l’Angleterre, celle du sport et de l’athlétisme. À sa mort en 1912, un convoi dans les rues de Montréal souligne la grandeur du personnage.»
Selon Alex Gagnon, Cyr n’a jamais cessé d’être un modèle d’affirmation et de force, de force physique pour le public masculin, bien sûr, mais aussi et par extension de force morale, surtout à partir du milieu du 20e siècle. Il est aussi resté une source de fierté nationale, pour le public canadien-français et québécois. «Depuis les années 2000, poursuit-il, Cyr a inspiré plusieurs livres pour enfants, où il apparaît clairement comme un modèle, dont plusieurs auteurs tentent de faire une source d’inspiration pour la jeunesse.»
Les meurtres auxquels participe Karla Homolka ont lieu en Ontario entre 1990 et 1992. En 2005, au terme de sa peine, elle sort de la prison pour femmes de Joliette, au Québec, où elle était incarcérée. Sa sortie sème la panique dans la région montréalaise, où elle refait sa vie.
«Karla Homolka réactualise la femme fatale du cinéma noir du milieu du 20e siècle, affirme le chercheur. C’est aussi la figure de la sorcière, de l’empoisonneuse dans les fictions du 19e siècle. C’est une sorte de monstre en jupons, un monstre à deux faces contradictoires, profondément scabreuse à l’intérieur et à l’apparence trompeuse.»
Des téléséries de fiction et des téléséries documentaires ont été tournées sur l’affaire Homolka. Dans le cours de sa recherche documentaire, Alex Gagnon a pu consulter les lettres citoyennes envoyées au Solliciteur général du Canada à ce sujet. Il a aussi fouillé sur les réseaux sociaux afin d’y étudier le discours sur la meurtrière.
«Indignation, peur, colère, les réactions du public au Québec, au moment de sa sortie de prison, sont assez comparables à celles du public des autres provinces, souligne-t-il. Cette affaire met en lumière un durcissement dans l’évolution de la sensibilité en matière pénale.»
La fabrication de la célébrité
Selon le chercheur, les mécanismes de fabrication de la célébrité sont partout les mêmes. «La célébrité est une visibilité, explique-t-il, c’est-à-dire qu’elle est toujours le résultat d’une grande quantité d’exposition médiatique. Pas de célébrité possible sans médias de grande diffusion. La célébrité, c’est le fait d’être constamment visible dans un espace public qui dépasse le cercle de ses connaissances personnelles. Les célébrités sont, au fond, des individus qui ont accumulé une grande quantité de cette ressource particulière qu’est la visibilité et qui peuvent en tirer un certain nombre d’avantages sociaux, même si elle a aussi ses inconvénients.»
L’un des traits centraux du vedettariat est l’exploration de la vie privée, la recherche de l’individu ordinaire derrière la grande vedette, c’est-à-dire l’individu extraordinaire. «Cette exploration du privé se nourrit, par exemple, par la logique de la confidence, de l’entrevue, de la biographie ou du témoignage», poursuit-il.
Dans son livre, Alex Gagnon met de l’avant le concept de l’«économie morale de la dette». «D’un point de vue anthropologique, dit-il, toute la relation que nos sociétés entretiennent avec les célébrités repose sur cette idée. Celle-ci s’explique par le fait que les individus qui ont atteint le statut de vedettes sont perçus par le public comme ayant fait un “don” à la collectivité, comme le don d’une grande œuvre dans le cas de Dédé Fortin. En échange la collectivité, qui est dès lors d’une certaine façon endettée à l’égard de la vedette, ressent le besoin et la nécessité de répondre à ce don par un “contre-don”, d’où l’admiration que la collectivité porte à la vedette, qui est sa manière de donner en retour.»