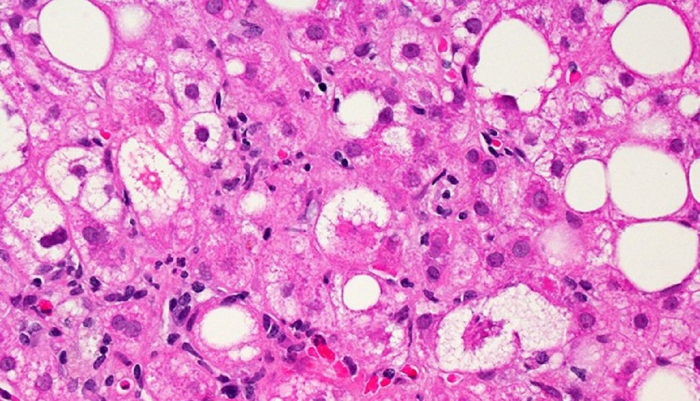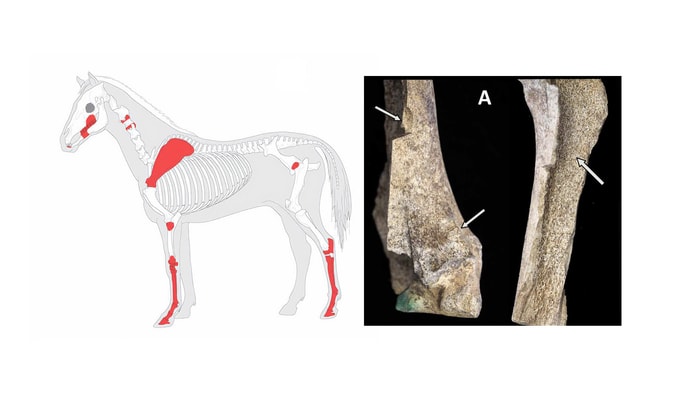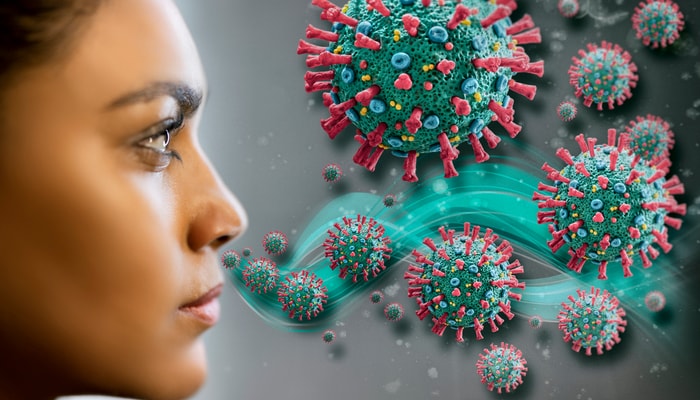— Getty Images/Design Pics
Quelle serait votre réaction si vous appreniez que votre mère ou votre grand-mère, qui vit dans un centre d'hébergement, s'y est fait un ami avec qui elle a une forme d'intimité sexuelle? Cette idée vous choque-t-elle? Pensez-vous que les membres de votre famille devraient intervenir? Croyez-vous que le personnel du centre a fait montre de négligence en permettant qu'une telle chose se produise?
«La sexualité des personnes âgées est encore un sujet tabou auquel sont associés de nombreux stéréotypes, commente Dominique Giroux, professeure à l'École des sciences de la réadaptation de l'Université Laval. On croit, à tort, que les personnes âgées sont asexuées, qu'elles n'ont pas de désirs ou de besoins sexuels, et on considère négativement l'expression de leurs comportements sexuels. En centre d'hébergement, il n'est pas rare que l'on associe l'expression sexuelle à une forme de désinhibition ou à des problèmes comportementaux.»
La sexualité est une composante importante du bien-être tout au long de la vie, rappelle la professeure Giroux. «On estime qu'une personne a une bonne qualité de vie sexuelle lorsqu'elle peut adopter des comportements qui lui permettent de répondre de façon satisfaisante à ses besoins physiques, psychologiques et sociaux.»
Les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et les maisons des aînés reconnaissent-ils les besoins sexuels des personnes âgées et que font-ils pour les accommoder? C'est ce que la professeure Giroux et 7 autres chercheuses et chercheurs ont tenté de déterminer en passant en revue 11 études et 49 rapports, thèses et documents divers publiés sur le sujet au cours des 20 dernières années. Dans un deuxième temps, l'équipe a mené des consultations auprès de 26 personnes vivant ou travaillant dans des CHSLD au Québec.
«Dans notre étude, l'expression de la sexualité incluait, au-delà du rapport sexuel lié à la génitalité et de l'autostimulation, l'intimité et les relations affectives avec une autre personne, précise la professeure Giroux. Nous avons constaté que les besoins sexuels des résidents sont souvent négligés dans les CHSLD. La sexualité est encore perçue comme une question délicate, un problème comportemental qui doit être géré par l'intervention d'un professionnel. Ce n'est pas encore intégré dans les besoins de base essentiels de la personne. Le résultat est qu'il existe encore de nombreuses barrières qui nuisent à la qualité de vie sexuelle des résidents.»
Cinq types de barrières
L'équipe de recherche a identifié 5 types de barrières, qu'elle présente dans un article publié récemment par l'International Journal of Sexual Health. Le premier regroupe les barrières sociétales causées par l'âgisme, le sexisme ou les croyances et attitudes à l'égard de la sexualité des personnes âgées.
Le second type de barrières est de nature scientifique. «Parmi l'ensemble des documents recensés, nous avons relevé seulement 11 études qui portent sur la question. Il n'existe donc pas beaucoup de données probantes pour définir les meilleures pratiques pour améliorer la qualité de vie sexuelle des résidents. Cela complique la prise de décisions par les gestionnaires et la formulation de lignes directrices à l'intention du personnel. Le résultat est que les centres prennent des décisions au cas par cas», constate la professeure Giroux.
Le corolaire de cette absence de lignes directrices conduit à un autre type de barrières auxquelles sont confrontés les membres du personnel. «D'une part, ils craignent les plaintes et les sanctions si leurs interventions par rapport à certains comportements sexuels des résidents sont jugées inappropriées. D'autre part, il y a souvent un inconfort à discuter du sujet avec les résidents et avec les membres de leur famille. Enfin, les préjugés des membres du personnel face à la sexualité des personnes âgées peuvent conduire à une forme de surprotection à l'endroit des résidents, surtout ceux qui ont des problèmes cognitifs.»
Il existe aussi des barrières organisationnelles et logistiques. «L'horaire rigide des soins et les visites fréquentes des préposés et du personnel laissent peu de place à l'intimité et à la spontanéité. De plus, l'environnement physique des CHSLD n'a pas été pensé en fonction des besoins d'intimité des résidents», observe Dominique Giroux.
Enfin, le dernier type de barrières touche les personnes âgées elles-mêmes et leur famille, signale la chercheuse. L'état de santé des résidents ainsi que leurs expériences passées, leurs valeurs, leurs attitudes en lien avec la sexualité peuvent nuire à leur qualité de vie sexuelle.
— Dominique Giroux
Adopter une culture d'ouverture face à la sexualité
Il reste donc beaucoup de travail à faire pour aplanir les barrières qui font obstacle à la qualité de vie sexuelle des personnes qui vivent en centres de soins de longue durée, constate la professeure Giroux. «Il faut d'abord adopter une culture d'ouverture face à la sexualité des résidents et se doter de lignes directrices claires qui vont en ce sens et auxquelles le personnel peut se référer en cas de doute. Il faut aussi faire de l'éducation auprès du personnel et des familles afin d'améliorer leurs connaissances sur la sexualité des personnes âgées et de leur faire prendre conscience de leurs préjugés et de leurs biais par rapport à ce sujet. Enfin, il faut s'assurer que le désir d'intimité des résidents soit respecté en adaptant l'environnement physique et les pratiques organisationnelles à leurs besoins.»
Les autres signataires de l'étude publiée dans l'International Journal of Sexual Health sont Nancy Fullerton, Félix Pageau et Julie Beauchamp, de l'Université Laval, Ana Martin, du CISSS de Chaudière-Appalaches, Louis-Pierre Auger, de l'Université McGill, Sarah-Émilie Godin, de l'Université de Montréal, et Karine Latulipe, de l’Université TÉLUQ.