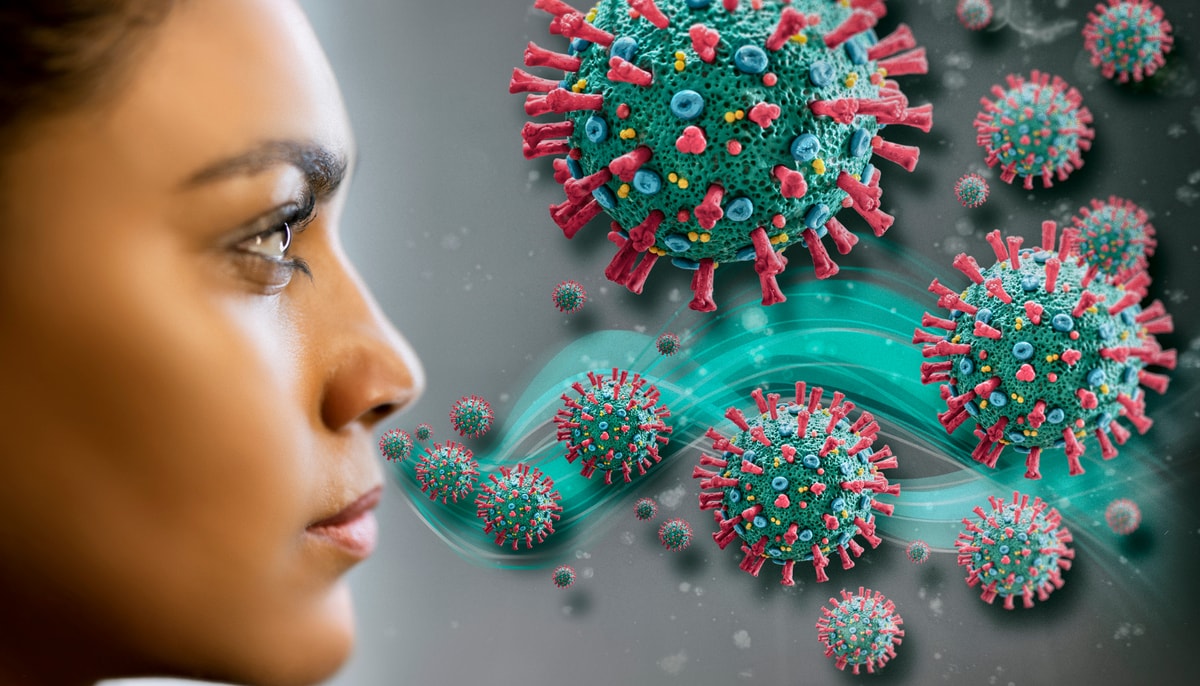
La réponse immunitaire contre les infections est généralement plus robuste chez les femmes. Cela permettrait une résistance contre l'infection, mais cette hyperactivation immunitaire pourrait engendrer plus d'inflammation et endommager plus sévèrement les vaisseaux sanguins.
— Getty Images/Grafissimo
La perte d'élasticité des vaisseaux sanguins qui accompagne le vieillissement normal serait accélérée chez les femmes à la suite d'une infection à la COVID-19. Dans le pire des cas, l'accroissement de la rigidité vasculaire qui en résulte est comparable à celui qui survient naturellement sur une période de 10 ans, rapporte une équipe internationale de recherche dans une étude publiée par l'European Heart Journal.
Cette équipe, dont font partie Mohsen Agharazii et Catherine Fortier, de la Faculté de médecine de l'Université Laval et du Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval, a étudié la rigidité vasculaire de près de 2100 personnes réparties dans 18 pays.
L'échantillon était composé de trois groupes de sujets qui avaient eu la COVID-19: les premiers n'avaient pas été hospitalisés (la plupart avaient eu une infection légère), les seconds avaient dû être hospitalisés dans une unité de soins réguliers (infection de sévérité moyenne) et les derniers avaient été admis aux soins intensifs (infection sévère). Enfin, 391 personnes qui n'avaient jamais eu la COVID-19 ont servi de groupe témoin.
«Pour évaluer la rigidité vasculaire, nous mesurons la vitesse de propagation de l'onde de pouls dans l'aorte, la principale artère du corps, à l'aide de capteurs installés au niveau du cou et de la cuisse, explique le professeur Agharazii. Plus l'aorte est rigide, plus l'onde se propage rapidement. Comme cette vitesse augmente avec l'âge, on peut l'utiliser pour estimer l'âge vasculaire d'une personne.»
L'équipe de recherche a mesuré la vitesse de l'onde de pouls chez les sujets à deux reprises, soit 6 mois et 12 mois après une infection à la COVID-19. Les scientifiques ont constaté que, chez les femmes, cette vitesse était plus élevée dans les trois groupes qui avaient eu la COVID-19 que dans le groupe témoin. Les différences équivalaient à un vieillissement vasculaire de 5 ans pour les groupes à infection légère ou à infection d'intensité moyenne, et de 10 ans pour le groupe à infection sévère. Aucune différence n'a été observée du côté des hommes.
Comment expliquer cette différence homme-femme? «La réponse immunitaire contre les infections est généralement plus robuste chez les femmes. Cela permettrait une résistance contre l'infection, mais cette hyperactivation immunitaire pourrait engendrer plus d'inflammation et endommager plus sévèrement les vaisseaux sanguins», avance la professeure Fortier.
Les récepteurs auxquels se fixe le SARS-CoV-2 pour infecter les cellules sont abondants dans les cellules de la paroi intérieure des vaisseaux sanguins. «Même une fois l'infection résorbée, il peut subsister des cicatrices qui affectent la rigidité vasculaire. Cela peut conduire à une surcharge du travail cardiaque et à une pression sanguine plus élevée pouvant affecter le cœur, le cerveau et les reins», explique le professeur Agharazii.
Douze mois après l'infection, la rigidité vasculaire moyenne des femmes qui avaient eu la COVID-19 n'était pas redescendue au niveau de celle du groupe témoin. «On ne sait pas si la rigidité vasculaire induite par l'infection est permanente, mais certaines habitudes de vie telles que la pratique fréquente d'activités physiques, une alimentation équilibrée et la prise de la médication prescrite – notamment pour l'hypertension – peuvent aider à réduire les risques qui y sont associés», rappelle la professeure Fortier.
Une bonne partie de la population a eu au moins un épisode de COVID-19, ce qui signifie que beaucoup de gens peuvent être touchés par cet accroissement de la rigidité vasculaire. «Le fait d'avoir eu la COVID-19 devrait être pris en compte, au même titre que l'hypertension artérielle, le diabète, le taux de cholestérol ou les habitudes de vie, lorsqu'on évalue le risque cardiovasculaire d'une femme. C'est un facteur de risque supplémentaire qui doit être comptabilisé dans l'équation», conclut le professeur Agharazii.
L'étude que cosignent les professeurs Mohsen Agharazii et Catherine Fortier dans l'European Heart Journal a été dirigée par Rosa Maria Bruno, de l'Université Paris Cité.


























