20 novembre 2025
Sclérose latérale amyotrophique: la piste métabolique pour freiner la maladie
Une étude menée à l'Université Laval révèle le rôle du métabolisme des cellules du système nerveux, combiné à l'inflammation, dans la dégénérescence neuronale liée à la SLA
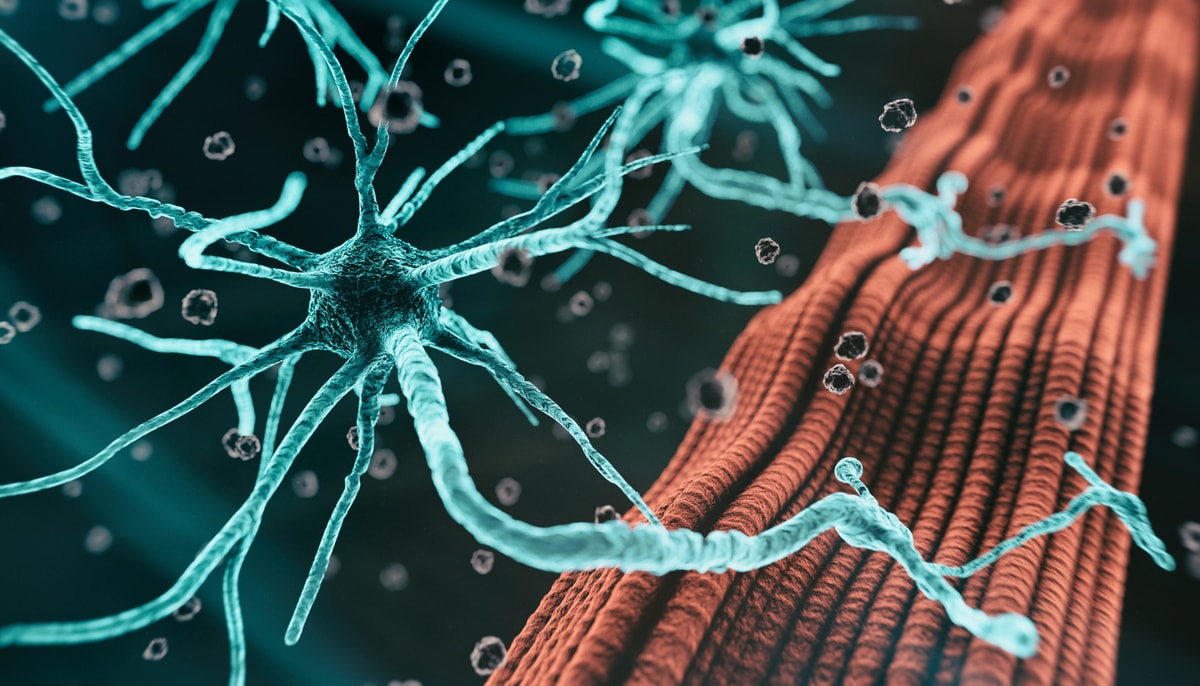
Une mauvaise utilisation de l'énergie par les cellules du système nerveux contribue à la mort des motoneurones dans le cerveau et la moelle épinière.
— Getty Images, koto_feja
Et si la sclérose latérale amyotrophique (SLA) était aussi une maladie du métabolisme? C'est la question que soulève une équipe de recherche, dirigée par Chantelle Sephton, professeure à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheuse au Centre de recherche CERVO. Leurs travaux sur un modèle de souris suggèrent que la façon dont les cellules du système nerveux utilisent l'énergie contribue à la mort des motoneurones dans le cerveau et la moelle épinière.
Reprogrammer le métabolisme
Chez une personne saine, les cellules utilisent du glucose pour fonctionner, mais chez une personne avec la SLA, elles se tournent vers une autre source d'énergie: les lipides. La professeure Sephton rapporte que des études chez l'humain montraient une baisse de l'utilisation de glucose dans le cerveau jusqu'à 10 ans avant les premiers symptômes de la maladie.
Son hypothèse est que les mitochondries, les «centrales énergétiques» des cellules, sont reprogrammées pour utiliser les graisses, qui s'accumulent sous forme de gouttelettes lipidiques. Or, les mitochondries n'arrivent pas à les utiliser efficacement, ce qui génère une surabondance de lipides oxydés qui sont très instables et qui endommagent les cellules. «Il se produit une réaction en chaîne, car leur présence cause des dommages à l'ADN, aux protéines et aux membranes cellulaires», indique Chantelle Sephton.
L'équipe a donc testé un médicament, l'arimoclomol, mis au point pour les personnes diabétiques afin de diminuer les lipides dans le système nerveux central. «Chez notre modèle de souris, les mitochondries pouvaient utiliser les lipides plus facilement pour générer de l'énergie dans les cellules du système nerveux. On ne voyait plus d'accumulation des lipides toxiques et les fonctions cognitives et motrices s'amélioraient», souligne la professeure Sephton.
La professeure Sephton prévient que l'arimoclomol a déjà fait l'objet d'un essai clinique chez des personnes atteintes de la SLA, mais que le médicament n'avait pas montré d'effet bénéfique. «On ne dit pas d'utiliser cette molécule pour traiter la maladie, mais on montre, chez la souris, qu'elle peut avoir un effet sur l'utilisation des lipides pour entraîner un changement métabolique.»
L'inflammation, un cercle vicieux
Dans leur modèle de souris, les scientifiques ont observé que la présence d'inflammation, identifiée comme un facteur de la maladie dans une étude précédente, aggravait l'accumulation des gouttelettes. «Quand il y a beaucoup d'inflammation, on voit plus de gouttelettes lipidiques dans les cellules. Ça crée un cercle vicieux où le stress cellulaire alimente davantage l'inflammation et la toxicité des lipides, accélérant la mort des neurones», explique la professeure.
Les travaux de Chantelle Sephton suggèrent une connexion entre le métabolisme et l'inflammation, mais la professeure ne connaît pas le lien de causalité. L'idéal, selon elle, serait de s'attaquer aux deux en même temps en coupant l'inflammation pour réduire l'accumulation des gouttelettes lipidiques, tout en restaurant la capacité des cellules à utiliser les graisses.
«Nos données supportent l'hypothèse que la SLA n'est pas seulement une maladie des neurones, mais aussi une maladie du métabolisme. Nous avons identifié d'autres cibles potentielles pour essayer de traiter cette maladie», conclut Chantelle Sephton.

La professeure Chantelle Sephton et les deux premières auteures de l'étude Laetitia Marcadet, professionnelle de recherche, et Mari Carmen Pelaez, étudiante au doctorat.
L'étude a été publiée dans la revue Brain. Les signataires affiliés à l'Université Laval sont Laetitia Marcadet, Mari Carmen Pelaez, Antoine Desmeules, Jeanne Serrano, Sahara Khademullah, Elahe Parham, Jorge Soliz, Paul Dutchak et Chantelle Sephton. Ils ont collaboré avec des scientifiques de l'Université McGill, de l'Université d'Alberta et du King's College, au Royaume-Uni.

























