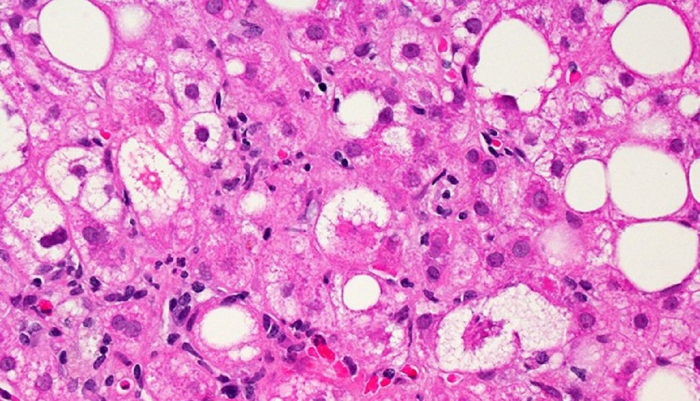L’Université Laval a mené un projet pilote en implantant un comité de santé mentale dans des écoles publiques du Québec entre 2022 et 2023.
— Getty Images - EvgeniyShkolenko
Le personnel enseignant est exposé à plusieurs risques pour la santé mentale, notamment la surcharge de travail, l'inclusion d'élèves ayant des besoins particuliers et le manque de reconnaissance. Pour améliorer la situation, l'Université Laval a mené un projet pilote en implantant un comité de santé mentale dans 12 écoles publiques québécoises entre 2022 et 2023. Dans le cadre de son doctorat à la Faculté des sciences de l'éducation, réalisé sous la direction du professeur Simon Viviers, Marcelo Balboa a observé deux comités dans des écoles secondaires de Québec. Il voulait identifier les freins et les leviers de ce modèle de collaboration.
Toujours actifs, les comités de santé mentale s'intègrent à la structure de chaque école pour encourager le dialogue entre la direction et le personnel enseignant. On y trouve des enseignantes et enseignants volontaires, nommés «référents métiers», qui analysent les situations de travail à risque en sondant leurs collègues et élaborent des pistes de solutions.
Des défis dans la collaboration avec la direction
Parmi les freins identifiés par Marcelo Balboa se trouvent l'organisation du travail instaurée dans le cadre de la nouvelle gestion publique et sa politique axée sur les résultats, et la culture organisationnelle prédominante. «C'est difficile d'instaurer un modèle de coopération dans les conditions actuelles de l'école. Dans le travail quotidien, il existe une gestion verticale descendante. Ça demande un effort pour tout le monde de s'adapter», souligne le chercheur, aussi professionnel de recherche. Pour lui, le succès du comité repose sur l'ouverture des directions à un mode de décision et de partage plus horizontal.
La relation de pouvoir asymétrique avec la direction représente également un défi. Marcelo Balboa distingue la coopération entre enseignants de la collaboration avec la direction, qu'il qualifie de verticale. «Avec la coopération, il existe une marge de manœuvre pour délibérer avec la connaissance du travail réel d'un enseignant, explique le chercheur. Ce n'est pas pareil avec la direction parce que son expertise est en gestion. Le mandat est différent et même quelques fois contradictoire avec les besoins des enseignants.» Le chercheur suggère donc la médiation d'un tiers pour créer des conditions de confiance afin que tout le monde puisse exprimer son point de vue et éviter les conflits.
La force de la coopération entre collègues
Les comités de santé mentale se rencontraient une fois par mois, mais Marcelo Balboa est convaincu qu'une coopération en continu entre les pairs serait bénéfique, notamment pour développer de la confiance et partager le savoir-faire. Par exemple, une des écoles a créé un espace de dialogue au-delà du comité en santé mentale en organisant une assemblée générale regroupant l'ensemble du personnel enseignant.
Marcelo Balboa croit que les échanges entre les membres du personnel enseignant pourraient aider à prévenir l'isolement et la normalisation progressive de la surcharge de travail. «Un enseignant en fin de carrière va se dire: “Ce n'est pas normal que je doive travailler les fins de semaine. Ce n'est pas normal qu'une personne s'attende à une réponse le dimanche pour la situation d'un élève”. Ces situations s'implantent dans le temps. Mais pour certains profs qui arrivent aujourd'hui, c'est normal», observe Marcelo Balboa.
Un des freins à la coopération observé par le chercheur est la division interne au sein du personnel enseignant selon le niveau d'expertise ou la matière enseignée. «Un enseignant d'arts plastiques dans une école racontait être considéré comme moins important que les mathématiques par des parents et des collègues, se souvient Marcelo Balboa. C'est nécessaire que les profs soient d'accord que toutes les matières sont également importantes pour la formation.»
Pour arriver à ces constats, Marcelo Balboa a observé 19 rencontres et analysé les discussions et les comportements non verbaux pour «cartographier les interactions» entre les membres des comités. Sa thèse servira à orienter la création de nouveaux outils de prévention en santé mentale dans les écoles.
Le projet pilote de comités en santé mentale a été mené en partenariat avec l'Université de Sherbrooke, l'Université du Québec en Outaouais, l'Université de Montréal, la Fédération autonome de l'enseignement et le Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones.