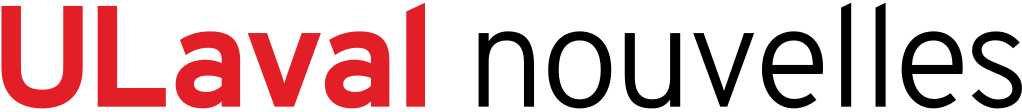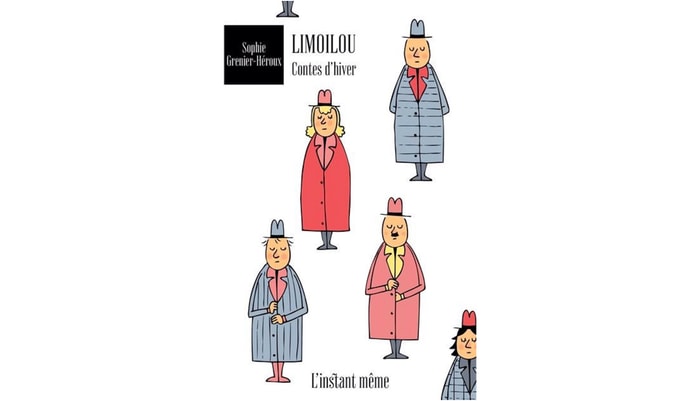En 2023, la saison des feux de forêt fut sans précédent au Canada. Quelque 18,5 millions d’hectares ont été la proie des flammes, forçant l’évacuation de plus de 220 000 personnes.
En date du 3 octobre, la SOPFEU avait enregistré 551 feux de forêt pour l’année 2023 au Québec. Ces incendies ont affecté près de 1,4 million d’hectares, soit considérablement plus que les quelque 16 000 hectares de forêt qui brûlent habituellement chaque année sur le territoire.
Feux de forêt de grande magnitude, pluies torrentielles et canicules fréquentes, il n’y a pas de doute, la crise climatique qui a cours sur l’ensemble de la planète est maintenant installée au Québec.
Cette nouvelle réalité que sont les désastres d’origine naturelle mais aussi d’origine humaine, à la fois fréquents et diversifiés, n’est pas passée inaperçue au Département d’anthropologie de l’Université Laval. Depuis le début de la session d’automne on y donne le cours Anthropologie des désastres. Son titulaire est le professeur Maxime Polleri. Celui-ci se définit comme anthropologue de la science et de la technologie. Il est spécialisé, entre autres, dans les questions relatives à la contamination radioactive, principalement en raison de son terrain de recherche ethnographique doctoral effectué au Japon pendant environ 14 mois, cinq ans après l’accident nucléaire de Fukushima en 2011. Cette municipalité et sa région avaient été le théâtre d’un désastre écologique majeur après un séisme suivi d’un tsunami, avec la fusion des cœurs de trois réacteurs à la centrale nucléaire locale. Au cours de son terrain, le doctorant avait constaté les bouleversements amenés par la contamination radioactive sur l’environnement et sur la population, en particulier les agriculteurs.
Fin août 2023, Fukushima s’est invitée à nouveau dans l’actualité lorsqu'a commencé le déversement dans l’océan d’eau issue de la centrale nucléaire accidentée. L’opération portait sur quelque 7800 mètres cubes d’eau contenant du tritium, une substance radioactive. Trois autres déversements étaient prévus d’ici mars 2024.
«Cette eau contaminée accumulée depuis des années pour le refroidissement des réacteurs démontre bien qu’il faut parler d’un désastre non pas comme un événement unique, mais comme un processus qui va évoluer dans le temps, explique le professeur Polleri. Conceptualiser le désastre comme un processus permet de remettre la catastrophe dans un contexte historique beaucoup plus large. Cela nous permet d’illuminer des facteurs de vulnérabilité sociale qui n’apparaissent pas facilement si on considère un tremblement de terre comme un simple événement naturel.»
Il y a quelques semaines, le professeur participait, à Paris, à une conférence interdisciplinaire sur la catastrophe de Fukushima. «En réunissant des chercheurs de diverses nationalités, principalement japonaises et françaises, dit-il, et en favorisant la multidisciplinarité, le laboratoire Mitate, un projet de recherche international du CNRS, vise à explorer les conséquences de la catastrophe dans toute leur complexité, tant d’un point de vue humain qu’environnemental.»
Déconstruire les concepts et les idées préconçues
Une vingtaine d’étudiants de premier cycle suivent le cours Anthropologie des désastres. Ils sont inscrits principalement en anthropologie, d’autres viennent de science politique ainsi que d’autres microprogrammes. Selon Maxime Polleri, ils ne tiennent pas les choses pour acquises, ils déconstruisent les concepts et les idées préconçues. «On demande aux nouvelles générations de penser de façon critique par soi-même, explique-t-il. Mes étudiants me surprennent.»
Le professeur Polleri fait partie de cette première génération d’anthropologues à s’intéresser aux désastres. «Avant l’époque actuelle, dit-il, les désastres, par exemple les tremblements de terre, c’était loin. On y pensait, ensuite on oubliait.» Quant à l’anthropologie des désastres, il ne s’agit pas pour le moment d’un champ disciplinaire. «Mais, ajoute-t-il, ce champ gagne en popularité à cause du nombre grandissant de catastrophes. Pensons aux feux de forêt. Ils sont maintenant arrivés au Canada.»
Dans son cours, qui serait le premier du genre au Québec, il amène ses étudiants à penser aux dimensions éthiques d’un désastre. Selon lui, l’anthropologue fragmente souvent les expériences humaines par ses écrits, ses cours, ses présentations. «Il le fait tout en transformant les pratiques des connaissances de nos informateurs dans un but plus large de généralisation intellectuelle ou d’explication anthropologique, poursuit-il. Cela implique souvent des enjeux inégaux de pouvoir, où les informateurs ne peuvent pas “répondre” aux récits des anthropologues. J’essaie d’encourager mes étudiants à penser à ces enjeux éthiques entre chercheurs et informateurs dans l’étude des désastres. Par exemple, il est compréhensible que certains habitants de zones touchées par une catastrophe ne souhaitent pas que leurs expériences soient nécessairement classées de manière réductrice dans la catégorie des victimes.»
Un tremplin vers d’autres disciplines
Son cours, Maxime Polleri le voit comme un tremplin pour aller rejoindre d’autres disciplines. «Je crois, soutient-il, que plusieurs autres disciplines auraient beaucoup à gagner d’utiliser les approches théoriques de l’anthropologie, ainsi que ses méthodes de recherche qui mettent en priorité l’expérience vécue des désastres.»
Selon lui, un double standard caractérise l’analyse des désastres. «On ne voit jamais de scientifiques sociaux parler d’ingénierie, de mathématique ou de création de vaccin, explique-t-il. Bien que je travaille sur la catastrophe nucléaire de Fukushima, je n’ai pas d’expertise en ingénierie nucléaire et je n’ai pas un mot à dire sur le design de réacteurs nucléaires. C’est tout à fait compréhensible. Pourtant, dans les médias, on retrouve sans cesse des experts en sciences de la nature qui parlent d’enjeux sociaux et cela ne semble causer aucun problème. Je ne dis pas que seuls les scientifiques sociaux ont le droit de parler d’enjeux sociaux, mais comme nous sommes précisément formés pour traiter de ces problèmes, il est navrant que les enjeux majeurs d’une société, comme les besoins énergétiques ou la résilience face aux désastres, demeurent souvent monopolisés par des approches centrées sur la technologie ou les sciences dites pures.»
Selon le professeur Polleri, comme les experts en sciences naturelles sont rarement formés pour comprendre la complexité de certains enjeux sociaux, ils finissent souvent par reproduire des stéréotypes culturels, raciaux ou genrés qui sont précisément à la base des problèmes sociaux qu’ils souhaitent régler. «Les gouvernements, poursuit-il, devraient prioriser et écouter leurs propres experts en sciences sociales, et les experts en sciences naturelles auraient également beaucoup à gagner à coopérer avec nous.»

Dans son cours, Maxime Polleri traite notamment de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Cette photo montre un inspecteur de l’Agence internationale de l’énergie atomique sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima, en mai 2011. L’accident s’était produit le 11 mars.
— Greg Webb
![<p>Des manifestants, à Tokyo, après l’accident nucléaire, demandent l’évacuation des enfants de la ville de Fukushima. La pancarte en anglais se lit comme suit: «Protégez les enfants de l’exposition [aux radiations]! La radioactivité est invisible!»</p>](https://assets.ulaval.omerloclients.com/782718227a09158ddab94b0972f73450efffebe72e25a69d051ebe0bac3ca97b.jpg?quality=md)
Des manifestants, à Tokyo, après l’accident nucléaire, demandent l’évacuation des enfants de la ville de Fukushima. La pancarte en anglais se lit comme suit: «Protégez les enfants de l’exposition [aux radiations]! La radioactivité est invisible!»