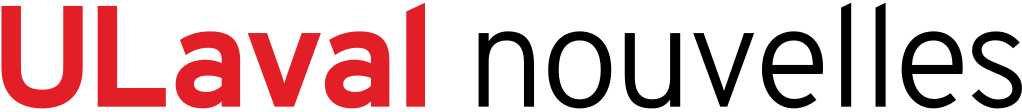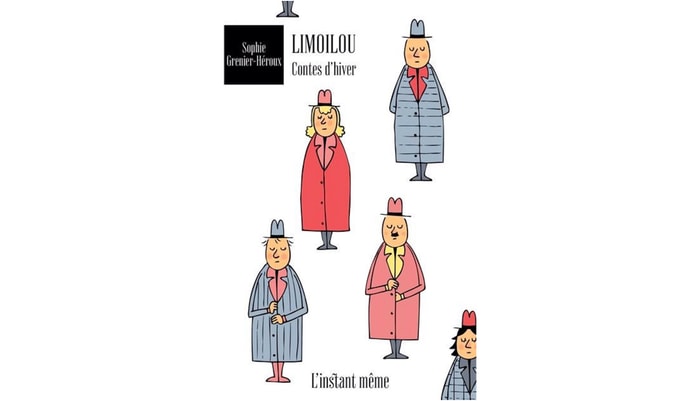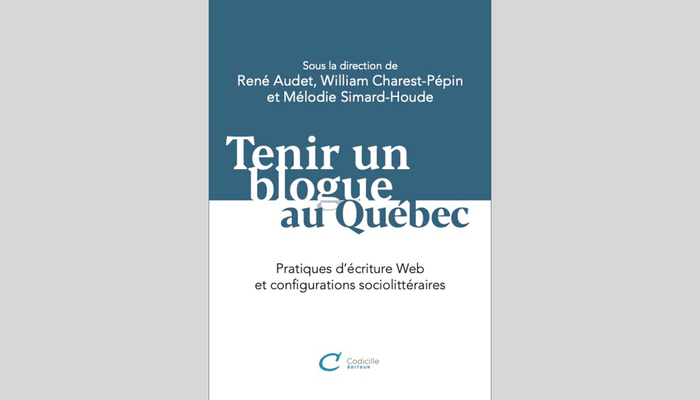Un inspecteur de l’Agence internationale de l’énergie atomique sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima, en mai 2011. L’accident s’était produit le 11 mars.
— Greg Webb
Que veut dire vivre dans un monde pollué de façon permanente? Pour un anthropologue de la science et de la technologie comme Maxime Polleri spécialisé, entre autres, dans les questions relatives à la contamination radioactive, la municipalité japonaise de Fukushima et sa région, qui furent le théâtre, en 2011, d’une catastrophe nucléaire après un séisme suivi d’un tsunami, avec la fusion des coeurs de trois réacteurs à la centrale nucléaire locale, représentaient un terrain d’étude du plus grand intérêt pour répondre à cette question.
«Cela m’apparaissait comme un sujet important, alors je me suis lancé dans l’étude de la contamination radioactive, explique celui qui était alors doctorant en anthropologie sociale à l’Université York, à Toronto. J’ai fait beaucoup de lectures; j’ai lu sur les autres désastres qu’étaient Three Mile Island et Tchernobyl. Et j’ai commencé à venir au Japon à compter de 2015 comme boursier. En deux ans, j’ai fait un bon 14 mois de recherche ethnographique sur le terrain.»
Maxime Polleri enseigne au Département d’anthropologie de l’Université Laval depuis 2021. En décembre 2022, il signait un texte sur sa recherche terrain dans la préfecture de Fukushima dans le magazine en ligne grand public et sans but lucratif Aeon. Cet article précède un livre sur le sujet qui devrait paraître dans environ un an. Dans son texte, le chercheur ouvre la porte sur ce que cela veut dire vivre dans un lieu contaminé. Quelques cultivateurs sont mis à contribution. L’un d’eux est Atsuo Tanizaki. Le professeur Polleri l’a rencontré en 2016.
«J’ai visité la ferme de Tanizaki pour la première fois au printemps 2016, écrit-il dans son article. L’air était chaud, les montagnes proches étaient recouvertes de cèdres, de chênes et de cyprès. Des singes dans les arbres nous regardaient passer. Et à travers l’air, l’eau, la terre, les plantes et les organismes vivants, il y avait des polluants radioactifs invisibles. Presque tout alors portait les traces invisibles de la catastrophe de 2011.»
Le cultivateur avait avec lui un compteur Geiger, un instrument de mesure de la radioactivité. À certains endroits, le compteur montrait un faible niveau de radiations. Mais, ici et là, le niveau était dangereusement élevé. Ces points chauds, on en trouvait même à l’intérieur des zones dites de sécurité sur les cartes du gouvernement. Encore plus dans les zones d’exclusion.
«Après l’accident nucléaire, explique Maxime Polleri, cela a pris un peu de temps avant que le gouvernement japonais puisse produire des cartes de la contamination radioactive à Fukushima. Très souvent, les cartes et les informations n’étaient pas assez précises pour ceux et celles qui étaient revenus vivre dans les zones contaminées. On leur donnait la moyenne de la radioactivité dans leur village. Ce n’était pas tellement pratique pour eux. Les gens voulaient plutôt savoir: est-ce que mon jardin est contaminé? Ou est-ce que les champignons de la forêt sont encore comestibles? Des citoyens ont commencé à s’informer par eux-mêmes. Certains ont commencé à produire des données avec des dispositif de surveillance des radiations dénichés à droite et à gauche. Ils ont créé des cartes beaucoup plus précises que celles du gouvernement.»
Une évacuation massive
Les dangereux radionucléides libérés dans l’atmosphère à la suite des explosions à la centrale nucléaire de Fukushima comprenaient notamment du césium-134, du césium-137, du strontium-90 et de l’iodine-131. Ces isotopes ont été transportés par les vents à travers la préfecture de Fukushima et le nord-est du Japon. Leur accumulation pouvant entraîner une augmentation des problèmes de santé comme le cancer, le gouvernement a ordonné l’évacuation de dizaines de milliers de personnes vivant à proximité de la centrale nucléaire. En 2010, la région comptait plus de 80 000 habitants. En 2020, ils étaient environ 50 000.
«La catastrophe a forcé les gens qui ont choisi de revenir à repenser leur vie quotidienne, souligne le professeur Polleri. Ils pensent constamment aux radiations. Y a-t-il de la contamination sur les souliers de mes enfants? Y en a-t-il sur les pièces de monnaie que l’on échange? Doit-on faire sécher les vêtements sur la corde à linge en été? Le contexte crée beaucoup de stress et de difficultés. Et il a entraîné bien des divorces.» Il parle d’un «énorme clash générationnel». «Des gens très âgés, dit-il, qui ont toujours vécu à Fukushima ont décidé d’y rester jusqu’à la fin de leur vie parce qu’ils vont peut-être mourir bien avant de ressentir les effets liés aux radiations.»
En 2015, quatre ans après l’évacuation forcée, le cultivateur Atsuo Tanizaki a été autorisé à revenir chez lui pour constater que les efforts de décontamination du gouvernement se soldaient par un échec. Dans sa visite de la préfecture la même année, Maxime Polleri a vu la méfiance, la peur, l’isolement ainsi que des maisons et villages abandonnés. Pour venir en aide aux cultivateurs, avant leur rapatriement, le gouvernement avait investi des milliards de yens dans le nettoyage et la décontamination de la région. Le signe le plus visible de ce gigantesque effort ce sont ces millions de grands sacs de plastique noir contenant de la terre irradiée et soigneusement empilés encore aujourd’hui en zone rurale.
«Le gouvernement ne sait pas faire de la décontamination radioactive, affirme le professeur. Pour lui, cela consiste à mettre la terre contaminée ailleurs. Or, c’est impossible à faire. De plus, on ne peut pas mettre dans des sacs la terre, les branches et les plantes contaminés et attendre plusieurs années que les radiations diminuent. Certains des polluants n’ont une durée de vie que de quelques jours. D’autres peuvent rester 300 ans dans l’environnement, d’autres durent des milliers d’années. La seule chose qui permet de décontaminer est le temps.»
Le chercheur a vu ces sacs pour la première fois en 2016. Il se rappelle de sacs ayant percé avec le temps et répandant leur contenu radioactif sur un sol récemment décontaminé. «Parfois, des graines de plantes à l’intérieur de sacs poussaient dans la terre et se frayaient un chemin jusqu’au soleil, raconte-t-il. Le gouvernement ne sait pas quoi faire avec ces sacs. Il a passé une loi obligeant l’État à se débarrasser de tous les déchets radioactifs dans la préfecture de Fukushima d’ici 2045. Bien entendu, aucune autre préfecture n’accepte de recevoir ces déchets.»
Des tournesols dans des champs irradiés
Les cultivateurs de la région ont fait diverses tentatives pour reprendre le contrôle de leurs champs contaminés. L’une d’elles était basée sur une croyance voulant que le tournesol absorbe les radiations pendant sa croissance. Plusieurs cultivateurs firent l’expérience, qui s’avéra insatisfaisante. Le chercheur a été témoin d’expériences dans des rizières qui se conclurent elles aussi par des échecs. Elles consistaient à inonder les champs, ensuite à mélanger l’eau avec la couche arable irradiée au-dessous. Ce faisant, les polluants radioactifs étaient remués et délogés. Des brosses poussaient ensuite l’eau boueuse à l’extérieur du champ.
D’autres tentatives ont obtenu davantage de succès. Certains cultivateurs font maintenant pousser des fleurs ornementales. Durant une de ses visites, Maxime Polleri est entré dans une serre où des cultivateurs, appuyés par des scientifiques, faisaient pousser des fraises. La terre et l’eau filtrée provenaient de régions lointaines non touchées par la contamination. D’anciens producteurs de riz s’étaient convertis, avec l’aide de scientifiques universitaires, en producteurs d’herbe argentée, une source de biocarburant.
Durant sa longue recherche à Fukushima, Maxime Polleri a assisté à l’émergence d’un nouveau monde chez les cultivateurs. Chacun apprenait à vivre avec la contamination et portait avec lui un dispositif de surveillance des radiations. La bibliothèque d’Atsuo Tanizaki contenait de nombreux livres sur Tchernobyl, l’énergie nucléaire, la contamination radioactive et la sécurité des aliments. Sur des images de la topographie de la région, le cultivateur avait inscrit des informations à jour sur les radiations, des données souvent fournies par d’autres cultivateurs. Ce partage de connaissances forgeait un nouvel esprit communautaire sur le territoire.
À la lumière de la catastrophe de Fukushima, le professeur Polleri voit un avenir problématique pour la planète Terre. Il parle de pollution permanente prenant diverses formes, comme le mercure dans la vie marine, les microplastiques ainsi que les pesticides dans le lait maternel.
«Une des choses à faire, dit-il, est d’essayer de dépasser les discours qui parlent de pureté de l’air et de décontamination. Malheureusement, le concept de pureté n’existe plus aujourd’hui. Il faut se rendre compte que la contamination est là et qu’elle est permanente. Si on commençait à penser à inculquer une culture par rapport aux déchets en énergie? Cela permettrait d’éviter d’autres catastrophes, de rendre notre Terre moins polluée et de lui donner un avenir un peu meilleur.»
![<p>Des manifestants à Tokyo, après l’accident nucléaire, demandent l’évacuation des enfants de la ville de Fukushima. La pancarte en anglais se lit comme suit: «Protégez les enfants de l’exposition [aux radiations]! La radioactivité est invisible!»</p>](https://assets.ulaval.omerloclients.com/782718227a09158ddab94b0972f73450efffebe72e25a69d051ebe0bac3ca97b.jpg?quality=md)
Des manifestants à Tokyo, après l’accident nucléaire, demandent l’évacuation des enfants de la ville de Fukushima. La pancarte en anglais se lit comme suit: «Protégez les enfants de l’exposition [aux radiations]! La radioactivité est invisible!»
— Maxime Polleri

À Fukushima, Maxime Polleri examine des cartes gouvernementales de la contamination radioactive à Fukushima et la région avoisinante.
— Maxime Polleri

Des tournesols flétris dans un champ irradié. Plusieurs cultivateurs de la préfecture de Fukushima croyaient que le tournesol absorbait les radiations pendant sa croissance. Des expériences pour décontaminer des terres agricoles irradiées furent donc tentées avec cette plante.
— Maxime Polleri

Le professeur Polleri pose devant une grande quantité de sacs de plastique contenant de la terre radioactive. Ces amoncellements sont le résultat des politiques de décontamination du gouvernement japonais.
— Maxime Polleri

Un cultivateur de Litate, dans la préfecture de Fukushima, devant sa rizière en 2016. Les expériences de décontamination dans des rizières consistaient à inonder les champs, ensuite à mélanger l’eau avec la couche arable irradiée au-dessous. Ce faisant, les polluants radioactifs étaient remués et délogés.
— Getty Images