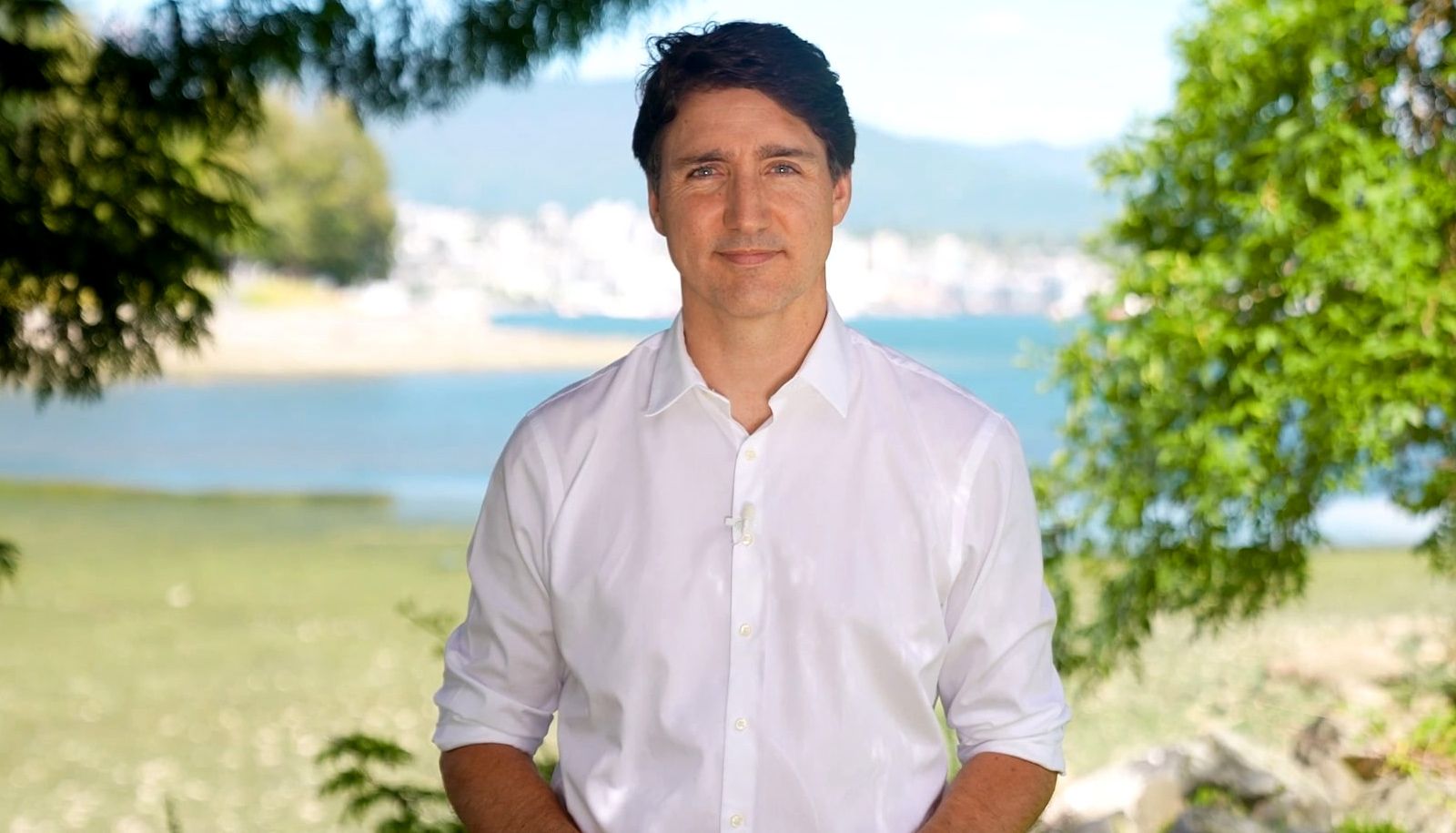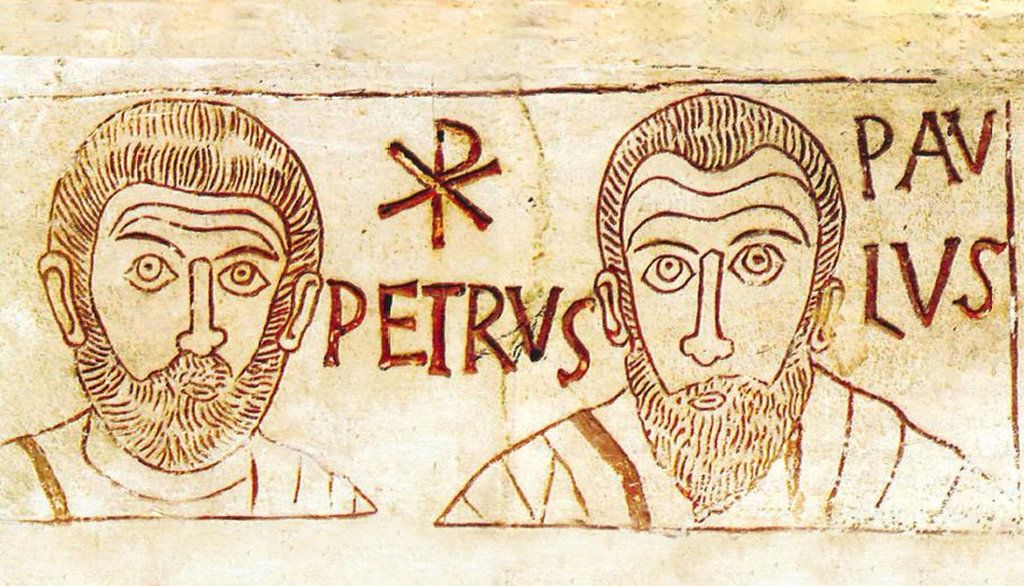
Les apôtres Pierre et Paul. Gravure sur une pierre tombale en marbre du 4e siècle de notre ère.
— Musée du Vatican
Le christianisme primitif hors de Jérusalem: première expansion et premiers conflits, tel est le titre d’un des modules de formation continue ouverts à tous et offerts en ligne par la Faculté de théologie et de sciences religieuses (FTSR).
Lors des deux premiers siècles de notre ère, des centaines de communautés chrétiennes ont vu le jour dans l’Empire romain. Ce faisant, le message évangélique a rejoint des milliers de personnes. Ce succès fut rendu possible par deux facteurs qui ont facilité la mission chrétienne: la «paix romaine» et la sécurité accrue des voies de communication terrestres et maritimes.
Le christianisme a fait son entrée dans l’Empire par différentes formes de prédication. Étant eux-mêmes en majorité des Juifs, les premiers chrétiens ont débuté leur prédication dans les synagogues, avant d’en être chassés. Les places publiques, qui servaient également à annoncer la Bonne Nouvelle, attiraient sur les prédicateurs l’hostilité des Juifs et l’incompréhension des philosophes païens. Jusque vers la moitié du 2e siècle, il ne fait pas de doute que les principaux lieux de rassemblement chrétien étaient les résidences privées. Si le christianisme s’est répandu aussi rapidement lors des trois premiers siècles, cela serait dû notamment à l’éducation à la foi des enfants. L’évangélisation par les écrits a également joué un rôle. Les écrits les plus célèbres et les plus répandus furent les quatre Évangiles et les Actes des Apôtres.
«Né en Palestine à la suite de l’activité et de la prédication de Jésus de Nazareth, le christianisme va vite s’étendre au-delà de la ville de Jérusalem et des frontières de la Judée et de la Galilée pour gagner les principales villes de l’Empire romain», explique, d’entrée de jeu, Éric Crégheur, professeur d’histoire et de littérature du christianisme de l’Antiquité à la FTSR. «Cependant, poursuit-il, si la première mission chrétienne manifeste le dynamisme expansionniste de la nouvelle religion, elle met aussi en lumière son originalité et son irréductibilité, d’où l’émergence de conflits.»
De l’apôtre Paul à l’apôtre Pierre
Selon le professeur Crégheur, la mission chrétienne va prendre définitivement son envol avec l’entrée en scène de Paul de Tarse. Né au début du 1er siècle, membre des pharisiens, un groupe religieux et politique de Juifs fervents, Paul est l’ennemi acharné de l’Église chrétienne naissante. Une vision le transforme en «apôtre des gentils». «Paul demeure la figure la mieux connue de toutes les figures de l’histoire chrétienne primitive, soutient-il. Quinze des 28 chapitres des Actes des Apôtres lui sont consacrés. On le connaît aussi par ses lettres.»
Les sources indiquent par ailleurs que l’apôtre Pierre serait venu à Rome et qu’il y serait resté entre l’an 58 ou 59 et l’an 64. Dans sa lettre aux Romains diffusée en 57, Paul ne fait aucunement mention de Pierre. On peut par ailleurs affirmer que Pierre est mort martyr sous l’empereur Néron en 64. «Dès la fin du 1er siècle, rappelle Éric Crégheur, de nombreux témoignages littéraires font état que l’apôtre Pierre a vécu à Rome, y a fondé l’Église et y est mort martyr. Au 2e siècle, l’un des témoignages parmi les plus éloquents est le livre de l’évêque Irénée de Lyon dans lequel il attribue à Pierre et à Paul la fondation de l’Église romaine.»
Pour comprendre les tout premiers conflits dans l’Église naissante, il faut garder à l’esprit que le christianisme est né au sein du judaïsme. Rappelons que Jésus, qui était Juif, a pratiqué les observances prescrites par la religion juive et qu’il ne les a jamais remises en question. Ces observances comprenaient le sabbat, les tabous alimentaires, la circoncision, les fêtes juives, les unions non légales. La majorité des premiers chrétiens étaient des Juifs ayant accueilli la foi au Christ, mais ils n’en continuaient pas moins d’observer les prescriptions fondamentales de la loi juive. «On peut même dire que, pour ces Juifs devenus chrétiens, la permanence des observances juives et leur compatibilité avec leur foi en Jésus allaient de soi et ne causaient aucun problème», souligne le professeur.
Mais qu’en était-il des nouveaux chrétiens issus de religions autres que le judaïsme? Devaient-ils être contraints d’observer eux aussi la loi juive? Devaient-ils se faire Juifs pour être chrétiens? Le christianisme allait-il continuer à vivre et à se développer dans le cadre du judaïsme ou allait-il prendre son autonomie?
«Le premier conflit est survenu à Antioche en 48 ou 49 à l’occasion de la conversion par Paul de non-Juifs au christianisme, raconte Éric Crégheur. Paul était convaincu n’avoir rien à leur imposer. Or, des Juifs chrétiens de la communauté de Jérusalem voulaient leur imposer la loi juive. La solution fut adoptée en 49 lors d’une assemblée appelée le “concile de Jérusalem”. Les non-Juifs devenus chrétiens seraient considérés comme de pieux païens croyant au Dieu unique d’Israël, mais sans se convertir au judaïsme. On ne leur imposerait aucune des prescriptions rituelles, sauf s’abstenir des viandes de sacrifices païens et s’abstenir des unions non légales.»
Des persécutions
Des martyrs par dizaines de milliers, des chrétiens constamment traqués pour leur foi, des vies cachées dans les catacombes: les clichés abondent sur les persécutions qu’auraient subies les premiers chrétiens. «Sans contredit, beaucoup d’adultes et d’enfants ont péri à cause de leur foi au cours des quatre premiers siècles, indique le professeur. Mais en général les persécutions furent de courte durée et seules quelques-unes ont frappé l’ensemble de l’Église. Le plus important est de savoir pourquoi, jusqu’en 313, l’Église a vécu dans un climat d’hostilité et d’insécurité. Pourquoi un État aussi puissant que l’était la Rome impériale s’est senti menacé par la foi chrétienne.»
Suétone rapporte qu’en 49, l’empereur Claude a chassé les Juifs de Rome parce qu’ils s’agitaient sans cesse à l’instigation d’un certain Chrestus. En 64, sous l’empereur Néron, Suétone et Tacite attestent une persécution violente, meurtrière et de courte durée dirigée contre les chrétiens de Rome.
«Tacite, dit-il, laisse entendre qu’à la suite de l’incendie de la ville, Néron, pour détourner les soupçons qui pesaient sur lui, accusa les chrétiens de Rome d’en être les auteurs. Ceux-ci furent par conséquent livrés en nombre important aux supplices et aux jeux du cirque. Contrairement à 49, les chrétiens constituaient un groupe qui ne pouvait plus passer inaperçu et ne pouvait plus être confondu avec les Juifs.»
Selon le professeur, les chrétiens attiraient l’attention des pouvoirs et de l’opinion publique comme des sectateurs d’une religion non reconnue qui aurait troublé l’ordre public. «Le “crime” reproché aux chrétiens, explique-t-il, est donc à rapprocher du crime d’athéisme au sens de la méconnaissance des dieux de l’État et de la cité, et aussi de celui, connexe, de leur mode de vie particulier.»