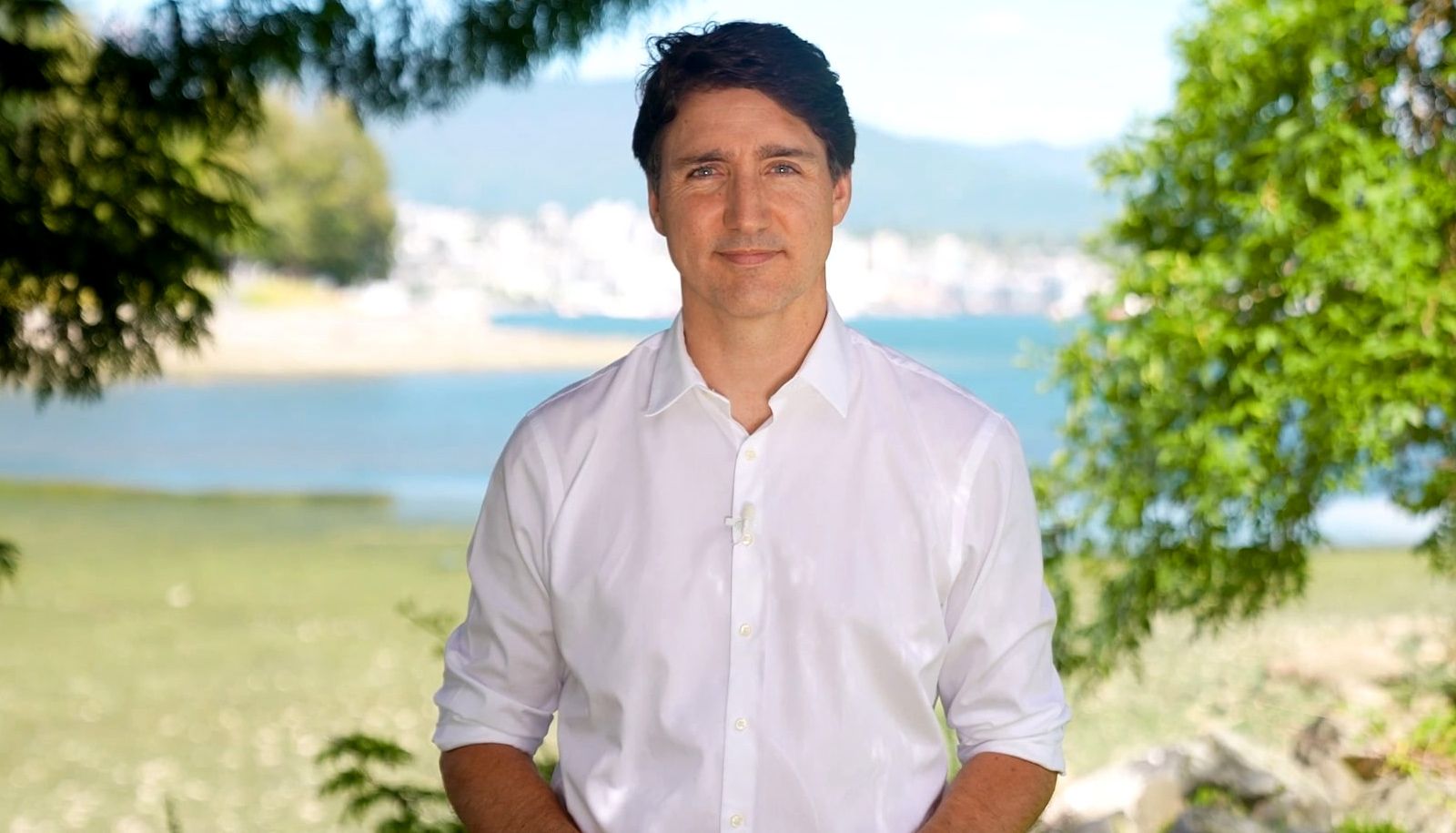Le projet de Marjolaine Morin et Mélissa Rhéaume est tout en finesse. Il s'appuie sur des lamelles de verre givré créant des rideaux translucides structurants. Dans les hauteurs de la cour intérieure, un volume en bois sert d'espace d'exposition.
Cette problématique fait actuellement l'objet d'une exposition de travaux étudiants au musée. Du 6 au 19 mai inclusivement, les visiteurs peuvent voir les maquettes, les dessins et les vidéos réalisés par les 11 étudiants à la maîtrise en architecture inscrits cet hiver à l'atelier Conservation et restauration dirigé par le professeur Plante. «Il s'agissait là d'un défi particulièrement intéressant pour les étudiants, affirme-t-il. L'idée du projet m'a été suggérée par le directeur général du musée. Le défi avait ceci de délicat qu'il fallait tenir compte du patrimoine architectural ancien, soit le bâtiment de pierre appelé maison Estèbe qui délimite la cour intérieure, et du patrimoine architectural contemporain, soit le musée lui-même.»
L'atelier a permis la réalisation de six projets que Jacques Plante n'hésite pas à qualifier de fantastiques. «Le directeur du musée souhaitait que les étudiants soient audacieux et ils l'ont été», souligne-t-il. Le professeur a demandé à ses étudiants de mettre en scène des parcours intérieurs et extérieurs convaincants, d'imaginer un nouvel espace public polyvalent, et de faire une intégration soignée des systèmes structuraux et mécaniques du bâtiment.
Dans leur projet, Marjolaine Morin et Mélissa Rhéaume regroupent les espaces d'accueil au centre du bâtiment. Des lamelles de verre givré créent des rideaux translucides structurants. Dans les hauteurs de la cour, un volume en bois sert d'espace d'exposition. «Ce projet très abouti se développe tout en finesse, soutient Jacques Plante. Avec beaucoup de doigté, la structure de bois aérienne vient s'insérer dans l'espace de la cour.»
Lysanne Garneau et Élisa Gouin imaginent un nouvel espace couvert dans la cour intérieure qui valorise et intègre la maison Estèbe. La façade vitrée du musée, qui empêchait le regard du visiteur de se porter jusqu'à la façade de pierre du bâtiment ancien, a disparu. Les espaces ouverts au public sont agrandis et favorisent un séjour plus long.
La proposition de David Kirouac et de Gabrielle Rousseau consiste à remplacer le toit du musée, de l'avant à l'arrière, pour une réappropriation des espaces sous-utilisés. La cour intérieure et les toits-terrasses deviennent des espaces intérieurs utilisables à longueur d'année. L'emploi du verre givré favorise la lumière naturelle constante, en particulier dans les entrées principales.
Jean-Jacqui Gaudet-Rocheleau et Laurence Pagé Saint-Cyr réaménagent l'intérieur du musée à l'endroit où se trouvent les lieux de vente. Dans leur concept, un restaurant est installé dans la maison Estèbe. Ils déplacent dans la cour intérieure l'espace réservé aux enfants. L'entrée principale et les toits-terrasses se transforment en de nouveaux espaces intérieurs coiffés d'un toit de forme triangulaire.
L'intervention d'Hélène Caron et de Maxime Lamer s'oriente autour de l'idée de strates s'intégrant à l'architecture. Ces strates créent de nouveaux espaces que dynamisent des entrées de lumière naturelle. C'est le cas dans la cour intérieure où de nouveaux plans horizontaux de bois, de verre et d'acier favorisent des jeux d'ombre et de lumière.
La proposition de Maxime Vinette-Leduc suit les lignes de force du musée. L'étudiant propose un élément créateur, une forme triangulée, qui parcourt le bâtiment. On la trouve au niveau du toit et des escaliers extérieurs. Le projet vise à augmenter les espaces d'exposition et à clarifier l'allée centrale de l'édifice.
Les étudiants ont produit des vidéos sur leurs projets. Elles seront en ligne jusqu'au 19 mai. On peut les regarder à l'adresse suivante : arc.ulaval.ca/agenda/exposition-projets-etudiants-latelier-conservation-restauration-au-musee-civilisation.html.