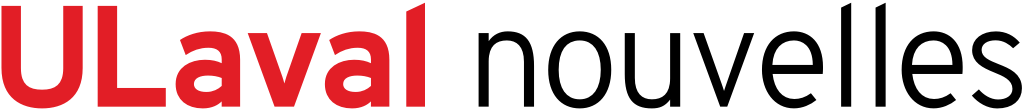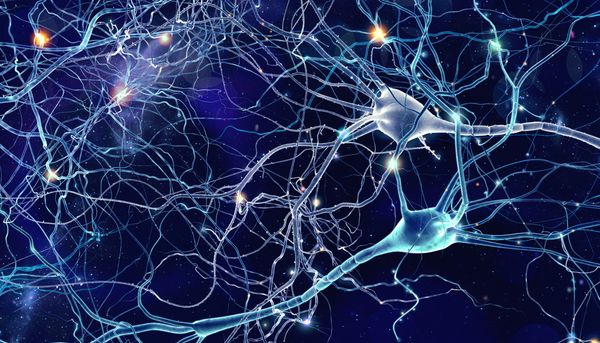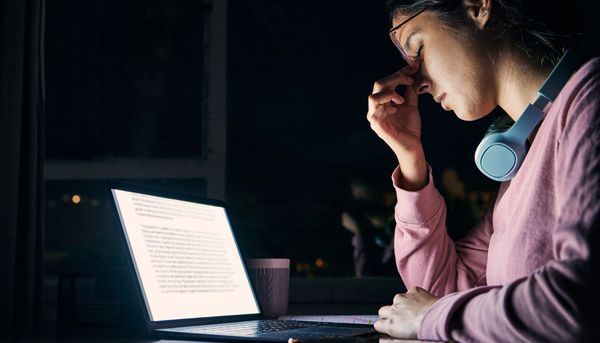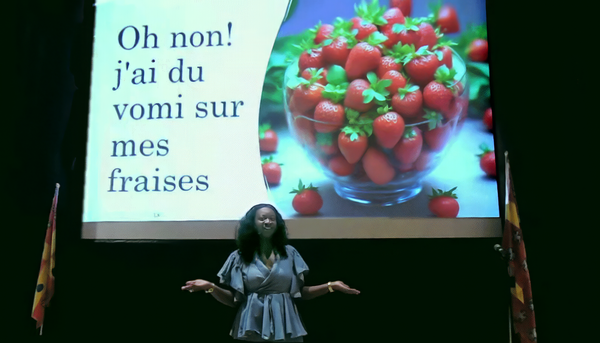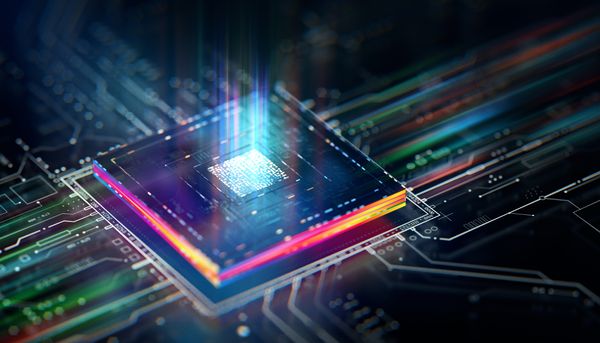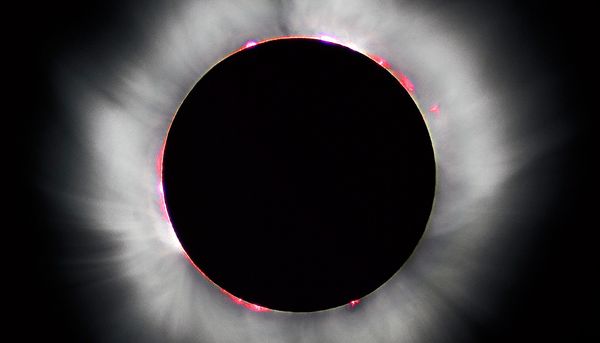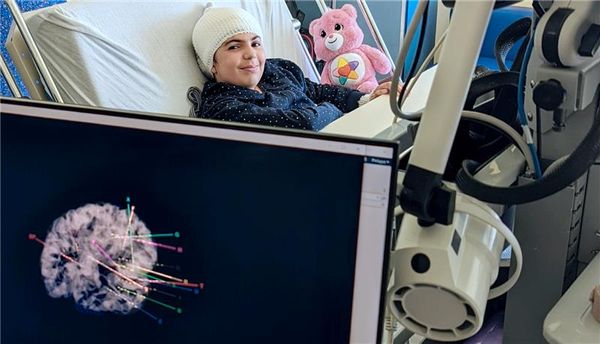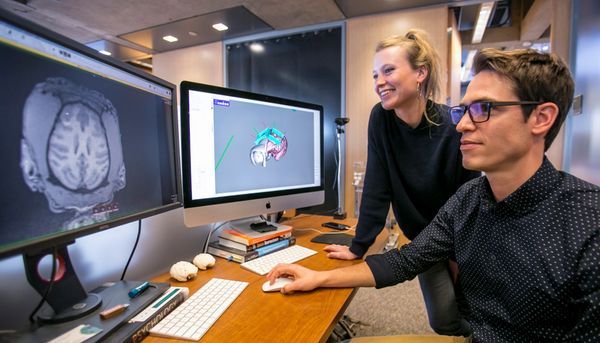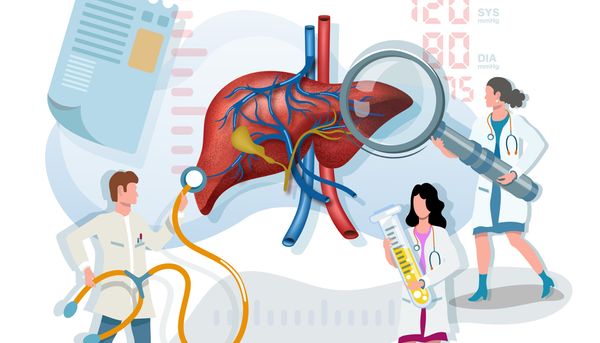C’est grâce aux charbons de bois retrouvés dans les sédiments de 35 lacs répartis dans différentes régions du Canada et des États-Unis que les chercheurs ont pu documenter l’incidence des feux de forêt à l’échelle continentale dans l’intervalle allant de 15 000 à 10 000 ans avant aujourd’hui. Formés à partir de matière végétale calcinée, les charbons de bois se conservent pendant des millénaires au fond des lacs. «Il existe deux types de charbons de bois, précise Martin Lavoie. Les charbons microscopiques, transportés dans le panache de fumée sur des distances variables selon les vents, qui permettent de reconstituer l’histoire des feux régionaux, et les charbons macroscopiques, qui documentent l’histoire des feux dans les environs immédiats du lac où ils se déposent.» Grâce aux charbons et à leur datation radiocarbone, de même qu’aux grains de pollen retrouvés dans les sédiments lacustres, les chercheurs parviennent à reconstituer l’histoire végétale d’une région, notamment la séquence des feux qui y sont survenus.
Les données fournies par Martin Lavoie à cette vaste étude, dirigée par des chercheurs de l’University of Oregon, proviennent des travaux qu’il a menés au lac Albion, situé dans les Cantons-de-l’Est. Les sédiments de ce lac racontent plus de 13 000 ans d’histoire végétale. Ces données et celles provenant de 34 autres lacs ont mis en lumière une relation très nette entre l’augmentation de la biomasse, l’incidence des feux et les réchauffements climatiques rapides survenus il y a 13,9, 13,2 et 11,7 milliers d’années.
Par ailleurs, l’étude a permis de réfuter l’hypothèse voulant qu’une comète tombée sur le Canada, il y a 12 900 ans, ait déclenché une gigantesque vague de feux de forêt en Amérique du Nord. «Aucune tendance continentale n’a été observée à cette époque», constate le professeur Lavoie. Dans la même veine, les chercheurs n’ont pu établir de lien entre l’abondance des feux et l’extinction de nombreuses espèces de grands mammifères survenue à la fin de la dernière glaciation.