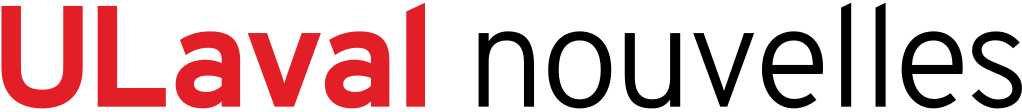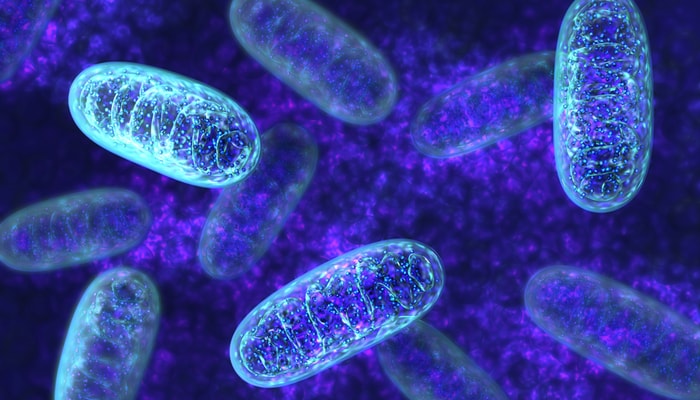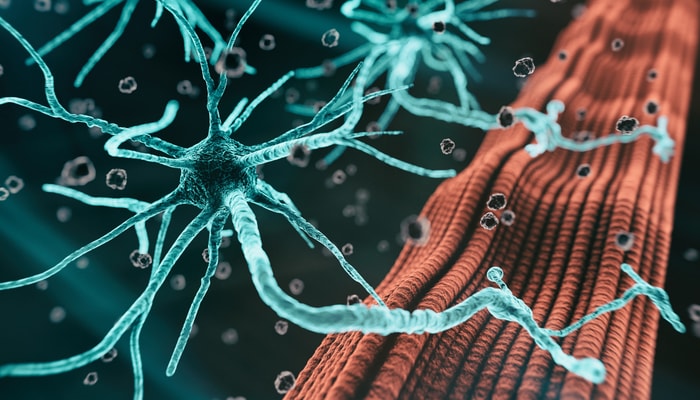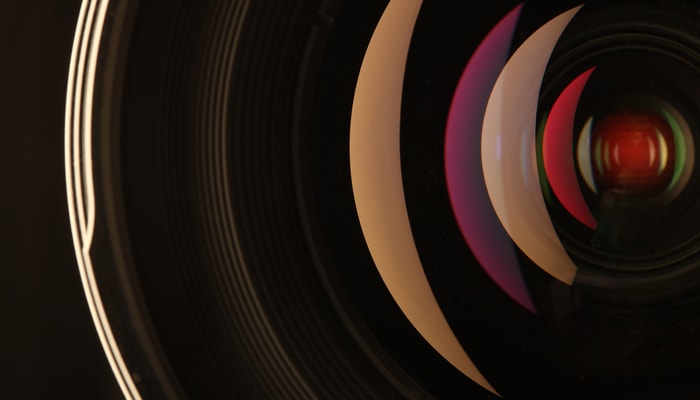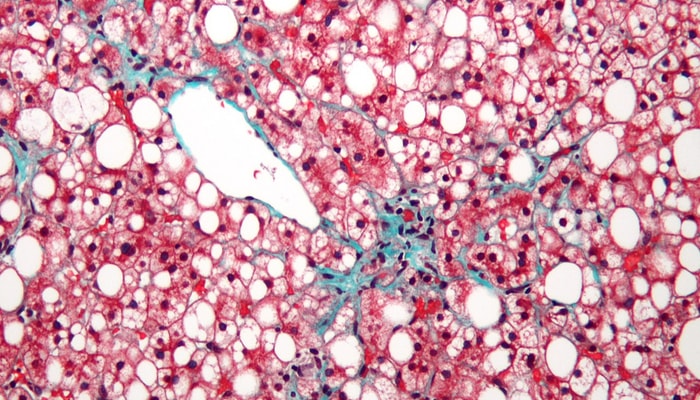— Getty Images/MelodyanneM
À quelque chose malheur est bon, dit l'adage. On serait porté à le croire à la lecture d'une étude publiée dans Biological Conservation par une équipe du Département de biologie et du Centre d'études nordiques de l'Université Laval. Ces chercheurs ont profité des conditions particulières qui ont prévalu pendant les trois premières années de la pandémie de COVID-19 pour répondre à une question qu'ils auraient difficilement pu étudier autrement: comment réagiraient les oies des neiges si on réduisait de moitié la pression de chasse au printemps et si on la doublait lors des printemps subséquents?
«La chasse printanière à l'oie des neiges était permise au Québec au printemps 2020, mais les mesures sanitaires, notamment celle qui restreignait les déplacements entre régions, ont fait en sorte qu'il y a eu moins de chasseurs. La pression de chasse est remontée dès l'année suivante après l'assouplissement des mesures sanitaires», souligne le premier auteur de l'étude, le doctorant Frédéric LeTourneux. Le nombre d'oies récoltées par les chasseurs au printemps en fait foi. En 2020, ce chiffre a atteint 10 600. En 2021 et 2022, la récolte d'oies est passée à 21 000 et 24 000 respectivement.
Depuis 1999, l'équipe de recherche, dirigée par les professeurs Gilles Gauthier et Pierre Legagneux, procède périodiquement à la capture d'oies de neiges dans l'estuaire du Saint-Laurent pour évaluer comment la condition physique des femelles évolue pendant les trois dernières semaines qui précèdent leur départ vers les aires de reproduction dans l'Arctique canadien. «Les oies capturées sont pesées et mesurées, ce qui nous permet d'établir un indice de condition physique qui reflète leurs réserves énergétiques», précise Frédéric LeTourneux.

Le doctorant Frédéric LeTourneux et la professionnelle de recherche Maria Belke Brea lors des travaux de terrain au printemps 2020 à l'Île aux Oies. Les chercheurs devaient porter de l'équipement de protection parce qu'on ignorait alors si les oies étaient porteuses du virus de la COVID-19. Quelques semaines plus tard, une étude réalisée sous la direction du professeur Pierre Legagneux concluait que ce n'était pas le cas.
— Pierre Legagneux
Dans les années qui ont précédé 2020 de même qu'en 2021 et 2022, l'indice de condition physique des femelles a suivi un patron identique: il grimpe progressivement entre le début et la fin de la période de captures, un reflet de l'engraissement des oies pendant cette période critique de l'année. Par contre, l'année 2020 a fait exception à cette règle. Les oies ont atteint un indice maximal de condition corporelle environ deux semaines plus tôt que les autres années et il est demeuré stable par la suite.
«Notre hypothèse est qu'en raison de la baisse de la pression de chasse en 2020, les oies étaient moins dérangées, elles devaient moins se déplacer, elles étaient moins stressées et leur efficacité de broutage était plus grande», avance Frédéric LeTourneux.
Fait intrigant, le suivi de femelles muni de colliers GPS a révélé qu'elles avaient passé moins de temps dans les champs agricoles à la fin du printemps 2020 que lors des autres années, même si ce milieu leur offre une source de nourriture riche et abondante. «La chasse printanière se déroule exclusivement dans les champs agricoles, précise le doctorant. Notre interprétation est que les oies ont appris que la fréquentation de ces champs comportait des risques. Lorsqu'elles ont accumulé suffisamment de réserves nutritives, elles semblent alors éviter les champs agricoles.»
— Frédéric LeTourneux, au sujet de l'engraissement rapide des oies survenu au printemps 2020
La chasse printanière à l'oie des neiges a été instaurée en 1998 au Québec en réponse à la croissance rapide de cette espèce. On craignait alors une dégradation de ses habitats dans l'Arctique, dans l'estuaire du Saint-Laurent et sur la côte atlantique des États-Unis, de même qu'une hausse des dommages dans les champs agricoles.
«Cette mesure de conservation a fonctionné parce que les effectifs de l'oie des neiges se sont stabilisés à près d'un million d'individus, souligne Frédéric LeTourneux. Même après deux décennies, elle est toujours efficace parce que les oies ne se sont pas habituées à la chasse et qu'elles répondent encore rapidement aux changements dans la pression de chasse, comme le démontre notre étude. Cela suggère qu'on sous-estime le véritable impact de la chasse printanière sur la dynamique de population de l'oie des neiges lorsque l'on considère uniquement le nombre d'oies récoltées.»
L'étude parue dans Biological Conservation est signée par Frédéric LeTourneux, Frédéric Dulude-de Broin, Thierry Grandmont, Marie-Claude Martin, Gilles Gauthier et Pierre Legagneux, de l'Université Laval, et par Joël Bêty, de l'Université du Québec à Rimouski.