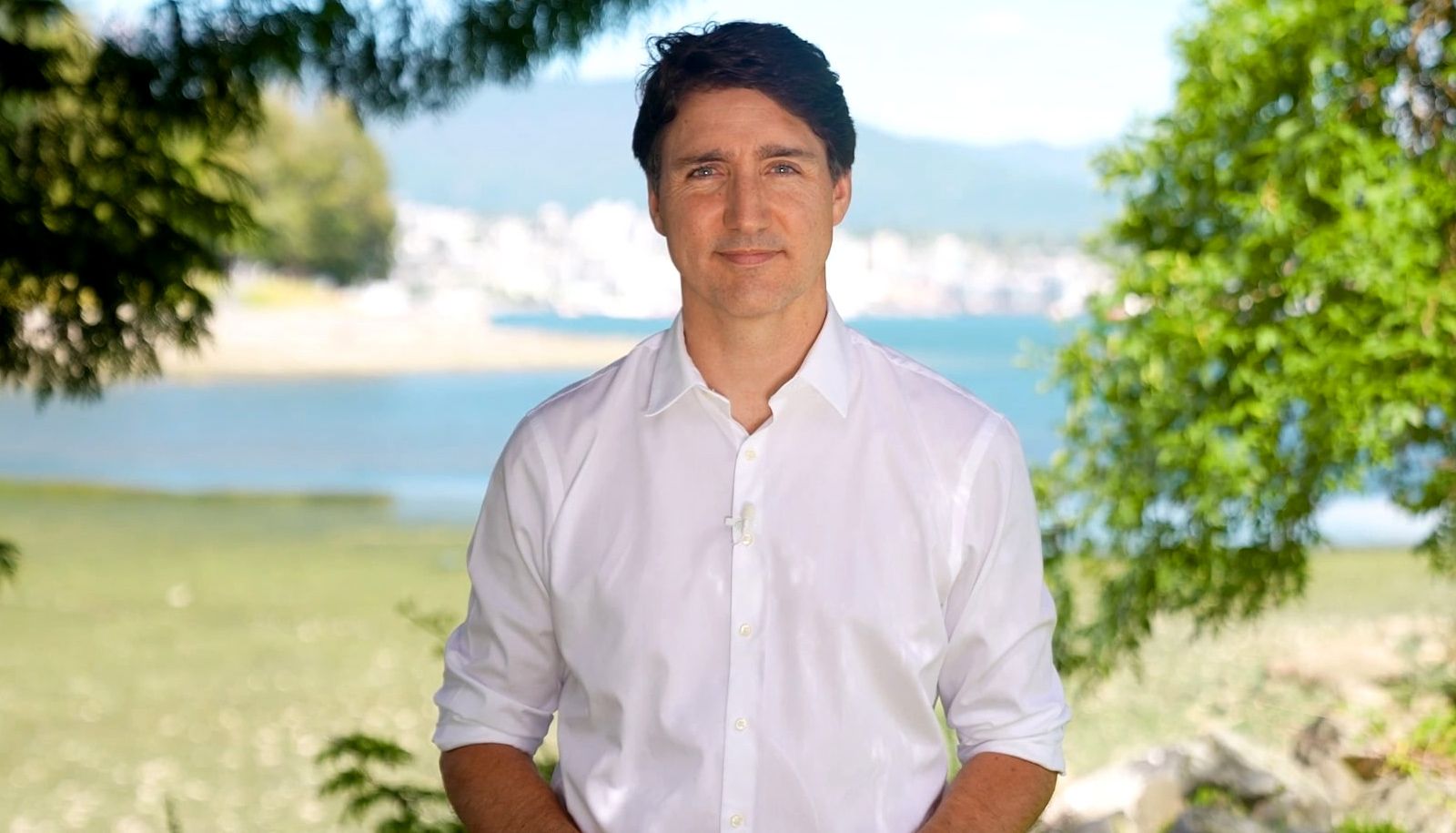Le 28 août 1968, un coup de tonnerre retentissait dans le ciel jusque là assez tranquille du théâtre québécois, bouleversant les règles établies et faisant grincer des dents les puristes de la langue française. Cette date marque en effet la présentation de la pièce Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay au Théâtre du Rideau Vert à Montréal, dont l’extrait cité plus haut est tiré. Première pièce québécoise à employer le joual, Les Belles-Sœurs met en scène 15 femmes d’un quartier populaire de Montréal qui se réunissent le temps d’un après-midi chez l’une des belles-sœurs, Germaine Lauzon, afin de l’aider à coller le million de timbres GoldStar qu’elle a gagné et qui lui servira à se procurer divers objets présentés dans le catalogue de la compagnie. Mais l’atmosphère dégénère rapidement et les vielles rancœurs refont surface. Ayant en commun de mener «une maudite vie plate», les femmes décident de laver leur linge sale en famille, étalant du même coup l’horizon bouché qui est le leur, de même que la vacuité de leur existence et finalement la solitude terrible de l’être humain.
Le vrai monde
«Avec la langue qu’il utilise dans les Belles-Sœurs, Tremblay prend nettement ses distances avec le modèle du théâtre français, affirme Irène Roy, professeur de théâtre au Département des littératures. Des auteurs comme Gratien Gélinas et Marcel Dubé ont créé des personnages tirés de la réalité québécoise mais la langue qu’ils utilisent ne diffère pas tellement du français international. Là, Michel Tremblay arrive et dit : "On va arrêter d’avoir honte et on a va faire parler le monde comme il parle dans la vraie vie." C’est toute une révolution et cela va choquer bien des intellectuels de l’époque qui estimaient que c’était de rabaisser le spectateur que de lui présenter non seulement une pièce en joual mais aussi de montrer le milieu des petites gens.» Au-delà de la langue, Michel Tremblay innove également au plan de la forme, brisant la construction traditionnelle en trois actes et insérant des monologues et des chœurs, s’inspirant ainsi de la dramaturgie grecque.
Claude Poirier, professeur au Département de langues, linguistique et traduction et directeur du Trésor de la langue française, n’hésite pas à dire que la pièce de Michel Tremblay marque le véritable début du théâtre québécois. «Au milieu des années 1960, explique le linguiste, on ne pouvait pas concevoir que la tragédie – car les Belles-Sœurs est bel et bien une tragédie - pouvait s’exprimer en langage populaire. Michel Tremblay, lui, a osé. Il a mis en quelque sorte le joual sur la carte. Selon Claude Poirier, la langue, qui est reflet direct de l’identité d’un peuple, constitue le personnage principal des Belles-Sœurs. «À travers ce langage, Tremblay rend compte d’une société qui est vraiment la nôtre, constate-t-il. Des snobs ont levé le nez devant la pièce mais si l’auteur avait utilisé un français standard, la pièce n’aurait aucun sens.» En utilisant le joual, Michel Tremblay ne fait ni plus ni moins qu’un pied de nez à la langue française. «C’est une sorte de crise existentielle, un passage obligé, conclut Claude Poirier. Une fois le furoncle crevé, on peut passer à autre chose. Regardez le Québec d’aujourd’hui, la langue ne s’y porte pas plus mal qu’ailleurs.»
Traduite en une vingtaine de langues, la pièce Les Belles-Sœurs continue d’être jouée à travers le monde. En 1987, la revue française Lire faisait figurer Les Belles-Sœurs dans sa liste des 49 pièces à inclure dans la bibliothèque idéale du théâtre des origines à nos jours. «C’est une pièce qui ne vieillit pas et qui touche à l’universel, souligne Irène Roy. Chaque personnage de la pièce est un petit morceau d’humanité révélant nos petits travers, nos comportements innés et notre difficulté de vivre. Elle nous émeut parce qu’elle nous parle de nous, tout simplement, quelque soit l’endroit où nous vivons.»