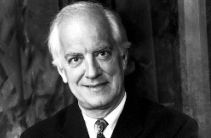
Q L’exportation d’amiante a chuté de moitié au Québec en dix ans pour se limiter en 2009 à près de 152 000 tonnes. Pourquoi relancer le débat sur cette production?
R Notre politique actuelle sur l’amiante est indéfendable et d’une hypocrisie obscène. On prétend collaborer au développement du Tiers-Monde, par exemple en Inde, en mettant à sa disposition un matériau pour bâtir à faible coût ses infrastructures, en sachant très bien qu’il existe des matériaux de substitution. Donc, on agit pour faire du fric, pour défendre 300 ou 400 emplois, et non, comme on le prétend, pour collaborer à des efforts de développement. Cette industrie moribonde est condamnée à disparaître, et c’est déjà pratiquement achevé au Canada. Si le gouvernement investit 58 millions de dollars dans la région d’Abestos, ce devrait être pour faciliter la transition économique des 300 à 400 familles qui tirent encore leur subsistance de cette industrie-là, et non pour rouvrir la mine Jeffrey. Il faudrait aussi établir un registre national des gens exposés à l’amiante, de manière à ce qu’on puisse dédommager convenablement les victimes. Relancer cette industrie serait un désastre. Sur la scène internationale en matière d’amiante, on a une réputation comparable à celle de marchands de tapis malhonnêtes.
Q Pourtant, les producteurs de chrysotile assurent que l’utilisation d’amiante-ciment est très sécuritaire, car les fibres ne se dispersent pas dans l’air.
R C’est à la fois vrai et à la fois faux. Si les produits fabriqués restaient enfermés de manière éternelle, ce serait parfait. Dans les faits, ils s’usent. La CSST vient d’ailleurs de dédommager un travailleur d’entretien ménager dans une commission scolaire. Il a fait une amiantose liée essentiellement à la fibre d’amiante que sa machine brossant les planchers remettait en suspension. Il n’a jamais été exposé autrement à l’amiante. Cela veut dire que la capacité de fixer la fibre dans les produits où on la retrouve est beaucoup moins fiable que ce que l’on pensait. Ces matériaux-là sont partout, même dans les bardeaux utilisés pour les lambrissages ignifuges extérieurs des maisons et qui résistaient si bien aux variations de température. Or, il s’avère à l’occasion qu’ils ne sont pas si stables. Parler d’une utilisation sécuritaire de l’amiante, c’est aussi ridicule que de parler d’une façon sécuritaire de tomber du 15e étage. Pour pouvoir appliquer les protections recommandées par l’industrie, il faudrait disposer d’une usine climatisée, ventilée, avec des travailleurs qui porteraient pratiquement un scaphandre. Parmi les entreprises qui achètent les panneaux d’amiante pour les découper et fabriquer des cages ignifuges par exemple, très peu peuvent réunir de telles conditions. Sur un chantier de construction ou de démolition de bâtiments, c’est impossible de protéger les gens correctement avec nos méthodes de travail. On ne peut pas faire travailler les ouvriers dans des combinaisons spatiales!
Q Comment agir, alors?
R Si les citoyens du Québec connaissaient la nature du problème, je pense qu’ils fourniraient à leurs élus le courage politique qui leur fait défaut sur cette question. La population d'ici se fait intoxiquer par une campagne de désinformation financée tant par le gouvernement fédéral que par le gouvernement provincial. Et pour comble d'insulte, les deux niveaux de gouvernement ont des administrateurs sur cette boîte d’intoxication de l’opinion publique, l’Institut du chrysotile. Comme expert en santé publique, je dois m’assurer que l’information est correctement détenue par mes concitoyens, et je vais m’y employer. Notre mémoire, on l’a fait parvenir à tous les partis politiques. Les 57 signataires du mémoire sont tous du parti de la santé publique et travaillent tous bénévolement. Contrairement à ceux d’en face.
Propos recueillis par Pascale Guéricolas


























