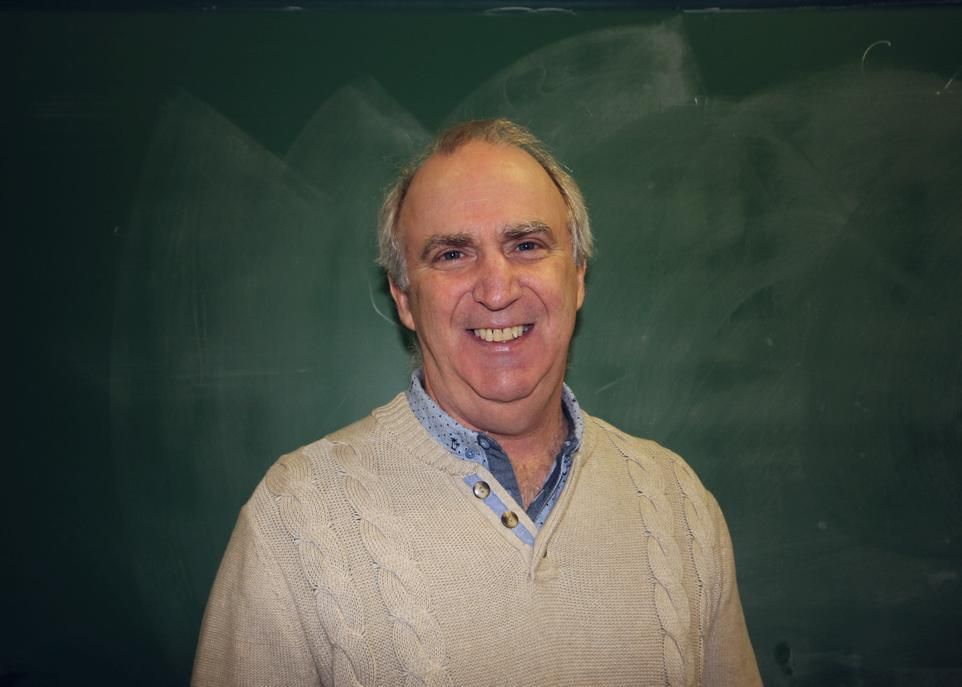
Quelle est la fréquence des embâcles hivernaux au Québec ?
Certains de mes collègues considèrent que les changements climatiques accentuent les températures extrêmes qui peuvent favoriser les embâcles et les débâcles en hiver. Pour ma part, je constate que ce phénomène arrive régulièrement, environ un hiver sur deux. Avec le froid, un couvert de glace se forme sur les rivières et les lacs. Par la suite, un fort débit d’eau ou l’élévation des températures provoque la perte du couvert de glace. Si cela se passe dans le bois, on ne s’en aperçoit pas. D’autres fois, la débâcle fait mal, car elle touche des zones urbanisées comme le quartier Duberger à Québec cette année, ou ceux près des rivières Yamaska et Saint-Jean-sur-Richelieu, par exemple. C’est un peu comme une loterie, avec des gagnants et des perdants. Récemment, notre laboratoire a travaillé sur une modélisation de la formation des glaces et des débâcles de neuf rivières québécoises. Environnement Canada nous a fourni trois scénarios climatiques différents. Avec ces informations, nous pouvons envisager les effets possibles sur la glace et le moment de la débâcle. Tout cela, cependant, dépend des données climatiques à venir.
Prédire avec exactitude le lieu et le moment précis de la formation des embâcles semble donc difficile....
Il existe un très grand nombre de variables, propres à la configuration de chaque rivière, qui expliquent la formation d’un embâcle. Par exemple, des fortes pluies ou des températures très élevées cassent le couvert glacé, ce qui provoque un train de glaces. Les embâcles se forment lorsque ces glaces, entraînées dans la rivière par une forte pente, arrivent dans la plaine plate. Le niveau d’eau va alors monter. Selon une étude, la moitié des dépenses du ministère de la Sécurité publique du Québec liées aux inondations de neuf rivières dans le sud du Québec, concerne d’ailleurs des inondations causées par la glace. Ces données, disponibles depuis 20 ans, montrent donc que les embâcles font partie de la réalité québécoise. Avec le ministère de la Sécurité publique, nous avons d’ailleurs le projet de mettre sur pied une banque d’informations sur ce phénomène afin de disposer de relevés de terrain précis. Pour l’instant, il n’existe pas encore de cartes. C’est normal qu’au 21e siècle nous nous donnions des règles de sécurité liées aux possibles inondations par embâcle. De cette façon, nous allons pouvoir réduire notre vulnérabilité face à ce phénomène, car les outils et les modèles manquent, d’autant plus qu’aucun ministère actuellement n’a la responsabilité de veiller là-dessus.
Quels sont les moyens pour protéger les zones habitées des effets des embâcles ?
Il est très difficile d’abaisser les risques, même si certaines interventions pour « gérer la glace » existent. D’une part, on peut arrêter le train de glaces en amont de la ville à l’aide d’une estacade fixe. Il peut s’agir de piliers de pont sans tablier, qui arrêtent les glaces dans la rivière à la manière d’un peigne. Vous pouvez en voir sur la rivière Saint-Charles à la hauteur de l’autouroute 40. Cette installation a bien fonctionné cet hiver. Malheureusement, le couvert a bougé en aval et a formé un train de glaces qui a inondé une rue du quartier Duberger. D’autre part, certains cours d’eau, comme la rivière Sainte-Anne ou le fleuve Saint-Laurent, disposent d’estacades flottantes, des pontons d’une dizaine de mètres reliés par un câble. C’est notre équipe qui a mis en place ce dispositif sur la rivière Sainte-Anne, en amont de la municipalité de Saint-Raymond. Cela permet de donner un appui au frasil, la pellicule de glace qui s’installe à la surface des eaux. Un couvert de glace se forme donc rapidement derrière l’estacade flottante. Une couche isolante se crée sur la rivière, ce qui limite les échanges de chaleur entre l’eau et l’atmosphère. Le cours d’eau abrite ainsi une bien moins grande quantité de glace, ce qui limite les répercussions de la débâcle. À titre d’exemple, les estacades flottantes installées sur le fleuve Saint-Laurent à Yamachiche et à Verchères contribuent à diminuer la concentration de glaces dans la voie navigable. Les navires ont donc plus de facilité à naviguer.


























