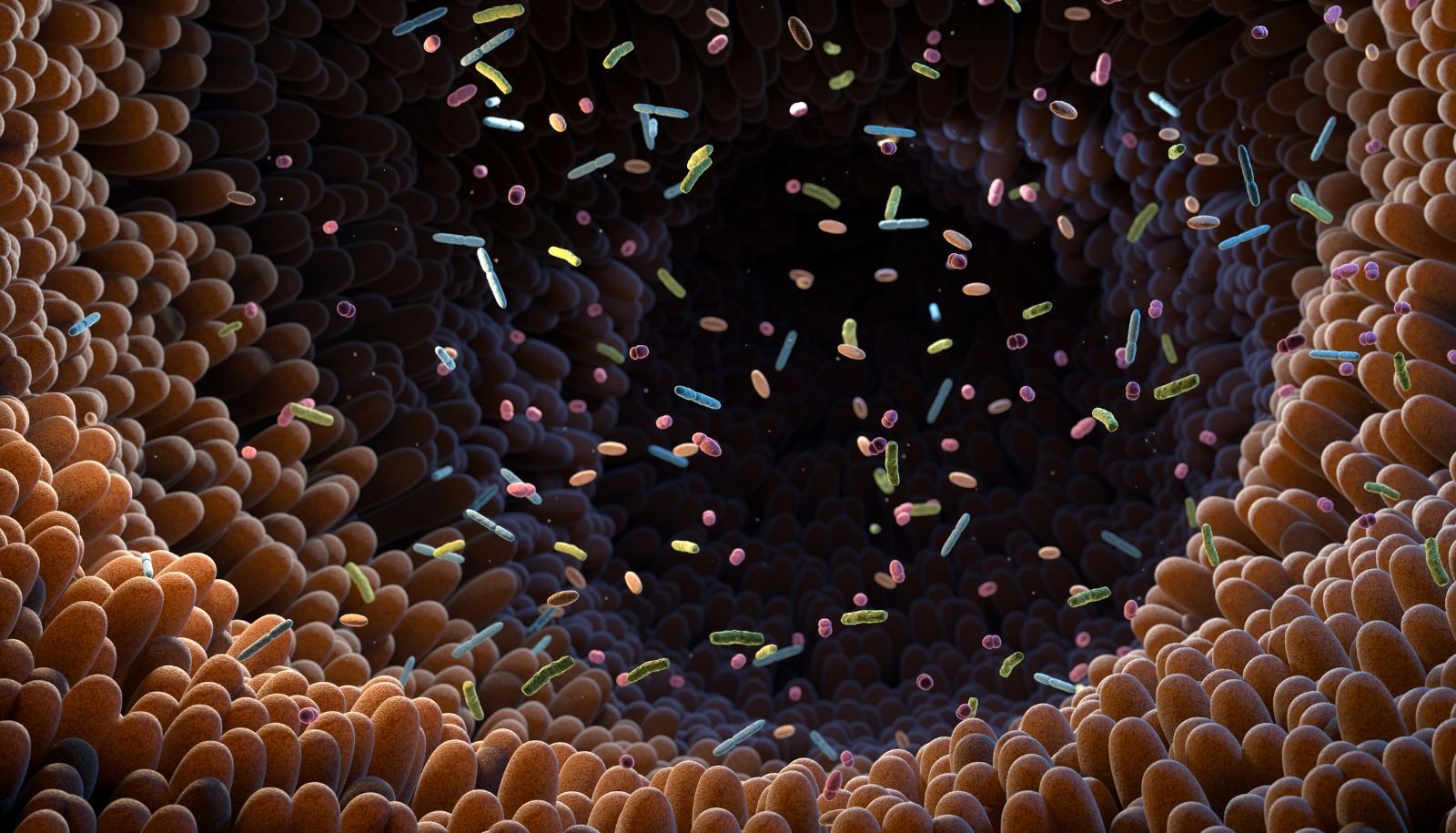Les résultats de l’étude suggèrent que la pratique de la musique pourrait agir sur un mécanisme général de perception du temps commun aux cortex auditif, visuel et tactile.
— Getty Images/iMr Squid
Personne ne sera surpris d'apprendre que les personnes qui s'adonnent sérieusement à la musique sont très bonnes pour estimer avec justesse la durée d'un intervalle entre deux sons. Mais leur horloge interne est-elle aussi efficace lorsque les stimuli qui délimitent l'intervalle sont de nature visuelle ou tactile?
C'est ce qu'a voulu savoir une équipe de l'École de psychologie de l'Université Laval en étudiant la question chez 16 personnes qui jouaient d'un instrument de musique sur une base hebdomadaire depuis au moins 5 ans et qui étaient inscrites à l'Université Laval (groupe musiciens). L'équipe a également effectué les mêmes tests chez 16 personnes qui n'avaient jamais joué d'un instrument et qui n'avaient aucune formation en musique (groupe non-musiciens).
Tous les sujets étaient soumis au protocole expérimental suivant: installés devant un ordinateur dans une pièce tranquille, ils devaient déterminer si l'intervalle entre deux stimuli auditifs, visuels ou tactiles qui leur étaient présentés était court ou long. «Les deux stimuli délimitant l'intervalle pouvaient être de même nature, par exemple auditifs, ou il pouvait s'agir d'une combinaison, par exemple auditif-tactile», précise le doctorant en psychologie Pier-Alexandre Rioux.
Pour des intervalles dont la durée se situait autour de 250 millisecondes (ms), l'intervalle court entre les stimuli auditifs était de 240 ms alors que le long était de 260 ms. Pour les stimuli visuels et tactiles, ces intervalles étaient respectivement de 225 et de 275 ms. Enfin, pour les stimuli hybrides, ils étaient de 210 et de 290 ms, peu importe la combinaison. Ces tests ont été répétés avec des intervalles de plus de 1 seconde; l'écart entre les intervalles courts et les intervalles longs était alors 5 fois plus grand que dans la première série de tests.
Les résultats de ces expériences, qui ont fait l'objet d'une publication dans la revue Attention, Perception & Psychophysics, sont nets. Premier constat: globalement, le pourcentage de réponses correctes est plus élevé dans le groupe musiciens que dans le groupe non-musiciens. Second constat, peu importe la nature des stimuli, les sujets du groupe musiciens font mieux que ceux du groupe non-musiciens. Troisième constat, ces différences sont observées aussi bien pour les intervalles courts que pour les intervalles longs.
«Dans l'ensemble, nos résultats suggèrent que les musiciens arrivent mieux que les non-musiciens à discriminer la durée d'un intervalle, peu importe la nature des stimuli et la durée de l'intervalle, résume Pier-Alexandre Rioux. Ces résultats suggèrent que la pratique de la musique agit sur un mécanisme interne général de perception du temps. Toutefois, on ne peut exclure la possibilité que ce soit une aptitude naturelle pour le rythme et la perception du temps qui conduit les gens vers la pratique de la musique.»
L'étude parue dans Attention, Perception, & Psychophysics est signée par Pier-Alexandre Rioux, William-Girard Journault, Christophe Grenier, Eudes Saiba Ndola, Antoine Demers et Simon Grondin.