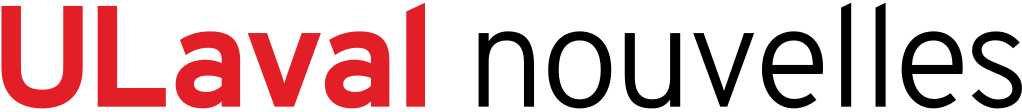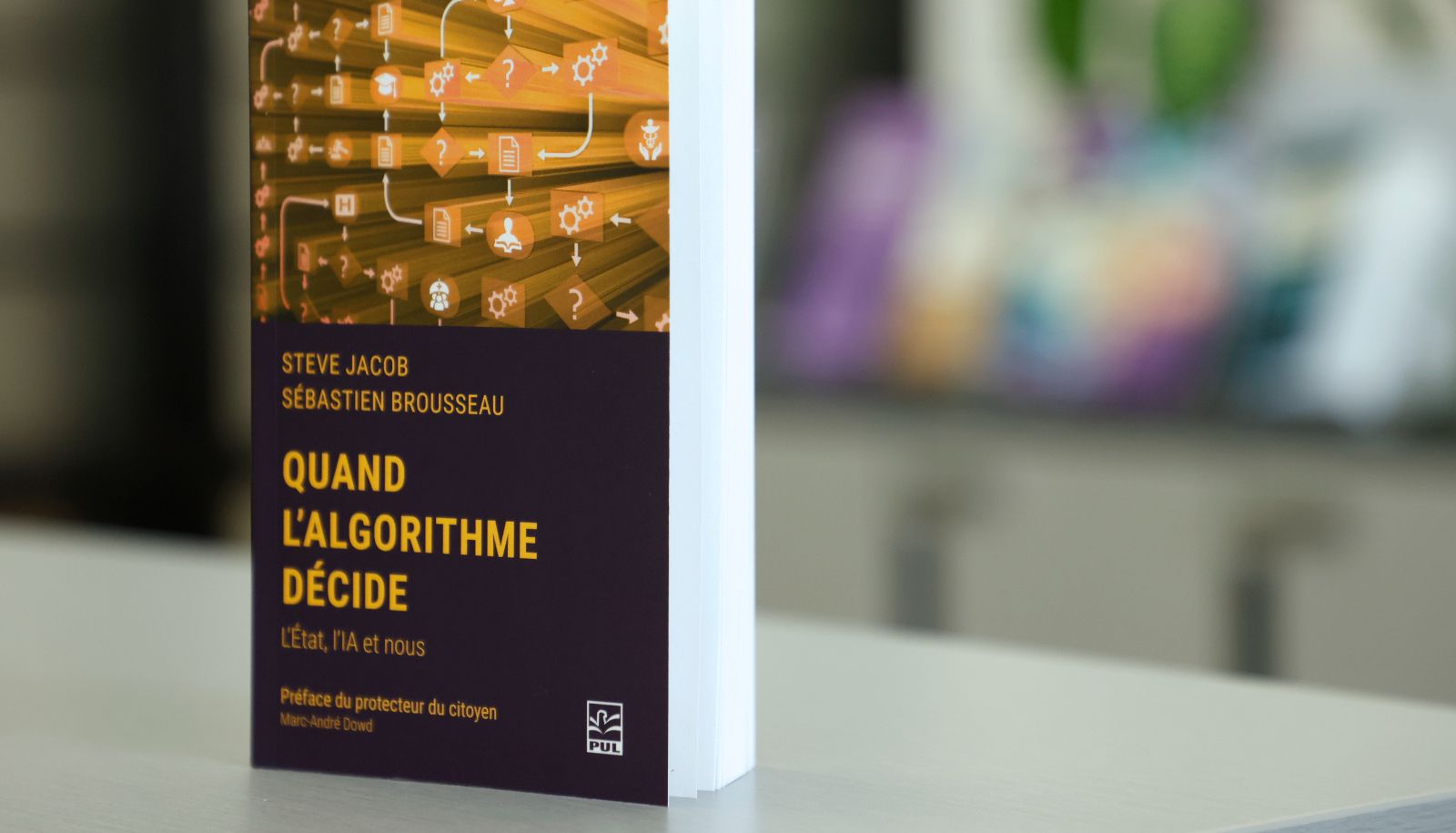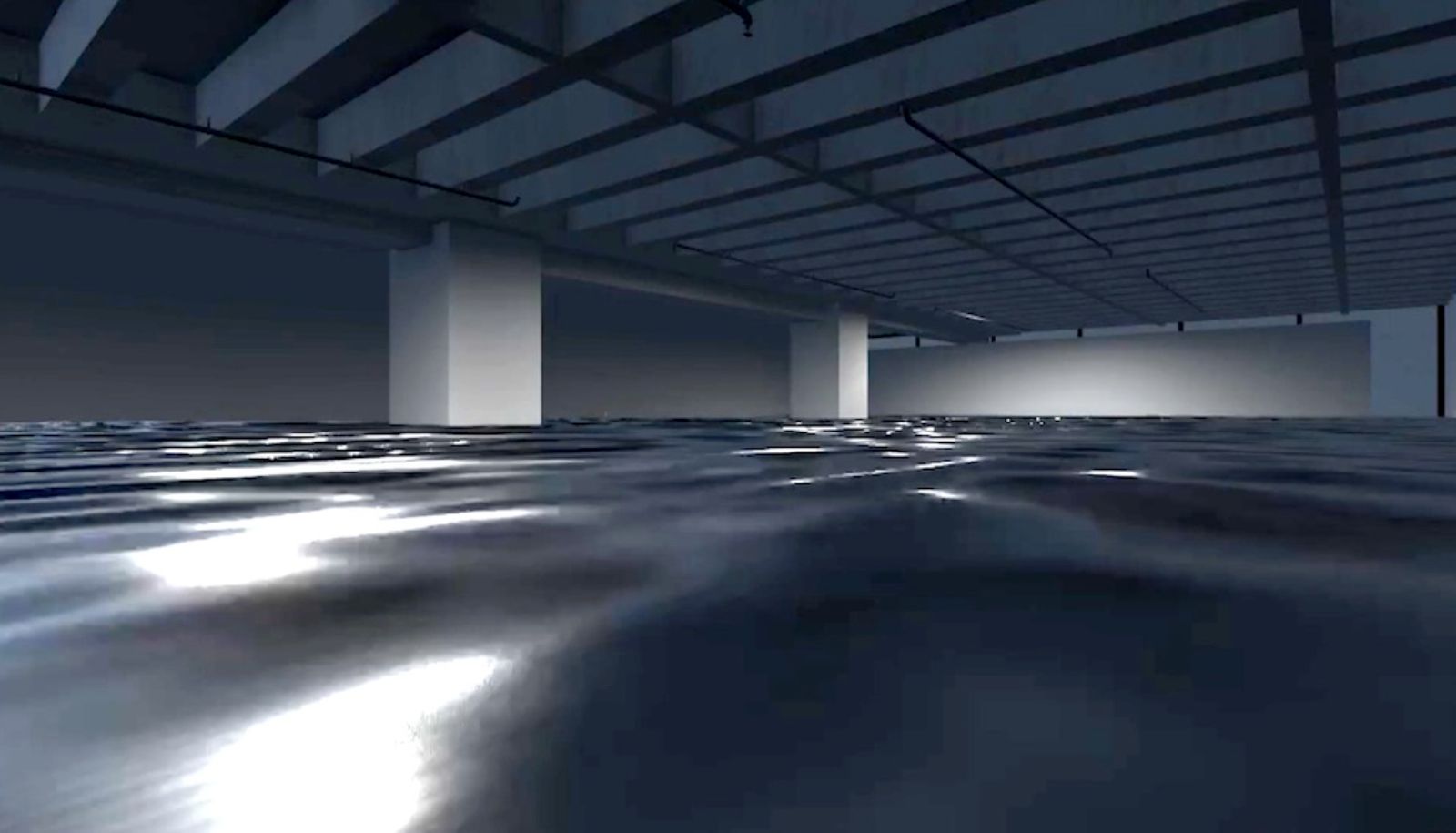Gabrielle Fortin, professeure à l'École de travail social et de criminologie
— Yan Doublet
Dans la salle où se déroule le colloque annuel du Centre de recherche Jeunes, familles et réponses sociales de l'Université Laval, plusieurs larmes sont essuyées le 9 février au matin. Gabrielle Fortin, professeure à l'École de travail social et de criminologie, donne un atelier pour aider à comprendre et à accompagner les jeunes parents atteints d'un cancer avancé et leur famille. En trame de fond, elle raconte le parcours de son amie Chantal, qui a eu un diagnostic de cancer très rare après la naissance de sa fille.
Toutes les deux se sont liées d'amitié, alors que leurs filles fréquentaient la même garderie. Elles ont magasiné ensemble les sacs d'école pour leur rentrée à la maternelle, en parlant autant de la peur de la mort que de la maladie. «J'étais sensible à sa situation, ça la rassurait de savoir qu'elle pouvait me parler sans tabou, sans avoir peur de blesser, de remuer certaines émotions difficiles qu'elle vivait», témoigne la professeure, qui est aussi travailleuse sociale à la Maison Michel-Sarrazin et au Centre Bonenfant-Dionne depuis 2011.
Depuis deux ans, elle planche sur un projet de recherche pour lequel elle a interrogé 13 professionnels de la santé qui interviennent en oncologie et en soins palliatifs auprès de jeunes parents atteints d'un cancer avancé. Elle poursuit sa collecte de données auprès des patients eux-mêmes et de leurs proches pour mieux les comprendre. L'atelier qu'elle présente est un mariage de ses expériences.
En revenant sur le vécu de son amie, la professeure Fortin relate qu'à la première journée d'école de sa fille, Chantal a fait un accident vasculaire cérébral. Elle a toutefois attendu la fin du déroulement de la rencontre de parents et de la rentrée avant de parler de ses symptômes et d'être finalement hospitalisée. Après cet incident, elle lui a confié ne pas avoir osé dire à son conjoint qu'elle pensait ne pas pouvoir remonter la pente cette fois-ci. Elle est décédée quelques semaines plus tard, sans jamais avoir arrêté de s'impliquer comme bénévole à l'école.
«Pendant toute la trajectoire de Chantal, on ne lui a jamais offert de soutien psychologique ni psychosocial. Il a fallu qu'elle dise ne pas se sentir bien pour finalement recevoir de l'aide pour elle, mais il n'y en avait pas de disponible pour son conjoint ni pour ses parents, qui allaient perdre leur fille et ne savaient plus comment se situer dans leur rôle de grands-parents.» Cette histoire, Gabrielle Fortin tenait à la faire connaître, car «elle n'est pas anecdotique». Elle rejoint celle de beaucoup de jeunes adultes, de conjoints, de coparents, d'enfants et de grands-parents.
— Gabrielle Fortin
Un témoignage revient souvent dans la bouche des personnes malades: «Je me sens seule, même si je suis entourée». Gabrielle Fortin parle de la «triple marginalisation» qui affecte cette population. «Premier facteur d'isolement, dit-elle, la majorité des jeunes adultes qui vont vivre un cancer sont dans une trajectoire de guérison, et la majorité des services vont dans ce sens. Il y en a très peu qui sont spécifiques à leurs besoins, donc ils sont mal servis par ce qui est en place en oncologie.»
Le deuxième facteur de marginalisation est en lien avec l'entourage, poursuit la professeure. «Beaucoup de proches sont dans l'espoir et ont un discours qui va être encourageant. Ils vont dire que ça va aller, que les médecins vont trouver une solution pour les guérir. Donc, c'est très difficile pour les jeunes adultes de se confier aux gens de leur entourage, parce qu'ils veulent les protéger.»
Le troisième facteur d'isolement vient des services de soins palliatifs. «La population qui en bénéficie est souvent plus âgée, et à un stade de vie différent, donc ça peut être difficile de faire part du vécu dans les groupes de soutien. On constate que les personnes âgées se sentent mal de vivre difficilement leur fin de vie, de parler de leurs préoccupations par rapport à la mort, quand elles se comparent.» Une situation inconfortable pour tout le monde, résume-t-elle.
Au sentiment d'isolement vécu par les jeunes parents atteints d'un cancer avancé s'ajoute un fort sentiment de culpabilité, a constaté la professeure Fortin. «Ils veulent maintenir les routines familiales, mais avec la baisse d'énergie, ils ont l'impression qu'ils ne sont plus de bons parents.» Les entretiens font aussi ressortir leur difficulté à déléguer des responsabilités. «Ces gens-là veulent passer le plus de temps possible avec leurs enfants. Ils n'ont pas besoin d'aide pour les faire garder, mais apprécieraient qu'on vienne laver le plancher ou qu'on leur cuisine une lasagne. Ce qui est plus difficile à demander», illustre la chercheuse.
Elle explique que ces jeunes parents ont peur d'être oubliés, qu'ils jonglent constamment avec le dilemme de protéger leur enfant, tout en le préparant à accepter ce qui s'en vient. «Avec mon amie Chantal, on a préparé une boîte à souvenirs pour sa fille. Elle a répondu à une série de questions que je lui ai posées, elle a fait des cartes d'anniversaire à l'avance. Tout a été déposé dans une boîte en bois créée par son conjoint, avec le châle dans lequel elle est décédée et avec son parfum. Ce projet a été "soutenant" pour elle. Au-delà de la maladie, elle gardait son rôle de maman. Il a été "soutenant" pour son conjoint aussi.»
Les travaux de recherche de Gabrielle Fortin soulèvent le peu de soutien offert à l'entourage, qui est aussi en détresse. Elle décrit la surcharge dans les rôles et les tâches des conjointes et des conjoints, qui n'osent pas se plaindre. «Personne ne leur demande comment ils vont, l'attention est concentrée sur la personne malade. Eux aussi vivent un grand sentiment de solitude», dit-elle. Elle parle de leur stress d'assurer la sécurité financière de la famille, de leur impuissance à voir leur partenaire diminuer, de leur culpabilité de penser à «l'après». Elle dépeint aussi les difficultés des grands-parents, encore souvent sur le marché du travail, qui veulent s'impliquer tout en préservant l'autonomie et l'intimité des parents, qui s'inquiètent parfois de la suite de leur relation avec leur petit-enfant une fois leur fille ou leur fils décédé.
Les professionnels qui accompagnent les jeunes parents atteints d'un cancer avancé sont aussi affectés par ces tragédies, signale la professeure Fortin. Elle estime qu'il faut réfléchir à des espaces bienveillants pour qu'ils puissent se libérer d'une charge émotionnelle qui est parfois très grande. «Un mardi clinique une fois par mois pour en discuter, ce n'est pas suffisant», dit-elle en parlant de besoins plus ponctuels. Elle souligne que, bien souvent, les intervenants n'en parlent pas à la maison, «parce qu'ils ne seront pas nécessairement compris ou qu'ils ne veulent pas alourdir leur vie familiale».
Son équipe de recherche n'est pas épargnée, a-t-elle convenu, en répondant à une personne dans l'assistance. «Après une entrevue où la personne nous retrace son vécu, des premiers symptômes de la maladie à aujourd'hui, il y a forcément une implication émotive. On se téléphone ensuite pour se dire comment on se sent. C'est quelque chose d'assez facile à mettre en place», suggère la professeure Fortin.
En marge de l'atelier, elle pourrait poursuivre longtemps sur ce sujet qui lui tient tant à cœur. La conversation bifurque sur le livre Oscar et la dame rose, d'Eric-Emmanuel Schmitt. En résumé, Mamie-Rose est une ancienne infirmière qui n'a peur ni de la mort ni de la vérité. Pour aider Oscar à faire face à sa maladie et à l'ultime issue, elle lui propose d'écrire régulièrement des lettres à Dieu, alors que chaque jour pour lui aura une durée de 10 ans. Un outil d'accompagnement qu'elle recommande pour nourrir la réflexion sur la fin de vie, la difficulté d'en parler, de l'aborder.