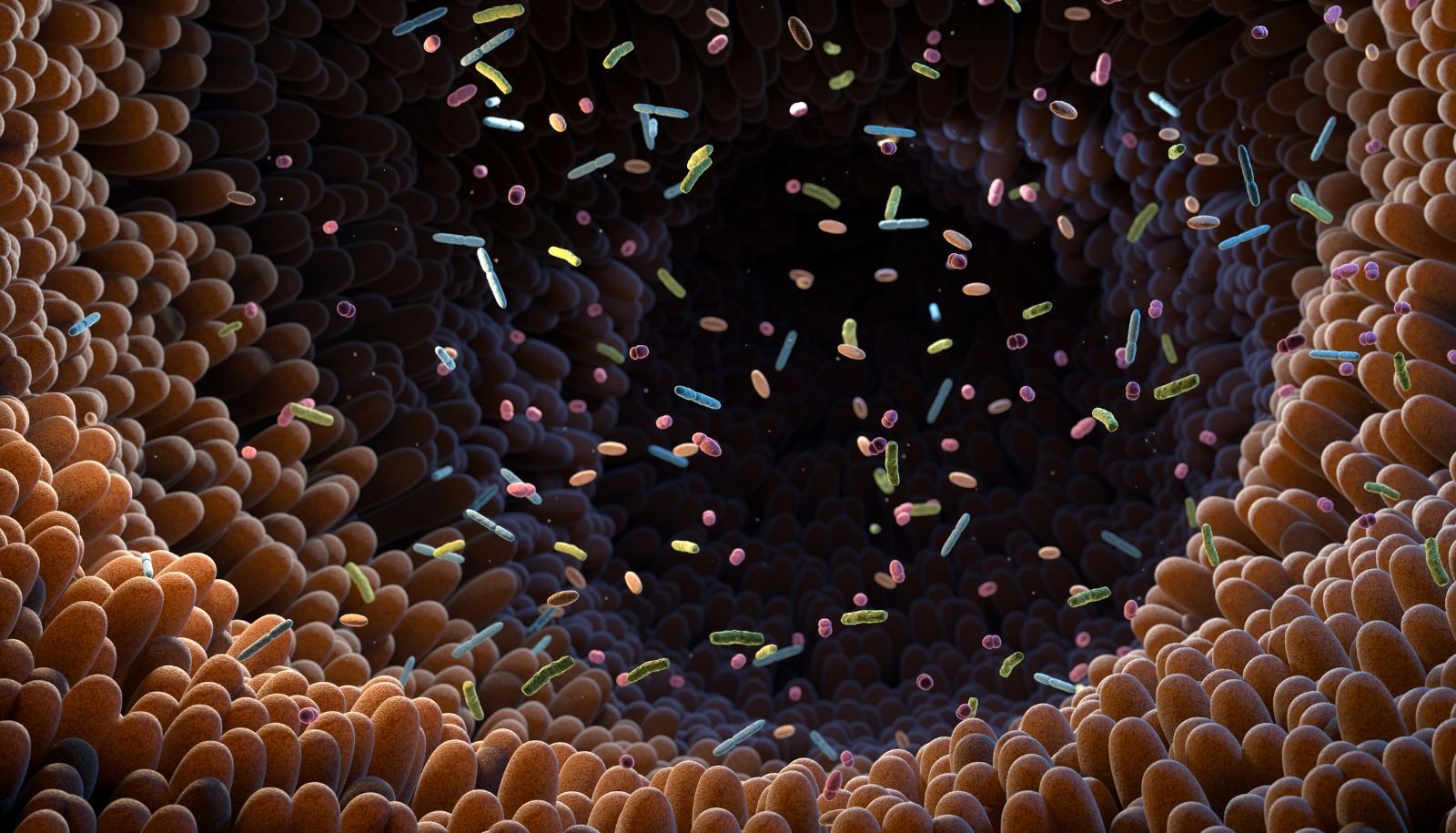Les cercles blancs que l'on voit sur cette image prise au microscope sont des gouttelettes de lipides qui s'accumulent dans les cellules hépatiques de personnes atteintes de la maladie du foie gras. Chez les gens qui en souffrent, les lipides représentent plus de 5% du poids du foie.
— Dr David Kleiner/National Cancer Institute/NIH
Une équipe internationale a découvert sept nouveaux gènes associés à la maladie du foie gras, un désordre métabolique qui frapperait, souvent à leur insu, 20% des adultes canadiens. «L'étude que nous publions aujourd'hui dans Cell Reports Medicine est le fruit de la plus importante recherche réalisée jusqu'à présent sur l'architecture génétique de cette maladie. Certains des gènes candidats que nous avons découverts ouvrent la voie aux premiers traitements pharmacologiques contre cette maladie», souligne le responsable de l'étude, Benoît Arsenault, professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.
Désignée par les scientifiques sous le nom de stéatose hépatique non alcoolique, la maladie du foie gras provoque une accumulation anormale de lipides dans le foie. Cette surcharge lipidique n'est pas liée à la consommation d'alcool. «Il s'agit d'une maladie qui, dans la plupart des cas, est asymptomatique, mais qui cause néanmoins des bouleversements métaboliques associés à des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et les dyslipidémies, précise le professeur Arsenault. Pour la détecter, il faut avoir recours à l'imagerie médicale. Chez les gens qui en souffrent, les lipides représentent plus de 5% du poids du foie.»
Le surpoids est un facteur de risque important de la maladie du foie gras, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire, précise le chercheur. «Plusieurs personnes qui ont un surpoids ne souffriront jamais de cette maladie, alors que des personnes minces pourront en être atteintes. C'est cette hétérogénéité qui nous a donné l'idée d'examiner la possibilité qu'il existe des gènes de susceptibilité à cette maladie.»
L'équipe du professeur Arsenault et ses collaborateurs estoniens et américains ont analysé des données génomiques provenant de cohortes américaine, britannique, estonienne et finlandaise. Au total, les chercheurs disposaient d'informations sur 8434 personnes qui avaient reçu un diagnostic de maladie du foie gras et sur 770 180 personnes qui n'étaient pas atteintes par cette maladie.
— Benoît Arsenault, au sujet du gène candidat LPL
«En comparant leur génome, nous avons repéré sept nouveaux gènes candidats associés à la maladie. Le plus intéressant est le gène LPL exprimé dans le tissu adipeux. Il code pour la lipoprotéine lipase, une enzyme qui favorise l'entreposage des lipides. Lorsque ce gène est sous-exprimé dans le tissu adipeux, les lipides y sont moins stockés, ils circulent dans le sang et ils peuvent se retrouver dans des organes comme le foie ou le cœur, ce qui est très dommageable pour la santé.»
Le professeur Arsenault signale que plusieurs traitements pharmacologiques contre la maladie du foie gras sont en cours d'évaluation, mais qu'il n'existe pour le moment aucun traitement approuvé. La découverte du rôle du gène LPL dans cette maladie pourrait accélérer les choses. «Des molécules qui empêchent l'inhibition de l'enzyme LPL sont présentement testées pour le traitement de certaines maladies cardiaques. Si les résultats sont concluants, on pourrait envisager leur utilisation dans le traitement de la maladie du foie gras», propose le chercheur.
Les autres chercheurs de l'Université Laval qui signent cette étude sont Nooshin Ghodsian (première auteure), Émilie Gobeil, Nicolas Perrot, Hasanga Manikpurage, Éloi Gagnon, Jérôme Bourgault, Alexis St-Amand, Christian Couture, Patricia Mitchell, Yohan Bossé, Patrick Mathieu, Marie-Claude Vohl, André Tchernof et Sébastien Thériault.