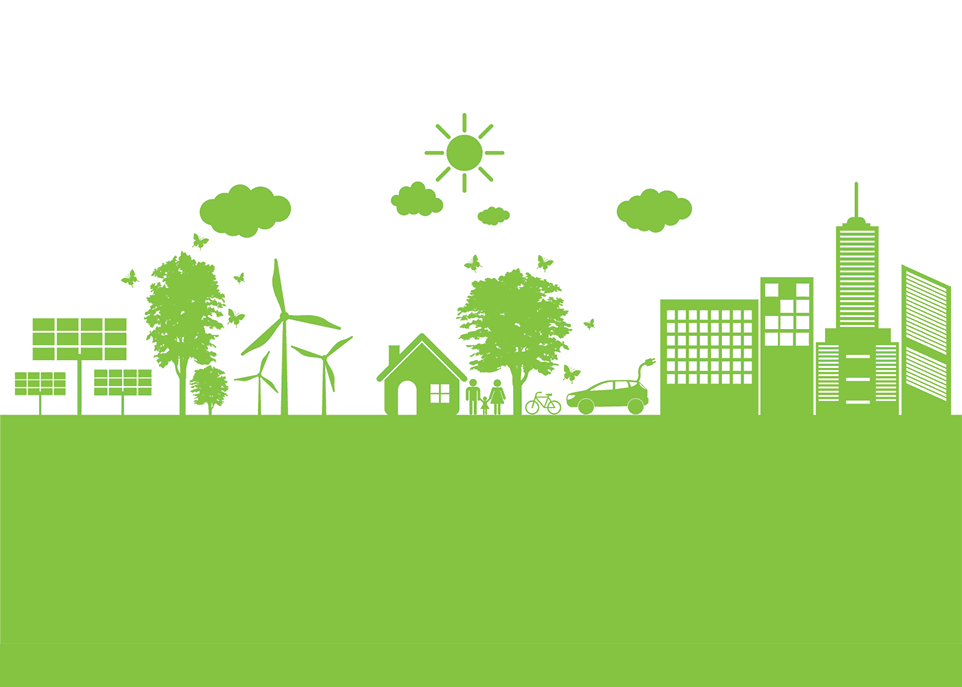
Quelles sont les grandes lignes de ce plan?
Même si certains détails manquent encore, on sait que le gouvernement fédéral prévoit notamment investir dans l'électrification des transports et créer des quotas dans ce domaine d'activité. On souhaite ainsi, par exemple, incorporer progressivement des carburants renouvelables, comme l'éthanol, dans l'essence disponible à la pompe. Les importateurs et les producteurs d'hydrocarbures devront donc atteindre des cibles de réduction de l'intensité en carbone de leurs combustibles, calculées par quotas. Détail important, la durabilité fera partie du calcul. L'expérience de l'Europe montre que les biocarburants de première génération, issus souvent du maïs, ont eu pour effet de concurrencer les terres agricoles disponibles pour la production alimentaire. En plus, ce type de culture requiert des produits chimiques. Il est possible, cependant, d'opter pour des biocarburants performants de seconde génération afin de réduire les GES. Plutôt que d'utiliser du maïs, certains fournisseurs de combustibles pourraient avoir recours, par exemple, à des biocarburants provenant de l'exploitation forestière. Cette méthode présente l'avantage d'améliorer la durabilité des biocarburants produits.
Malgré ce plan, le Canada peine toujours à respecter les engagements de réduction des GES pris auprès des autres pays de la planète….
La semaine dernière, la commissaire à l'environnement et au développement durable a d'ailleurs dénoncé les subventions du gouvernement canadien aux producteurs d'hydrocarbures. En effet, ces subventions existent encore, alors que le Canada s'est pourtant engagé auprès du G7 et du G20 à éliminer progressivement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles d'ici 2025. En fait, la commissaire reproche au gouvernement de ne pas avoir encore défini clairement ce qu'est une subvention inefficace ni d'avoir déterminé de façon exhaustive quelles sont actuellement ces subventions inefficaces. Il faut savoir qu'en moyenne un Canadien émet 40% de plus de CO2 qu'un Allemand chaque année. Cette différence s'explique en partie par l'augmentation de 42% des émissions de CO2 liées aux transports depuis 1990. Ainsi, les statistiques montrent qu'en 2016 le secteur des transports constituait la deuxième plus importante source des émissions de GES au Canada. Il semble donc urgent de s'attaquer à ce problème, d'autant plus qu'on sait très bien que ces gaz jouent un rôle majeur dans les changements climatiques, des changements qui se traduisent par l'intensification et l'augmentation des fréquences des catastrophes naturelles et qui ont un coût économique non négligeable.
Comment expliquer que le Canada peine à atteindre ses cibles de réduction internationales?
La constitution canadienne établit une distinction entre les compétences qui relèvent des provinces et les autres qui incombent au fédéral. Ce palier de gouvernement ne peut donc pas tout faire en matière d'environnement, d'autant plus que le développement de projets économiques relève du provincial, notamment en matière d'énergie, de ressources naturelles et de transport. Même si le Canada prend une série d'engagements pour l'ensemble du territoire auprès de ses partenaires internationaux, l'atteinte des objectifs dépend donc en bonne partie des provinces et des moyens utilisés. Conscients du problème, des avocats spécialisés en droit de l'environnement ont proposé un projet de loi afin de mettre en œuvre le Pacte pour la transition écologique de Dominic Champagne. Il vise à créer un «test climat» vraiment efficace pour les nouveaux projets de développement et à effectuer une évaluation régulière des émissions de gaz à effet de serre. Le but, bien évidemment, c'est d'atteindre les objectifs de réduction des GES. En février, cependant, le gouvernement a rejeté une motion des trois partis d'opposition destinée à présenter ce projet de loi.



























