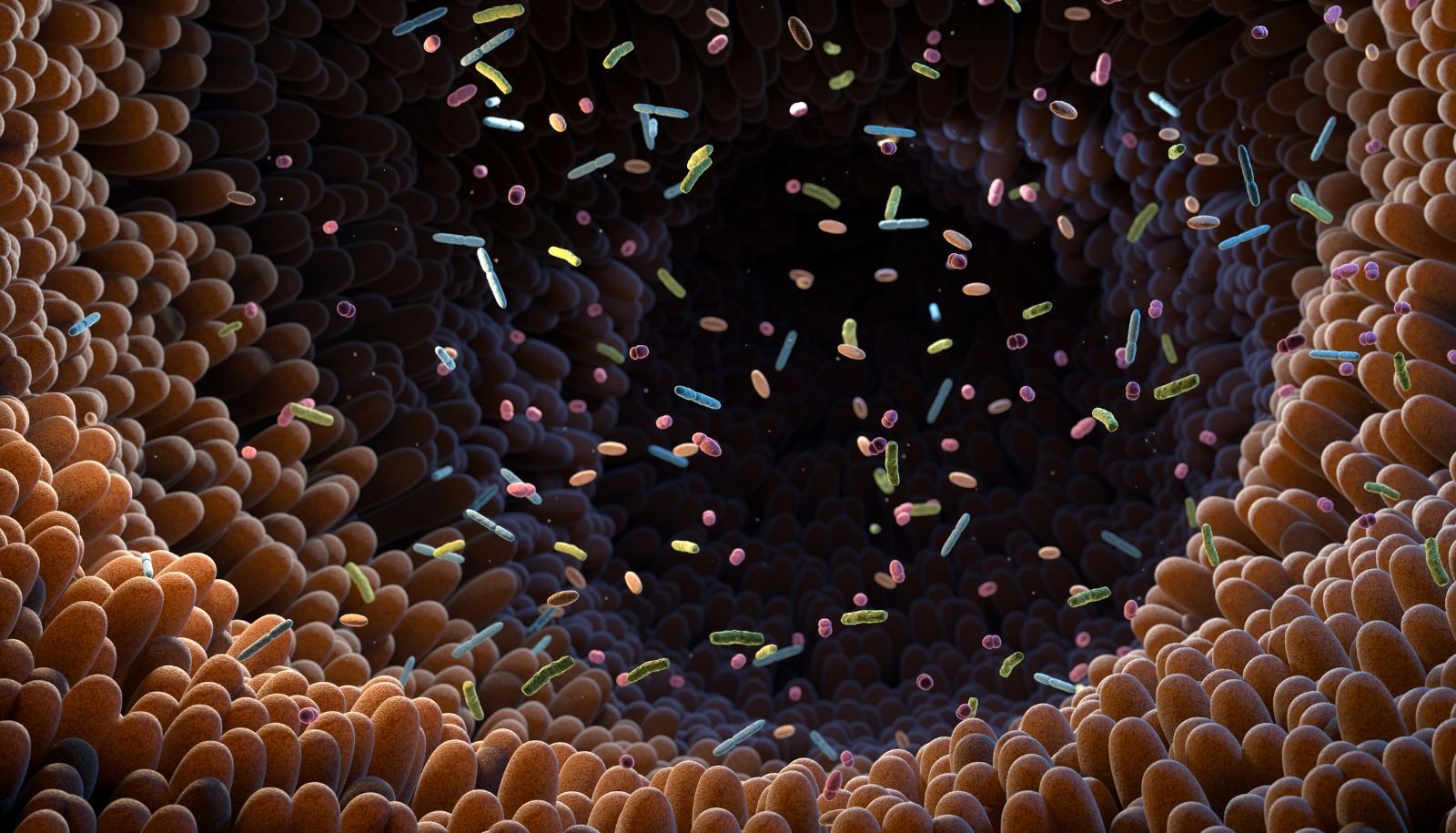Une partie des bouteilles provenant de l'Empress of Ireland qui sont conservées dans les collections du Musée maritime du Québec à L'Islet-sur-Mer.
— Jean-Sébastien Veilleux/Musée maritime du Québec
«Ce sont les responsables du Musée maritime du Québec qui nous ont demandé de procéder à cette investigation, souligne le professeur Normand Voyer. Cette demande s'inscrivait dans leur programme d'activités marquant le 100e anniversaire du naufrage de l'Empress of Ireland.» Les chercheurs ont d'ailleurs livré le fruit de leur enquête lors d'un événement présenté le 29 mai à L'Islet-sur-Mer.
L'Empress of Ireland est entré en collision avec un charbonnier norvégien au large de Rimouski dans la nuit du 29 mai 1914, faisant 1012 victimes. Les cales du transatlantique contenaient d'abondantes provisions d'alcool en prévision du long voyage Québec-Liverpool. Depuis le naufrage, de nombreuses bouteilles ont été ramenées à la surface par des plongeurs. Le Musée maritime possède dans ses collections une quarantaine de ces bouteilles qui ont passé un demi-siècle sous l'eau. Aucune étiquette ne permet d'en établir le contenu, mais leur forme suggère qu'il s'agissait de vin et de bière. Impossible de conclure quoi que ce soit à partir des tests organoleptiques. «Leur goût se situe quelque part entre le vinaigre et le décapant», commente Normand Voyer.
Quatre de ces bouteilles ont donc été confiées aux chimistes pour qu'ils en percent le secret. Habituellement, la nature d'un tel échantillon est établie à partir de l'analyse des matières organiques qu'il contient. «Ici, ce n'était pas possible étant donné que les matières organiques s'étaient altérées au fil des décennies, souligne le professeur Voyer. Nous nous sommes donc tournés vers l'analyse des minéraux. Leur abondance reflète le type de végétaux utilisés pour la fabrication du produit et, dans certains cas, le type de sol dans lequel ces plantes ont poussé.»
Pour mesurer la concentration d'une quarantaine de minéraux, les trois chercheurs ont fait appel à une technique appelée spectrométrie de masse par torche au plasma. «En deux mots, l'échantillon est chauffé à très haute température et les minéraux sont vaporisés et quantifiés selon leur masse moléculaire», explique Normand Voyer. La signature de chaque échantillon a été comparée à celle de boissons alcoolisées d'origine connue que les chercheurs ont soumises au même traitement.
Résultats? «Deux de ces bouteilles sont des champagnes. Comme il s'agit d'appellation contrôlée, la fabrication des champagnes est très standardisée ce qui nous a permis d'établir qu'il s'agit d'un Lanson, fabriqué dans la région de Reims, et d'un Moët et Chandon, provenant d'Épernay.» Des lettres gravées sur le bouchon d'une des bouteilles corroborent les conclusions des chercheurs.
Les deux autres bouteilles sont effectivement des bières, mais leur lieu de production n'a pu être déterminé. «Par contre, à partir des minéraux contenus dans les différents grains qui ont servi à leur fabrication, nous savons qu'il s'agit d'une cream ale anglaise ou irlandaise, comme la Newcastle ou la Smithwick's, et d'une pilsner, comme la Grolsh ou l'Amstel.»
Au-delà de son côté spectaculaire, cet exercice a une composante scientifique, assure le professeur Voyer. «Nous avons l'intention de publier un article sur la méthode que nous avons utilisée pour réaliser nos analyses. Le fait que le contenu en minéraux demeure stable pendant un siècle montre l'utilité de cette approche pour déterminer l'origine et la composition d'un échantillon. On peut s'y fier pour des études archéologiques et on pourrait même y avoir recours dans des causes judiciaires, notamment pour détecter les contrefaçons de champagnes ou de vins de luxe.»