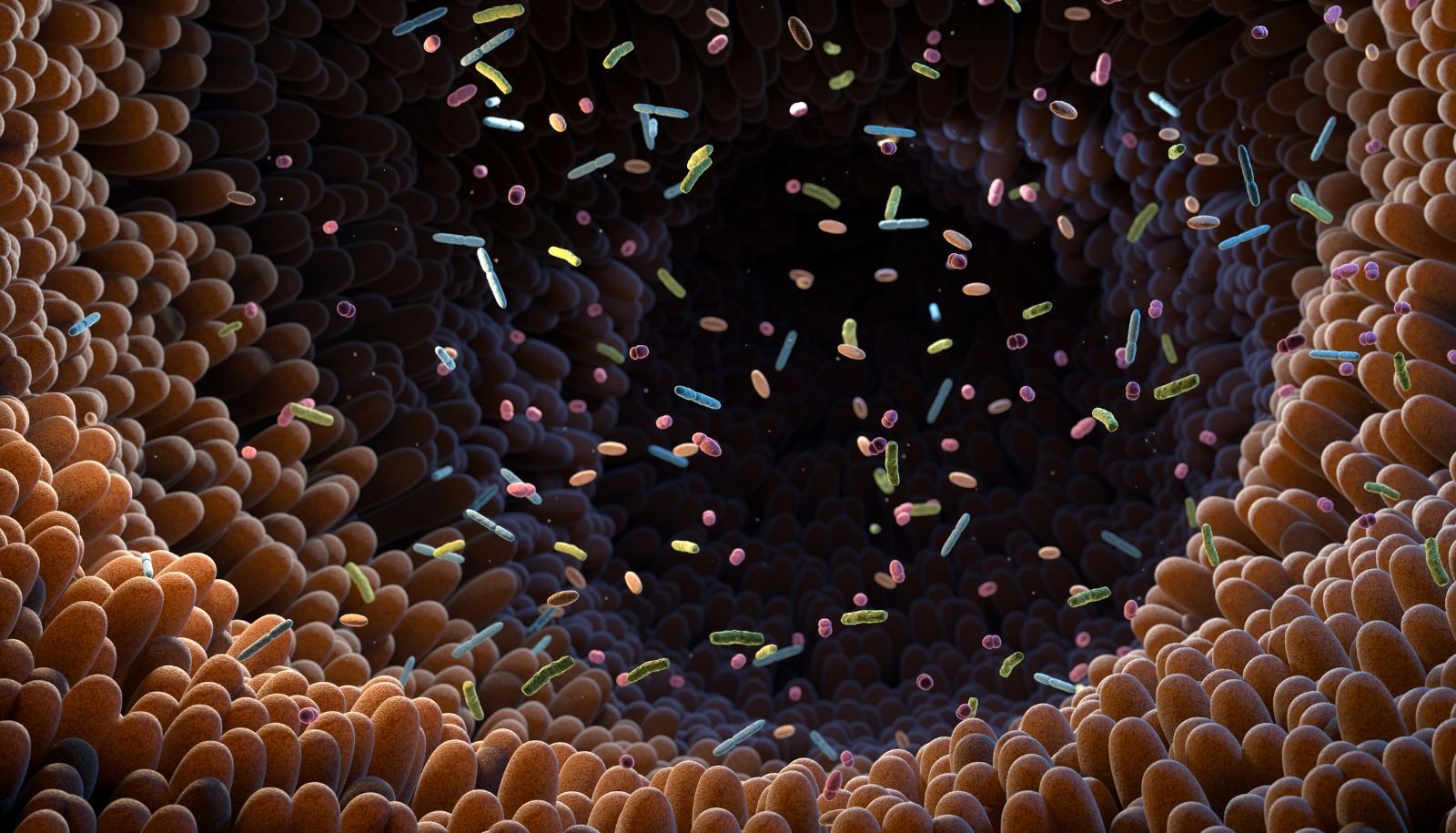En milieu naturel, l'ail des bois forme des colonies dont la densité dépasse parfois 200 plants/m2.
— Fungus Guy
Pour les besoins de la science, la professeure Line Lapointe et ses collaborateurs ont obtenu l'autorisation de transplanter en milieu naturel 3200 plants d'ail des bois. Ces spécimens – dont une bonne partie provenait de saisies chez des braconniers – ont été repiqués dans des parcelles expérimentales aménagées dans quatre érablières des basses Laurentides, dans la région d'Oka. Les chercheurs ont ensuite mesuré le taux de survie des plants et leur réponse à différents régimes de fertilisation du sol.
Les premiers résultats de ces essais, publiés dans Agroforestry Systems par Antoine Bernatchez, Julie Bussières et Line Lapointe, sont très encourageants. Les chercheurs ont démontré que les deux variétés d'ail des bois du Québec – tricoccum et burdickii – parviennent à s'établir et à croître dans ces conditions semi-sauvages. Autre signe positif, les plants d'ail répondent à l'ajout d'engrais acceptés en agriculture biologique, ce qui n'est pas le cas de toutes les espèces sauvages. «Ces engrais entraînent une augmentation de la croissance des feuilles et des bulbes, souligne Line Lapointe. Un régime de fertilisation approprié pourrait donc accroître le rendement de cette plante.» En conditions naturelles, il faut attendre une dizaine d'années avant que les bulbes atteignent une taille respectable.
Par ailleurs, les chercheurs ont constaté que l'ail des bois est plus productif à des densités qui ne dépassent pas 44 plants/m2. «Ça peut sembler beaucoup, mais les colonies naturelles atteignent parfois des densités six fois plus élevées», souligne la professeure Lapointe. À densité plus basse, chaque plant reçoit plus de lumière et pourrait ainsi croître plus longtemps avant que ses feuilles se dessèchent et tombent.
Malgré ce rendement accru, la patience sera de mise puisqu'une éventuelle culture d'ail des bois devra forcément passer par la mise en terre de graines. «C'est uniquement pour des raisons pratiques, parce que notre étude devait être réalisée dans un temps limité, que nous avons procédé par transplantations, précise la chercheuse. Une culture commerciale d'ail sauvage ne peut reposer sur cette façon de faire étant donné qu'un bulbe produit une seule plante. Sur le plan écologique, ça n'aurait pas de sens.» Pour l'ail des bois, chaque plant produit de 5 à 25 graines par année, mais leur taux de germination est élevé. «De toutes les espèces sauvages du Québec sur lesquelles j'ai travaillé, l'ail des bois est celle qui se prête le mieux à une culture agroforestière», estime-t-elle.
Ce n'est toutefois pas demain la veille que l'ail des bois se trouvera sur les étals des marchés publics ou sur les tablettes des épiceries. Il faudra d'abord peaufiner les méthodes de culture et, plus important encore, la loi québécoise devra être modifiée pour rendre ce commerce légal. «Les autorités gouvernementales devront aussi trouver une façon de s'assurer que les bulbes mis en vente proviennent véritablement de producteurs agroforestiers et non de braconniers, prévient la chercheuse. Sinon, les populations naturelles continueront d'être décimées.»