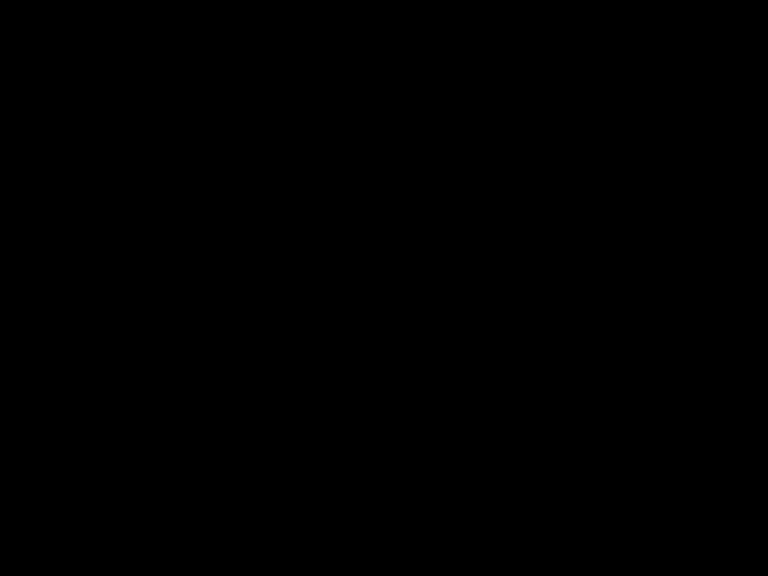
Durant plusieurs mois, Julie-Anne Bouchard-Perron a analysé les restes botaniques carbonisés découverts à l’été 2007 sur le chantier archéologique Cartier-Roberval. À cet endroit, le navigateur Jacques Cartier et le sieur de Roberval ont jeté les bases, au 16e siècle, de la toute première tentative de colonisation française sur le continent nord-américain. «J’ai identifié une trentaine d’espèces de plantes, explique l’étudiante. Elles comprennent des plantes importées, qui, comme la moutarde, étaient toutes destinées à un usage alimentaire. Il y aussi des grains de maïs et des graines de tournesol, deux plantes cultivées par les Amérindiens. Enfin, j’ai identifié des plantes comme le cerisier ou le framboisier qui poussaient naturellement aux abords du site.»
Les travaux de Julie-Anne Bouchard-Perron s’insèrent dans sa thèse de doctorat qui a pour sujet l’évolution de l’alimentation à Québec et ses environs entre 1540 et 1840. Selon elle, les restes botaniques du site Cartier-Roberval sont «exceptionnels», notamment pour la qualité de leur état de préservation. «Des traces d’incendie ont été identifiées sur une partie du site, indique-t-elle. Le processus de carbonisation a assuré la préservation des graines. Une fois la partie organique détruite par le feu, le reste ne peut se décomposer.» Plus de 2 000 graines noircies par le feu ont ainsi été préservées et retrouvées. Les espèces les plus nombreuses sont le blé, le raisin, l’orge et la moutarde.
Lorsqu’on le compare aux autres sites coloniaux de l’époque, Cartier-Roberval se situe dans une classe à part pour le nombre et le volume de ses aliments végétaux d’origine européenne. Ces aliments étaient aisément entreposables et de consommation fréquente dans l’Europe du 16e siècle. «Les colons, souligne Julie-Anne Bouchard-Perron, ont eu la possibilité de faire pousser un certain nombre de plantes servant de base au régime alimentaire européen.» Une autre raison serait la méfiance des Français à l’endroit des aliments que leur offraient les Amérindiens en signe d’amitié. «Les faibles quantités de grains de maïs ou de graines de tournesol retrouvés tendent à démontrer que les colons ont mis peu d’efforts à intégrer ces éléments nouveaux à leur alimentation», explique l’étudiante.


























