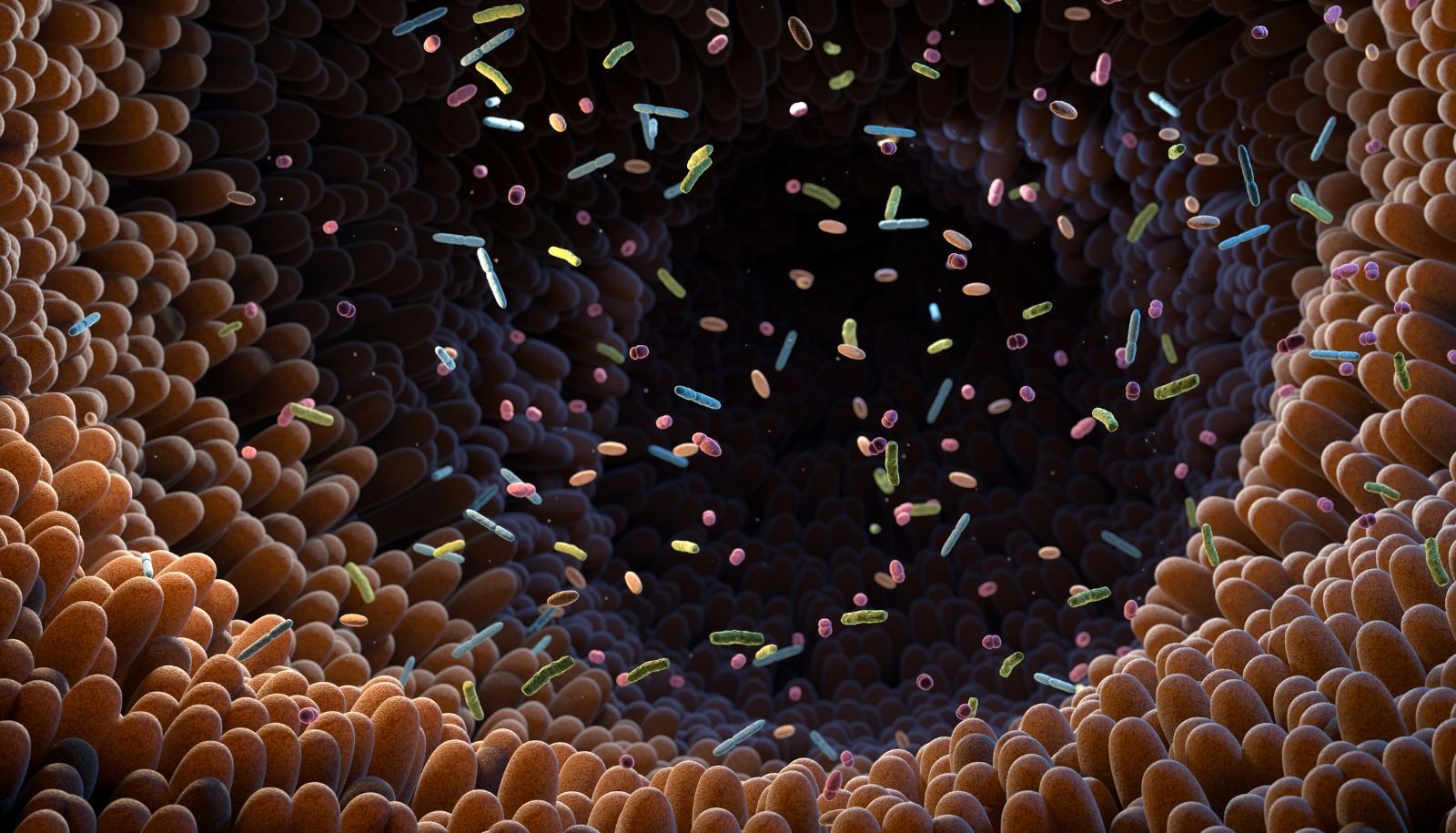«Dans les chroniques et récits produits au cours des 17e et 18e siècles, les Pierre-Esprit Radisson, Médard Chouart des Groseillers et autres aventuriers sont présentés comme des hors-la-loi ou des fugueurs en rupture avec les valeurs traditionnelles comme la religion, la culture de la terre, l’établissement d’une famille après le mariage et la contribution à la vie familiale, explique Stéphane Couture. Par exemple, le jésuite Pierre-François-Xavier de Charlevoix dépeint le coureur des bois comme un homme qui s’indianise et traite avec l’ennemi.» Au 19e siècle, le discours qu’on tient sur le personnage est plus nuancé. On le considère davantage comme un interprète, un diplomate, voire un défenseur des avoirs de la colonie. L’historien François-Xavier Garneau est le premier à établir une différenciation entre le hors-la-loi et le voyageur, le voyageur étant un engagé qui s’enrichit avec la traite des fourrures, mais qui, en même temps, explore de nouveaux territoires, contribuant ainsi à l’expansion coloniale de la Nouvelle-France.
Une réalité contraignante
Entre 1910 et 1960, le coureur des bois prend une tout autre figure, sous les plumes respectives de Benjamin Sulte, membre de la Société royale du Canada, et du chanoine Lionel Groulx, rapporte Stéphane Couture. Si le premier souligne qu’on doit aux coureurs des bois l’expansion du territoire de la Nouvelle-France et ses relations cordiales avec les Amérindiens, le second érige le personnage en héros pour tous les Canadiens français qui n’arrivent pas à prendre leur place dans une société dominée économiquement par les anglophones. «La figure du coureur des bois est laissée de côté entre 1960 et 1980, mais les historiens qui reprennent le flambeau à partir des années 1980 à nos jours tentent de se distancier de l’ancien portrait nationaliste véhiculé par l’historiographie du début du siècle dont elle fait toujours les frais, dit Stéphane Couture. En général, les auteurs s’entendent sur la question d’une réalité contraignante pour le coureur des bois qui fuyait la dureté de la vie coloniale pour adopter celle des “sauvages”. De cette situation sont toutefois nés des liens commerciaux essentiels au bon fonctionnement du commerce des fourrures.»
Selon Stéphane Couture, donner une définition claire et unique du terme coureur des bois s’avère pratiquement impossible. Parfois marchand, parfois interprète, parfois guide, parfois explorateur, il échappe à toute définition. Quant aux ouvrages récents portant sur les coureurs de bois rédigés par des auteurs n’appartenant pas au domaine de l’histoire, Stéphane Couture estime qu’ils n’apportent rien de nouveau, leurs propos étant essentiellement basés sur des écrits antérieurs. Cependant, conclut-il, c’est probablement là le principal véhicule de la symbolique mythique du coureur des bois.