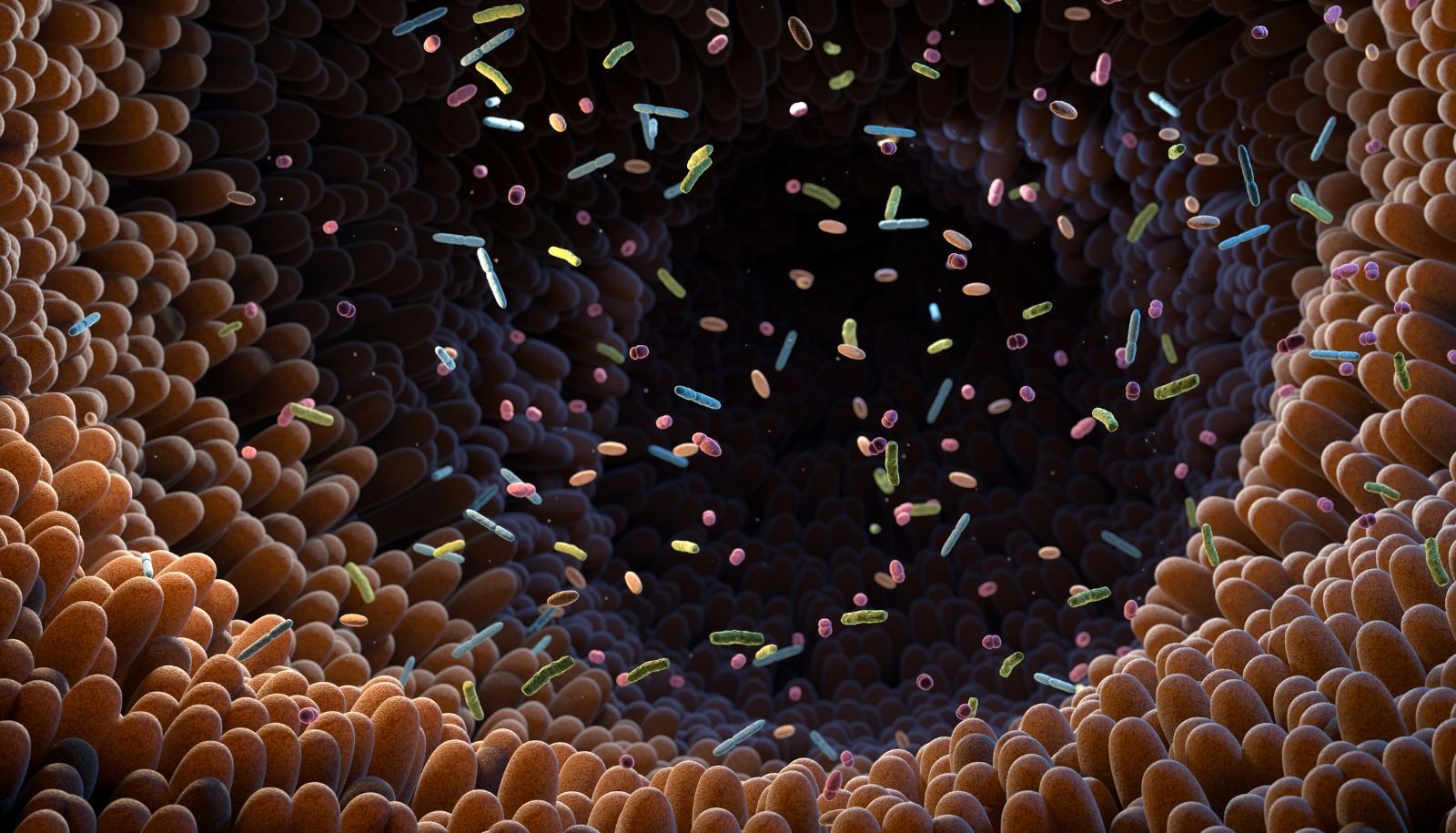Le chercheur Martin Beaulieu, professeur à la Faculté de médecine: «Nous disposons maintenant d'une nouvelle cible thérapeutique pour tester des molécules qui auraient un mode d'action similaire à celui du lithium».
L’effet thérapeutique du lithium a été découvert fortuitement en 1949 par le chercheur australien John Cade. Même si ce produit est utilisé couramment en Amérique du Nord depuis les années 1970 dans le traitement du trouble bipolaire et de la dépression majeure, son mode d’action dans le cerveau fait encore l’objet de spéculations. Contrairement à une croyance répandue, le traitement au lithium ne sert pas à combler une carence métabolique de cet élément. Le lithium agirait plutôt sur des voies de signalisation cellulaire perturbées à la suite d’un dérèglement ayant une origine génétique ou environnementale. Cette hypothèse est confirmée par les travaux que le professeur Beaulieu a réalisés au sein de l’équipe de Marc G. Caron, un diplômé de l’Université Laval qui fait carrière à l’Université Duke.
Des expériences menées en 2004 sur des animaux de laboratoire par le professeur Beaulieu et par l’équipe de Marc G. Caron ont montré que l’inhibition ou l’activation d’une protéine, la GSK3, provoquait des comportements qui s’apparentaient à ceux du trouble bipolaire. Leur dernière étude publiée dans Cell met en lumière le rôle clé joué par une autre protéine, la beta-arrestine 2, dans la régulation de la GSK3. Les changements biochimiques et comportementaux observés chez des souris normales à qui on injecte du lithium ne se manifestent pas chez des souris provenant d’une lignée dépourvue de beta-arrestine 2, ont révélé leurs travaux. Selon les chercheurs, la présence de lithium interférerait avec la formation d’un complexe moléculaire assemblé par la beta-arrestine 2, qui contrôlerait l’expression de la GSK3.
Le mécanisme décrit par les chercheurs, dans lequel la beta-arrestine 2 occupe un rôle central, pourra servir à faire l’essai de molécules qui agissent sur la même voie de signalisation que le lithium sans avoir les effets secondaires désagréables de ce traitement. «Il serait toutefois naïf de croire que le lithium n’a qu’un mode d’action dans le cerveau, reconnaît le professeur Beaulieu. Le lithium agit probablement en parallèle sur d’autres mécanismes qui interviennent également dans la modulation des comportements.»