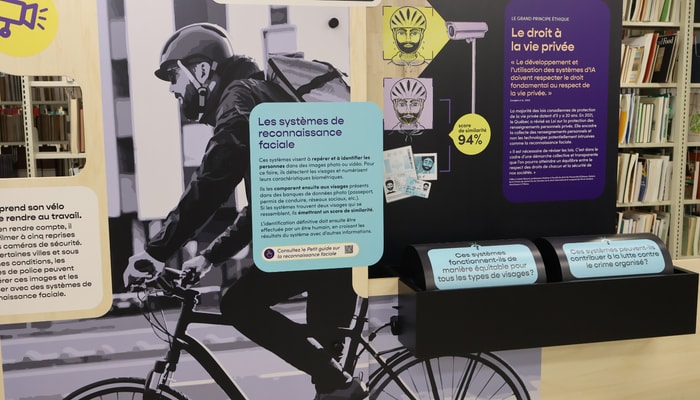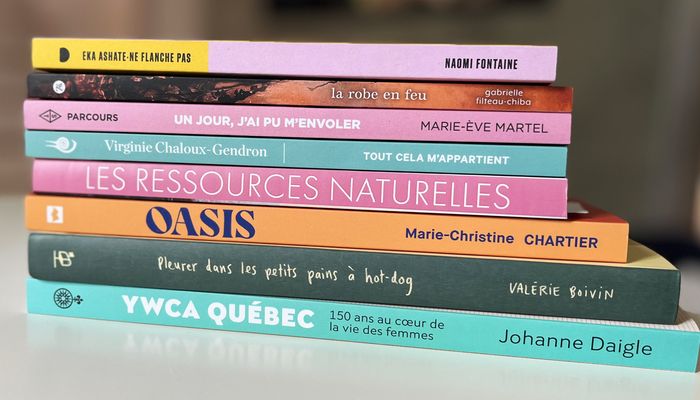Le professeur Thomas Piketty a prononcé une conférence à Porto Alegre, au Brésil, en 2017. Dans son plus récent ouvrage, il explique que la révolution conservatrice de Reagan et Thatcher, ainsi que l’échec des sociétés communistes, ont beaucoup contribué, depuis les années 1990, au développement du système hypercapitaliste actuel, lequel est responsable d’un accroissement des inégalités.
— Fronteiras do Pensamento
Droit de vote et cogestion dans les entreprises, accumulation d’argent individuelle limitée à une ampleur raisonnable, objectifs contraignants de justice sociale et fiscale dans le contexte du libre-échange, création d’un impôt mondial sur le capital, augmentation de la taxation sur le patrimoine des plus riches: ce sont là quelques-unes des propositions audacieuses que formule l’économiste Thomas Piketty dans son essai Capital et idéologie, paru au Seuil en 2019.
Le jeudi 17 septembre, ce professeur à l’École d’économie de Paris a prononcé une conférence virtuelle dans le cadre de la rentrée d’automne au Département d’économique de l’Université Laval. Sa présentation a attiré près de 1000 participants. Pendant une heure, l’auteur du Capital au 21e siècle, un succès de librairie qui s’est vendu à plus de 2,5 millions d’exemplaires, a fait part de réflexions tirées de son plus récent ouvrage.
«Thomas Piketty est connu pour ses recommandations sur la façon d'améliorer le monde, a expliqué, d’entrée de jeu, le directeur du Département d’économique, Philippe Barla. Si celles-ci sont source de controverses et de débats, elles sont fondées sur des analyses de données méticuleuses et sur une vision multidisciplinaire très large.»
Selon le conférencier, on assiste depuis la fin du 18e siècle à une réduction des inégalités, mais ce niveau reste extraordinairement élevé. «Aujourd’hui, dit-il, les 50% des plus pauvres, chiffres très proches au Canada et en Europe occidentale, possèdent à peine 5% du total des patrimoines, alors que les 1% des plus riches en possèdent, à eux tout seuls, de l’ordre de 25%. Cela donne une idée de l’hyperconcentration de la richesse qui continue de caractériser nos sociétés.»
Pour lui, la montée de l’État social représente le principal facteur ayant permis la réduction des inégalités. «Des années 1870 à la Première Guerre mondiale, les dépenses sociales des États sont très faibles, souligne-t-il, en particulier dans le domaine de l’éducation. Ce n’est qu’après le second conflit mondial que les gouvernements mettent en place un système fiscal relativement juste, qui va beaucoup contribuer à la réduction des inégalités. Par ce système, les citoyens en haut de l’échelle sociale paient encore plus. Mais ce système d’impôt fortement progressif rend beaucoup plus acceptable pour chacun de contribuer au financement des dépenses communes.»
Selon Thomas Piketty, l’expérience américaine de réduction des inégalités a donné de bons résultats depuis les années 1930 jusqu’aux années 1980. Pour rappel, l’impôt fédéral sur les plus hauts revenus a été en moyenne de plus de 80% durant cette période. «Je défends l’idée que la très forte progressivité fiscale du milieu du 20e siècle aux États-Unis a plutôt été une réussite, affirme-t-il. Cette approche a permis de réduire fortement les inégalités en contribuant à financer un système social. De plus, ce système fiscal n’a pas empêché la croissance économique, bien au contraire. Mais depuis les années 1980, avec l’arrivée au pouvoir de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, on a basculé dans une autre phase de remontée des inégalités.»
Des dettes publiques très élevées
Vers la fin des années 1940, dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, la dette publique atteint des niveaux extrêmement élevés dans l’ensemble des pays européens, soit entre 150% et 300% du revenu national en 1945-1950. Par la suite, elle chute brutalement ou plus graduellement selon les États. En Allemagne et en France, par exemple, des annulations de dette et une inflation élevée font respectivement le travail, tandis qu’une inflation modérée diminue la dette graduellement au Royaume-Uni ainsi qu’aux États-Unis.
«En Allemagne, comme au Japon, poursuit le conférencier, des systèmes de prélèvement exceptionnels sont appliqués avec beaucoup de succès sur les plus hautes fortunes privées. Cela a permis à ces pays de se débarrasser assez rapidement de leur dette publique. En retour, ils ont disposé de plus de moyens financiers pour pouvoir investir dans les infrastructures, l’éducation, la croissance de la paix.»
Dans les années 1980-1990, la révolution conservatrice menée par le tandem Reagan-Thatcher se voit éclipsée par un choc encore plus important: la chute du système communiste dans le monde. «L’échec des sociétés communistes, explique Thomas Piketty, a beaucoup contribué, depuis les années 1990, au développement de ce système hypercapitaliste, en l’absence d’alternatives. Depuis ce temps, les sociétés sociales-démocrates, malgré leur succès, mais aussi en raison de leurs limites, ont été incapables de se renouveler. Je crois que ce contexte contribue à la fois à l’augmentation des inégalités et aussi à une espèce de durcissement des conflits identitaires. Ces conflits s’expliquent en partie par une fermeture du débat économique que j’essaie, avec beaucoup d’autres, de rouvrir.»
Le cas de la Russie est intéressant à cet égard. Selon le conférencier, les privatisations des années 1990 dans cet ex-pays communiste ont bénéficié à un tout petit groupe d’oligarques plus ou moins proches du pouvoir. «Aujourd’hui, poursuit-il, la Russie de Poutine est un endroit où vous n’avez aucun impôt progressif sur le revenu. Le taux est de 13%, que vous fassiez 1000 roubles par mois ou un milliard. Ils n’ont même pas d’impôt sur les successions. Ces exemples montrent l’ampleur du bouleversement idéologique provoqué par la chute du communisme et utilisé par les élites au pouvoir.»
Selon le professeur, pour résoudre les défis inégalitaires, il faut dépasser le capitalisme et la sacralisation de la propriété privée, notamment sur les ressources naturelles. «Le socialisme participatif que j’essaie de défendre ici se situe dans le prolongement de la social-démocratie du 20e siècle, soutient-il, mais en allant plus loin.»
Retrouver l’intégralité de la grande conférence de Thomas Piketty