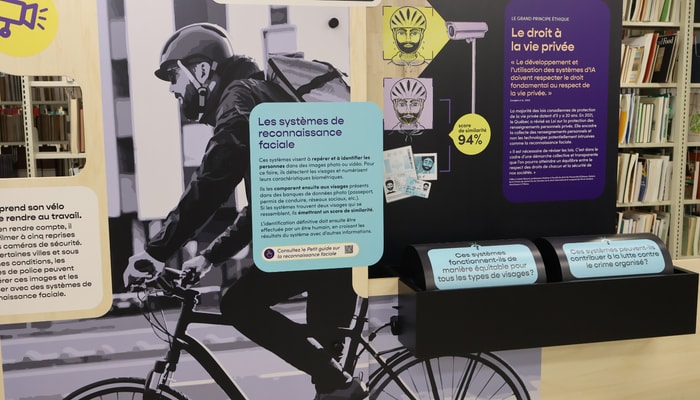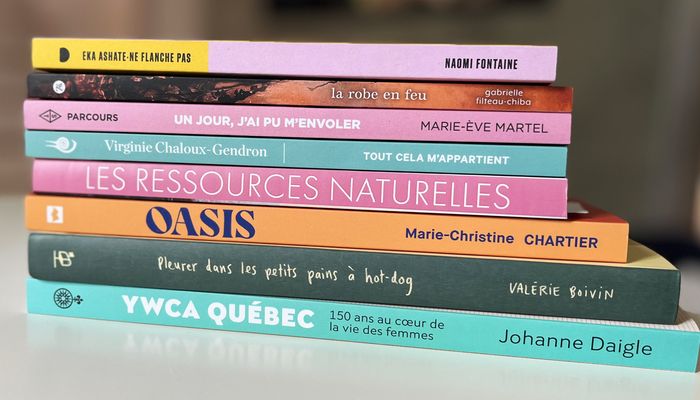Son projet de thèse de doctorat porte en effet sur la façon dont les jeunes placés dans des familles d’accueil vivent cette plongée brutale dans l’autonomie. En effet, à partir de 18 ans, la Direction de la protection de la jeunesse ne finance plus leur prise en charge, hormis quelques cas d’exception. Du jour au lendemain, ou encore parfois après un programme de préparation, les voilà qui doivent affronter la vie adulte: vivre seuls ou à plusieurs dans un appartement, trouver un travail ou une formation. «Je cherche à les rencontrer six mois environ après leur 18e anniversaire pour comprendre les événements importants qu’ils vivent durant cette période, leur conception d’une vie adulte réussie, l’idéal qu’ils poursuivent, raconte l’étudiante. Pour l’instant, cependant, je dois attendre l’approbation de mon projet par le Comité d’éthique avant de commencer à recruter les jeunes que j’aimerais rencontrer.»
En lien avec le Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque (JEFAR), son projet consiste en l’étude qualitative d’une trentaine d’entrevues de jeunes adultes issus de familles d’accueil, de foyers de groupe ou de centres de réadaptation de la région de Québec. L’étape du recrutement l’inquiète d’ailleurs un peu, car la Direction de la protection de la jeunesse, qui supervise les familles d’accueil, ne garde plus de liens avec les jeunes une fois qu’ils deviennent majeurs. Marie-Claude Richard espère quand même que ses résultats de recherche, qui devraient être disponibles d’ici deux ans, pourront aider les intervenants sur le terrain à modifier leurs politiques sur cette délicate étape de transition passage. Elle a choisi délibérément de donner la parole aux jeunes plutôt que de se pencher sur les obstacles à franchir pour ces adultes en devenir, comme tant d’autres études. En fait, au-delà de l’échec ou de la réussite, ce qui intéresse la chercheuse ce sont les stratégies utilisées par les gens rencontrés pour atteindre l’âge adulte, autrement dit leurs chemins de vie.
Cet intérêt pour la recherche, Marie-Claude Richard l’a découvert alors qu’elle effectuait sa maîtrise en psychologie à l’Université du Québec à Chicoutimi. À l’issue de son mémoire, qui portait sur le travail rémunéré des élèves au secondaire, l’étudiante avait l’impression de rester sur son appétit. «J’avais le goût d’approfondir mes connaissances, confie-t-elle. Par ailleurs, je trouvais la psychologie intéressante, mais il me manquait quelque chose. À l’École de service social, les valeurs de justice sociale et la prise en considération de l'humain dans son contexte de vie, et pas seulement comme individu, me rejoignent davantage.» Sans trop d’états d’âme, elle a donc traversé la réserve faunique des Laurentides pour poser ses pénates à l’Université Laval.
Depuis quelques mois, elle se sent parfaitement à l'aise dans l’atmosphère stimulante du bureau que partagent les étudiants-chercheurs. «Lorsqu’on entreprend un doctorat, on peut facilement se sentir isolé et impuissant face au processus bureaucratique, souligne la jeune fille. La discussion avec les étudiants m’apporte beaucoup: je me rends compte que nous vivons les mêmes difficultés.» Si tout va bien, Marie-Claude Richard devrait devenir docteure en 2010. Et après? «Je n’ai pas d’idée précise, mais je sens qu’il y aura quelque chose pour moi, dit-elle en souriant. Une chose est sûre, j’espère que mes recherches ne resteront pas sur les tablettes et qu’elles pourront contribuer au changement social.»