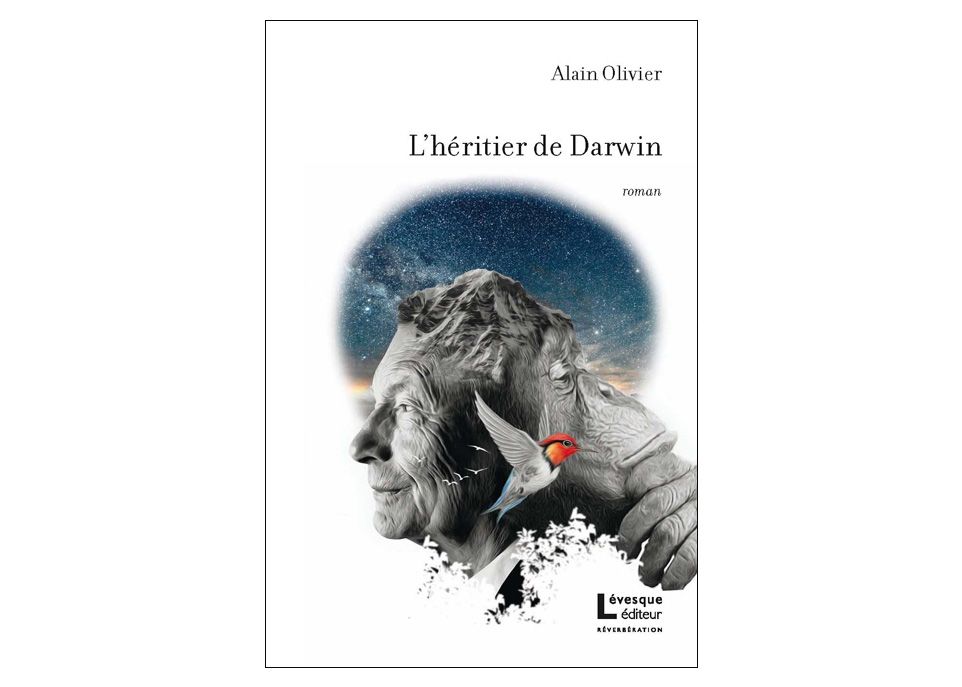
L’histoire nous plonge dans les pensées intimes d’un chercheur en biologie qui, à la suite d’un congrès en terre chilienne, entreprend d’explorer la Patagonie en compagnie de son épouse. Ébloui par la richesse de la faune et par la majesté des paysages, le narrateur est traversé par une foule de questionnements sur la nature humaine. Or, une surprise l’attend à diverses étapes de son périple: il croise Charles Darwin! Ses conversations avec le célèbre naturaliste, combinées à ses propres observations, guideront l’homme dans sa quête. Au gré de ses réflexions, il verra sa vision du monde bouleversée, tout comme celle des lecteurs, sans doute.
«L’idée d’écrire sur la théorie de l’évolution me poursuivait depuis longtemps», confie Alain Olivier. Près de 20 ans auront été nécessaires pour achever son ouvrage. Une bonne chose, selon lui, car le résultat aurait été fort différent autrement. «À l’époque où ce projet a germé, j’étais encore très influencé par la part de l’inné et de la génétique dans l’évolution humaine. En lisant davantage sur Darwin et sur son œuvre, j’ai compris que la sélection naturelle dépend aussi d’autres formes de transmission que celle des gênes.»
Au fil des pages se déploie donc un audacieux recul, tant intuitif que scientifique, par rapport à l’opinion répandue selon laquelle la théorie de l’évolution se résumerait à la «loi du plus fort». Au contraire, l’évolution humaine puiserait surtout ses sources dans la coopération, le soutien aux plus faibles, l’éducation, la culture et la communication. Ce faisant, la diversité et le vivre-ensemble jouent un rôle fondamental dans la survie humaine.
Au fur et à mesure qu’il en vient à cette prise de conscience, le narrateur y greffe des tranches de vie personnelle. Ces incursions permettent d’aborder au passage quantité de thèmes liés aux grands enjeux sociaux et politiques contemporains: relations amoureuses, guerres et conflits armés, décès d’êtres chers, parentalité, défi environnemental, etc. «Chaque lecteur peut tirer du roman ses propres conclusions et les ancrer dans sa réalité», explique Alain Olivier.
Certaines interrogations entourant le destin individuel sont aussi soulevées dans le récit. «Notre quête identitaire, ce qui forme notre unicité en tant qu’individu, voilà un sujet qui me fascine», admet le professeur. Tantôt romancier, tantôt scientifique, lui-même n’est-il pas un cas d’espèce intéressant? «Mes passions pour l’écriture et pour la nature datent de l’enfance. Loin d’être opposées, elles se complètent», assure l’auteur et biologiste. Ce mélange de différentes facettes dans une même personnalité lui apparaît souhaitable. Car si la diversité est profitable au sein des collectivités, pourquoi n’en serait-il pas autant chez un seul individu?
Pour la suite du monde
Enfin, L’héritier de Darwin met à l’avant-plan un constat non négligeable pour la suite du monde: l’évolution des espèces est loin d’être achevée. «Sa poursuite semble même plus rapide que prévu, indique Alain Olivier. Les changements climatiques auraient, notamment, déjà modifié la longueur des ailes de certains oiseaux.» Et homo sapiens? Où le mènera sa révolution? Que dirait Darwin, par exemple, de la montée des médias sociaux? «Cela pourrait faire l’objet d’un autre ouvrage, s’amuse le professeur. Chose certaine, ce phénomène s’inscrit dans ces transformations qui se font en mode accéléré.»
Dans le roman, à l’occasion de sa dernière rencontre avec le narrateur, Darwin lance cette tirade: «N’oubliez jamais ceci: si nous voulons survivre, la seule voie qui s’offre à nous est celle d’une véritable amitié». Comment conjuguer cette mise en garde à l’ère des amitiés sur Facebook? Seul l’avenir le dira.
L’héritier de Darwin, Lévesque éditeur, 368 pages


























