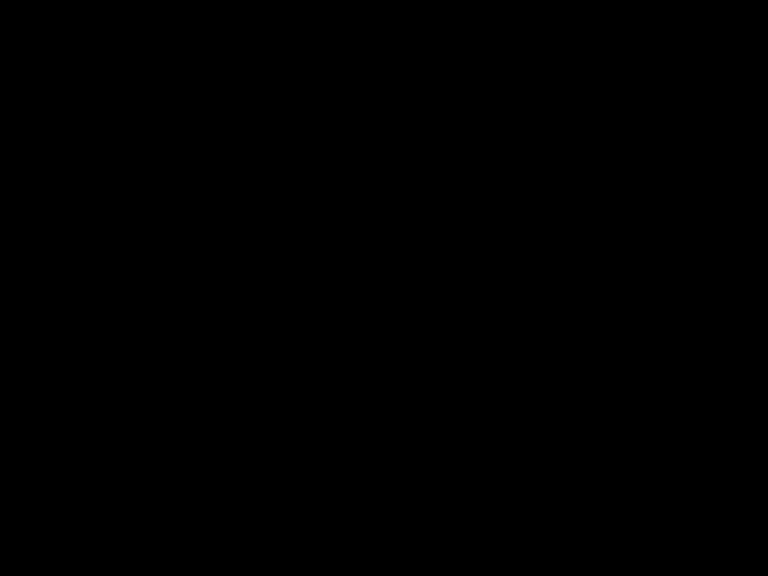
L'éboulement le plus meurtrier de l'histoire de Québec est survenu le 19 septembre 1889: des blocs rocheux ont enseveli les maisons de 28 familles, faisant 35 morts et 30 blessés.
Jacques Locat et Dominique Turmel, du Département de géologie et de génie géologique, et leurs collègues de l’Université de Lausanne, Michel Jaboyedoff, Thierry Oppikofer et Romain Minoia, ont étudié le secteur du promontoire de Québec où est survenu, le 8 octobre 2004, le dernier de ces éboulements. Cette collaboration canado-helvétique, surprenante à première vue, témoigne des liens qu’entretiennent les chercheurs des deux établissements et dont les étudiants de premier et deuxième cycles peuvent maintenant profiter en vertu d’un programme avec profil international. Les chercheurs ont eu recours à un scanneur Lidar terrestre pour repérer les zones de fractures dans cette section de la falaise. L’appareil émet un faisceau laser en direction de la paroi rocheuse et capte l’onde de retour, ce qui permet de construire une image 3D de la paroi rocheuse avec une précision de l’ordre du centimètre. «Cet outil est particulièrement utile pour repérer les fissures dans des secteurs difficiles d’accès, signale Jacques Locat. On pourrait même l’utiliser pour suivre l’évolution des fissures dans le temps et anticiper le détachement de blocs.»
________________________________________________________________________________
Les 53 éboulements recensés depuis 240 ans le long du promontoire de Québec ont fait
88 morts et 70 blessés.
________________________________________________________________________________
Les images obtenues par les chercheurs montrent clairement l’emplacement du bloc qui s’est détaché en 2004, la cicatrice laissée par les éboulements antérieurs ainsi que des fissures susceptibles de se creuser par l’action du gel-dégel de l’eau. «Ce qui a longtemps été le principal facteur d’érosion de la falaise, l’érosion par le fleuve, n’est plus en cause aujourd’hui, rappelle le professeur Locat. Par contre, si on construit un stationnement ou une autre structure qui altère le bas de la falaise, ou si on modifie le drainage dans le haut de la falaise et que l’eau s’infiltre derrière les fissures, la stabilité de la paroi rocheuse pourrait en souffrir.»
Les 53 éboulements recensés depuis 240 ans le long du promontoire de Québec ont fait 88 morts et 70 blessés. Le plus meurtrier est survenu le 19 septembre 1889 lorsque des blocs rocheux ont enseveli les maisons de 28 familles, faisant 35 morts et 30 blessés. Depuis, les éboulements n’ont fait aucune victime dans le secteur, mais ils causent régulièrement des dommages matériels. Selon les chercheurs, il serait utile de recourir au scanneur Lidar comme outil complémentaire si jamais une analyse complète du risque d’éboulement était effectuée le long du promontoire de Québec.
Même des avalanches
Par ailleurs, Bernard Hétu (UQAR) et Kati Brown (U. de Moncton) ont présenté des données qui montrent que la région de Québec est une zone où les risques d’avalanches mortelles ne sont pas nuls. En passant en revue les journaux et les enquêtes des coroners depuis 1825, les deux chercheurs ont retracé, pour tout le Québec, 39 avalanches de neige qui ont fait 69 morts et 56 blessés. «L’une des surprises de notre enquête est le grand nombre d’accidents qui sont survenus en milieu résidentiel (37 morts, 42 blessés), principalement dans les villes de Québec et de Lévis», signalent-ils.
En effet, la région de la Capitale-Nationale revendique 28 % des mortalités par avalanche, tout juste derrière Chaudière-Appalaches, la région la plus éprouvée avec 38 % des décès. Plus de la moitié des avalanches mortelles sont liées à des activités récréatives comme le ski, la glissade ou la motoneige. Les deux chercheurs ont déploré le fait qu’aucun inventaire des zones à risque d’avalanches n’ait encore été réalisé au Québec.


























