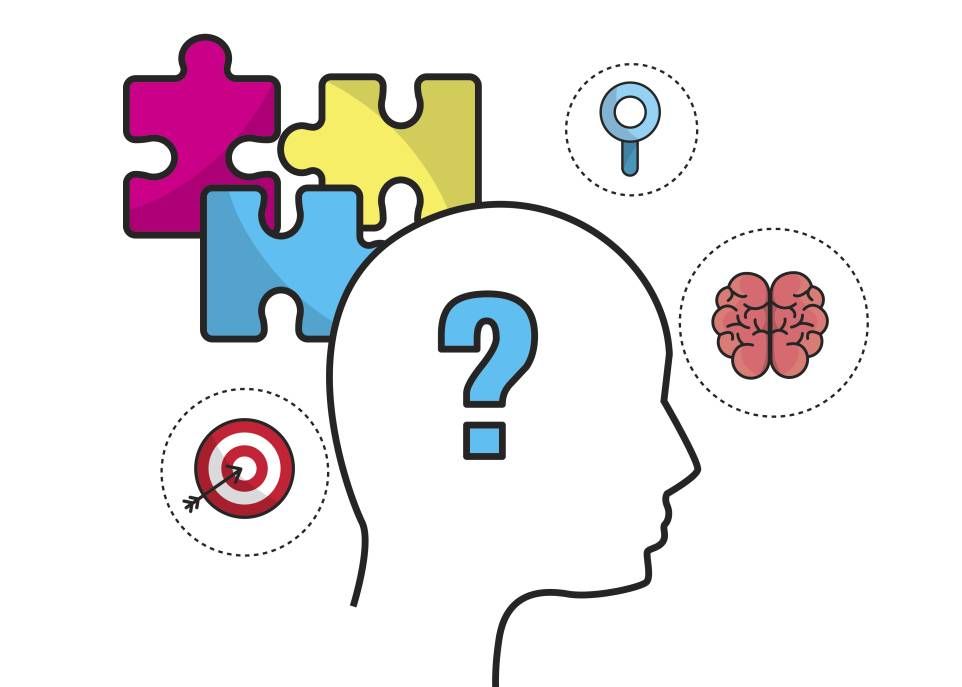
— Les chercheurs ont mis à profit les résultats d'études récentes en neurolinguistique pour élaborer neuf tâches mettant en relief les déficits langagiers qui se manifestent très tôt chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives.
En raison du vieillissement de la population, ce test pourrait être d'un précieux secours pour les cliniciens de première ligne. En effet, le nombre de personnes souffrant de maladies neurodégénératives est en hausse et il pourrait atteindre 66 millions en 2030 et 115 millions en 2050. «Une partie de ces personnes se présenteront chez leur médecin en disant qu'elles éprouvent des difficultés à trouver leurs mots ou à les écrire correctement. Comme il n'existait pas d'outils pour aider les cliniciens à distinguer ce qui constitue une diminution normale des capacités langagières associée au vieillissement et une diminution pathologique de ces capacités, nous avons entrepris de développer un test simple et rapide pouvant être utilisé en pareilles situations», explique Joël Macoir.
Le professeur du Département de réadaptation s'est associé à des chercheurs de France, de Suisse et de Belgique afin de développer un test pouvant être utilisé auprès des populations francophones du Canada et de ces trois pays. L'équipe a mis à profit les résultats d'études récentes en neurolinguistique pour élaborer des tâches mettant en relief les déficits langagiers qui se manifestent très tôt chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Le résultat de leur travail est un test qu'un clinicien sans formation dans le domaine du langage peut faire passer à un patient chez qui on soupçonne l'apparition d'une maladie neurodégénérative. Il comprend neuf tâches simples, par exemple répéter des mots ou des phrases, ordonner par ordre alphabétique trois mots livrés oralement, rédiger spontanément une phrase ou nommer le plus de mots possible commençant par une lettre donnée en une minute.
L'étude de validation menée par les chercheurs a permis de démontrer qu'il existe des différences significatives entre les scores obtenus à ce test par des personnes en bonne santé et ceux obtenus par des personnes qui avaient reçu un diagnostic probable d'alzheimer léger ou modéré. Restait à déterminer quelles étaient les valeurs normales et anormales à ce test en fonction de l'âge et de la scolarité des sujets. Pour ce faire, les chercheurs ont fait passer le test à 545 participants provenant des quatre pays. L'exercice a permis d'établir un seuil d'alerte et un seuil pathologique à partir desquels un clinicien peut soupçonner la présence possible ou probable d'une maladie neurodégénérative. «Il ne s'agit pas d'un test diagnostique, prévient toutefois le professeur Macoir. Par contre, lorsqu'un sujet obtient un score inférieur à ces seuils, il s'agit d'une indication nette qu'il faut procéder à des examens plus poussés.»
Joël Macoir envisage maintenant d'adapter cet outil pour en étendre l'usage à d'autres pays. Il a déjà pris contact avec des collègues canadiens pour produire une version anglaise du test. Au cours de l'automne, le chercheur et ses collaborateurs entreprendront des démarches pour produire des versions espagnole, italienne et allemande du questionnaire. «Nous voulons aussi faire connaître l'existence de ce test en publiant des articles dans des revues destinées aux médecins», ajoute le professeur Macoir. Quant à savoir quelles sont les chances que les médecins utilisent cet outil dans leur pratique, le chercheur se montre très réaliste. «Il se peut que ça prenne des années, mais lorsque les médecins jugeront que le test apporte une valeur ajoutée à leur pratique, ils vont l'adopter. Il se peut que ce moment arrive plus rapidement chez les neurologues et les gériatres en raison du type de patients qu'ils soignent.»
L'étude publiée dans l'American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias est signée par Joël Macoir, Laura Monetta et Maximiliano Wilson, du Département de réadaptation de l'Université Laval et du Centre de recherche CERVO, Marion Fossard, de l'Université de Neuchâtel en Suisse, Laurent Lefebvre, de l'Université de Mons en Belgique, Antoine Renard, de l'Université de Lausanne en Suisse, et Thi Mai Tran, de l'Université de Lille en France.


























