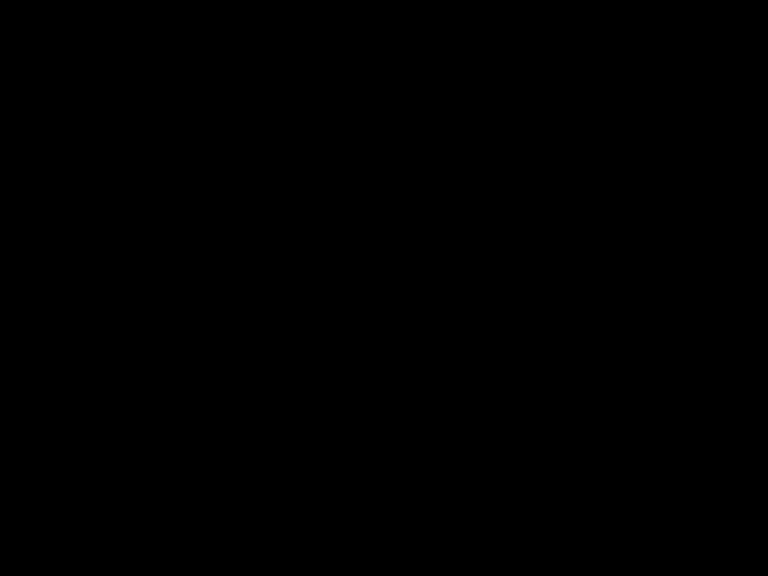
Boudée par les Amérindiens qui préfèrent chasser le phoque ou le marsouin, la morue est d’accès facile pour les Français qui viennent par centaines la pêcher dans les eaux glacées de Terre-Neuve. Au 16e siècle, la morue devient ainsi le poisson le plus populaire en France, appréciée autant des riches que des pauvres. Dans toutes les grandes villes portuaires, la morue est triée sur le volet, pourrait-on dire, afin qu’elle puisse répondre à la demande de différentes bourses et couches sociales. On retrouve la grande morue marchande, la marchande, la moyenne et celle de rebut. Dans certaines villes, le classement est encore plus raffiné, comme à Nantes, par exemple, où la morue ne compte pas moins de sept catégories. Qu’on soit aristocrate ou paysan, la morue constitue donc un mets de choix, à une époque où les jours maigres, au cours desquels il est interdit de manger de la viande sous peine de commettre un péché mortel, se comptent par dizaines dans une année.
Dans le ventre du poisson
Autre temps, autres mœurs : on consomme alors les tripes de morue, non seulement sur les bancs de Terre-Neuve lorsque les pêcheurs font bombance après une bonne prise, mais également à la table royale, parmi les dorades, les esturgeons et les saumons. «La consommation de tripes de morue et le discours sur la façon de les apprêter sont une pratique tout à fait nouvelle qui se développe avec l’introduction en France de la morue de Terre-Neuve et qui est réservée à ce seul poisson, rapporte Laurier Turgeon. Ces tripes du ventre de la morue sont en quelque sorte ramenées au centre du royaume pour fortifier ceux qui sont censés l’incarner et, par extension, pour fortifier l’ensemble du royaume.» Considéré comme un poisson exotique, la morue est associée au mythe de la plénitude, de la profusion et de la fécondité de Terre-Neuve. Sa chair blanche lui confère une aura de pureté et d’innocence.
À partir de la moitié du 17e siècle, la consommation de la morue plafonne un peu partout en France. La morue perd son statut d’aliment maigre au profit des légumes, des œufs, des laitages et même de la viande. «Bien vite, la morue n’est plus identifiée systématiquement aux "terres neufves" dans les documents notariés, les traités d’histoire naturelle et les livres de cuisine, conclut Laurier Turgeon. Ce sont désormais les fourrures canadiennes et les produits antillais, surtout le sucre et le café, qui seront associés au Nouveau Monde et à sa colonisation.»


























