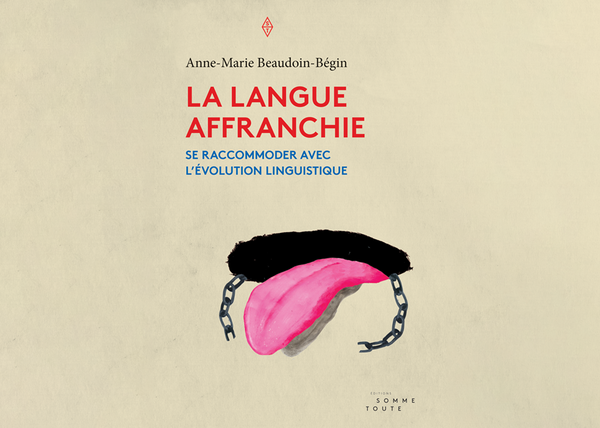
Suite de La langue rapaillée, l'ouvrage La langue affranchie: se raccommoder avec l'évolution linguistique offre des pistes de réflexion pour encourager un changement d'attitude envers leur langue chez les Québécois.
«Dans La langue rapaillée, j'établissais les bases pour expliquer la situation linguistique au Québec. Puisqu'il s'agit d'un sujet très délicat, j'y suis allée doucement. Peu connue du grand public, je ne voulais pas arriver avec une brique et un fanal. Avec La langue affranchie, je me permets d'être plus provocante!», admet celle qui plaide pour une libre évolution de la langue.
Contrairement à plusieurs puristes, elle ne s'inquiète pas outre mesure de la prolifération des anglicismes. En revanche, elle en a contre les terminologues qui dictent quels sont les mots qui font et ne font pas partie du «bon parler». «Sur quels critères se base-t-on pour déterminer quels anglicismes doivent être acceptés? Quelqu'un m'a déjà reproché d'utiliser l'expression caller une pizza. Plus tard dans la soirée, cette même personne a utilisé les mots beurre de peanut. Chaque locuteur a sa propre vision de la langue. En l'imposant aux autres, ils créent un jeu de pouvoir. C'est contre cela que je me bats.»
Dans son livre, elle explique que les francophones font évoluer leur langue pour la rendre plus efficace. Le français, ce n'est pas nouveau, est assujetti à divers facteurs d'évolution, comme l'économie linguistique, qui consiste à dire le plus de choses possible avec un minimum d'efforts. On peut penser à la disparition du «ne» dans les négations à l'oral («je pense pas» au lieu de «je ne pense pas»). Autre facteur d'évolution de la langue: la disparition de certaines images. Par exemple, le terme «cassette», souvent utilisé pour faire référence à quelqu'un qui se répète constamment, n'a pas de signification chez les jeunes n'ayant pas connu ce support d'enregistrement. Pour Anne-Marie Beaudoin-Bégin, l'évolution de la langue est non seulement positive, mais nécessaire pour demeurer vivante.
Dans son troisième ouvrage, sur lequel elle travaille actuellement, elle reviendra plus en détail sur l'histoire de la langue française au Québec. Encore une fois, on peut s'attendre à un ton cinglant. «Je suis tannée de lire des livres sur l'histoire du français qui traitent principalement de la France et consacrent seulement quelques paragraphes au Québec. L'histoire du français québécois est très riche. On y trouve plusieurs particularités qui sont très intéressantes à analyser. On peut aussi faire des comparaisons avec le français parlé aux Antilles, qui furent colonisées à la même époque», conclut-elle.


























