
Michel Pigeon
«Mon but avec ce livre, c'est que les gens qui ont une certaine influence sur le futur sachent ce que les jeunes souhaitent.» L'ex-recteur de l'Université Laval, Michel Pigeon, voit dans son travail une «utilité sociale». Son ouvrage intitulé Les jeunes et les changements climatiques: quels choix de société?, fraichement sorti en librairie, rassemble les «morceaux grand public» de sa thèse de doctorat en sociologie. Il a donné la parole aux étudiants pour connaître leur compréhension des problèmes environnementaux, leurs valeurs, leurs visions de la société du futur et les conditions pour y parvenir.
«Si je peux caricaturer, je dirais qu'à une extrémité, l'un d'eux m'a dit: “C'est la fin, on va tous mourir!”, et à l'autre bout du spectre, un autre a lancé: “On n'a pas à s'inquiéter, la technologie va tout régler”.»
À 77 ans, celui qui a été formé en génie civil et fait carrière comme professeur, chercheur, recteur et député de Charlesbourg se qualifie de «jeune sociologue», lui qui a soutenu sa thèse l'an dernier. «Probablement plus inquiet» pour l'environnement que ses quatre petits-enfants, il refuse lui-même d'être pessimiste et se donne la responsabilité de continuer à travailler pour aider la société à affronter la crise écologique. «Ma conviction profonde est que les solutions aux problèmes environnementaux sont des solutions sociales, des solutions de comportements», dit-il.
Sa recherche qualitative s'appuie sur des entrevues semi-dirigées réalisées auprès de 34 étudiants et étudiantes de l'Université Laval et du Cégep Limoilou avant que tout ne ferme à cause de la pandémie. Dans l'ensemble, il a pu constater que les jeunes de son échantillon comprennent bien les causes et les conséquences des changements climatiques, qu'il s'agisse de la fonte des glaciers et de la montée des eaux ou de l'augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes.
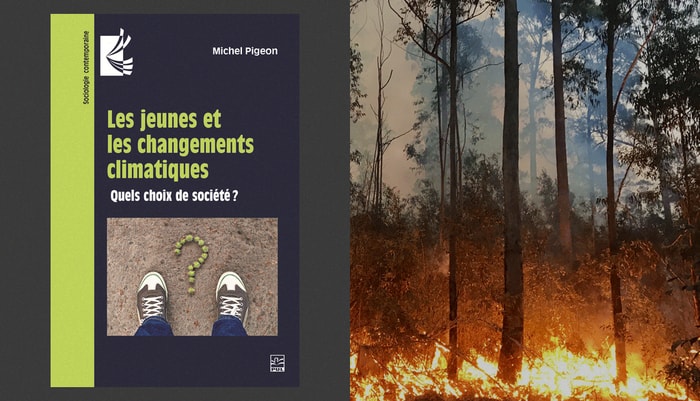
Le livre révèle que les jeunes interrogés comprennent bien les causes et les conséquences des changements climatiques, qu'il s'agisse de la fonte des glaciers et de la montée des eaux ou de l'augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes.
— GETTY IMAGES/BINIKINS pour la photo de droite
En cours de route, a-t-il senti que les répondants souffraient d'écoanxiété, ce sentiment de détresse devant les changements climatiques et l'appréhension de leurs conséquences? «Je ne dirais pas zéro, mais ça ne m'a pas frappé. Je leur ai demandé à la fin des entrevues s'ils étaient optimistes ou pas et c'est un peu entre les deux», répond le professeur associé au Département de sociologie et professeur émérite de génie civil à l'Université Laval.
Consommation, alimentation, habitation, voyages, enfants
Les résultats de son enquête montrent un certain consensus dans leur vision de la société idéale, comme la nécessité de restreindre la taille des habitations ou la volonté de s'attaquer à la société de consommation. Le iPhone de l'année, chaque année? Pas un gage de bonheur, a souligné un répondant.
Côté alimentation, un peu plus de la moitié souhaite que la consommation de viande en 2050 soit moindre qu'aujourd'hui. Quelques-uns désirent qu'elle devienne complètement d'origine végétale, alors que certains restent attachés à la liberté de choix.
«Plusieurs m'ont dit ne pas manger de viande ou essaient d'en manger moins. Leurs comportements sociaux en alimentation, en habitation, en transport ne sont pas si différents de ce qu'ils souhaitent pour la société future, donc ils ne sont pas en contradiction complète, loin de là», précise le professeur Pigeon.
Par ailleurs, peu d'entre eux sont prêts à renoncer aux voyages. Dans son livre publié aux Presses de l'Université Laval, Michel Pigeon rappelle que le transport aérien est responsable de 3% à 4% des émissions globales de gaz à effet de serre (GES), que les émissions annuelles au Québec sont de près de 10 tonnes par personne, et qu'un voyage aller-retour Montréal-Paris représente environ 2 tonnes de CO2 par passager, selon l'organisme Unpointcinq.
«Ce qui m'a frappé, les entrevues ont eu lieu peu de temps après la visite de Greta Thunberg [la militante écologiste suédoise], qui est venue en bateau à voile [en 2019], mais eux m'ont dit que technologiquement, on trouvera les moyens pour que les voyages ne soient pas trop émetteurs de GES et mauvais pour la planète. Les voyages, c'est important. On ne peut pas être un bon humain si on n'est pas en train de comprendre les autres et voyager, c'est comprendre les autres.»
Si la plupart des répondants voient la technologie avec intérêt, ils ne l'identifient toutefois pas comme la solution ultime aux problèmes environnementaux.
L'enquête montre qu'ils ont confiance en la science, mais selon eux, ce n'est pas aux scientifiques de décider. L'auteur illustre leur pensée: «Les experts vont nous donner leur avis, et nous et le gouvernement, on va décider.» Une fraction de l'échantillon pense que la clé repose sur la mobilisation citoyenne. Mais la plupart croient qu'il faut élire des partis qui prendront les bonnes décisions.
Le livre révèle un fort attachement des jeunes à la nature. «Pas juste comme une ressource à exploiter, mais comme une source de bien-être et de paix intérieure», souligne l'auteur.
Une personne a soulevé que «mettre des enfants au monde dans l'état actuel de la planète n'était pas une bonne idée». Mais ce n'est pas ce qui ressort dans l'ensemble, précise Michel Pigeon.
Lignes de fracture
Trois «lignes de fracture» ont été soulevées dans le discours des jeunes interviewés. «J'ai rencontré des radicaux et des modérés, ce qui n'est pas une surprise. Certains pensent que le système actuel n'est pas acceptable et d'autres, qu'il est tout à fait réformable.» Les premiers souhaitent des changements de société, principalement économiques, note-t-il dans le livre.
Une grande divergence porte sur la confiance envers les autres. «Un groupe croit que ça va bien aller si l'on éduque les gens. Tandis que d'autres estiment que bien qu'on éduque la population, s'il n'y a pas de règles, ça ne va pas aller.»
Il y a enfin une ligne de fracture entre ceux qui souhaitent ou non une plus grande justice sociale dans la société de 2050. Contrairement à l'une des hypothèses de départ, les répondants ne croient pas que l'amélioration de la justice sociale ait un impact significatif sur la création d'une société plus respectueuse de l'environnement. «Pour eux, ce sont deux problèmes. Ils séparent la transition écologique et la société idéale de la justice sociale», indique l'auteur.
Comprendre le monde
Michel Pigeon a une longue feuille de route, lui qui a été directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur le béton, doyen de la Faculté des sciences et de génie, recteur de l'Université de 2002 à 2007 et député de Charlesbourg de 2008 à 2012. Qu'est-ce qui l'a fait bifurquer vers la sociologie? «Je suis devenu ingénieur parce que je voulais comprendre le monde. Je suis devenu sociologue parce que je voulais comprendre le monde social. Ça m'a toujours intrigué, le fonctionnement des sociétés», dit-il.
Si l'auteur s'est bien gardé de prendre position devant les étudiants qu'il a interrogés pour sa thèse, il pense qu'une transition vers une société plus respectueuse de l'environnement est inévitable. «La question est: on la gère comment, cette transition? Si on la gère en amont, on peut faire des choix, mais si on attend trop, les choix vont se faire pour nous. On va être coincés dans toutes sortes de problèmes. Le message à travers ça, c'est que notre mode de vie est responsable des problèmes actuels et qu'on ne s'en tirera pas sans changer notre mode de vie.»


























