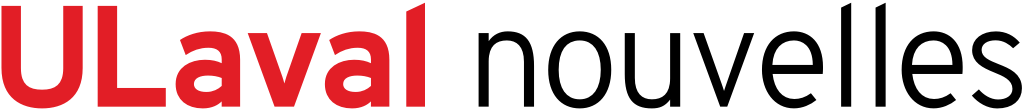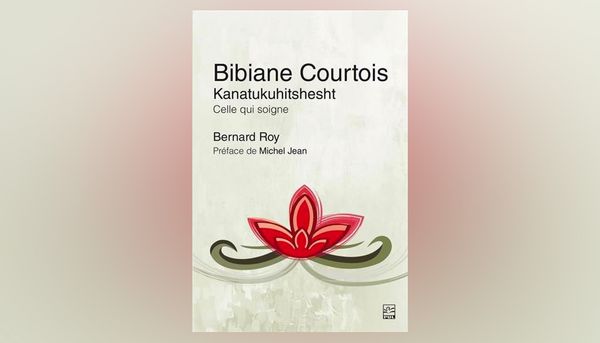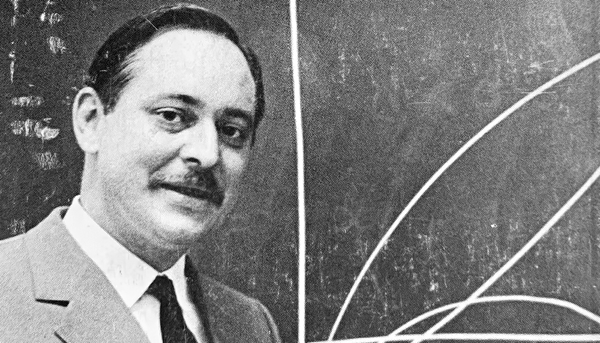Affiches provenant du Musée canadien de la guerre (à gauche) et des Imperial War Museums
— Arthur H. Hidier et Hely's Ltd.
C'était avant l'arrivée de tous ces moyens de communication que l'on connaît aujourd'hui. La production d'affiches a joué un rôle clé lors de la Première Guerre mondiale pour encourager les citoyens à s'enrôler dans l'armée et à fournir leur part d’effort pour la victoire.
Pour son mémoire de maîtrise en histoire, Aimée Dion a analysé 183 affiches de guerre destinées aux Canadiens français et aux Irlandais. Issues de divers fonds d'archives, ces affiches offrent une foule d'informations sur le contexte sociopolitique de l'époque.
Plus particulièrement, l'étudiante s'est intéressée à l'évolution du nationalisme dans ces deux pays liés à l'Empire britannique. «Lorsqu'il est question de culture politique, les historiens se basent souvent sur des sources écrites comme les archives journalistiques ou les débats parlementaires. Ayant un grand intérêt pour l'histoire de l'art, j'ai voulu creuser des sources iconographiques pour voir de quelles façons l'évolution du nationalisme a eu des répercussions dans les représentations visuelles de la guerre», dit celle dont la recherche a été encadrée par le professeur Martin Pâquet, du Département des sciences historiques.
L'étude des affiches lui a permis de constater des similarités dans les campagnes de propagande canadienne-françaises et irlandaises lors des deux premières années du conflit, en 1914 et en 1915. «Les autorités utilisaient des marqueurs de l'héritage culturel, la mémoire collective, des mythes associés aux peuples canadiens-français et irlandais, qu'ils mettaient au service de la guerre. Les messages et les types d'arguments véhiculés par les affiches étaient semblables.»
— Aimée Dion
Avec la mort de plusieurs soldats et le retour au bercail de vétérans blessés, les créateurs d'affiches ont peu à peu délaissé les arguments idéologiques pour se concentrer sur des aspects plus pragmatiques. «Au Canada, on a beaucoup insisté sur l'importance du financement de la guerre et sur de petits moyens de contribuer à la victoire, par exemple en changeant ses habitudes de consommation. En Irlande, les autorités vantaient les conditions d'enrôlement tels que les salaires et les pensions versées aux familles.»
Le vent tourne en 1916
En Irlande, l'insurrection de Pâques (Easter Rising) bouleverse la scène politique. Alors que des centaines de milliers d'Irlandais se battent aux côtés des Britanniques contre l'Allemagne, un groupe de nationalistes déclenche à Dublin une révolte contre les autorités impériales. Réprimée dans le sang, cette insurrection deviendra, pour le pays, un symbole de sa lutte pour l'indépendance.
«Avec le Easter Rising, il y a eu une explosion d'affiches contestataires qui allaient à l'encontre des objectifs de l'Empire. Les affiches officielles, quant à elles, ont subi un déclin dans leur production. On voit que le nationalisme républicain a pris beaucoup plus de place sur la scène politique à partir de ce moment», explique Aimée Dion.

Cette affiche témoigne de la guerre d'influence entre autorités impériales et groupes contestataires républicains en Irlande. Il s'agit de la Proclamation de la république irlandaise de 1916. Cette affiche, plaquée sur les murs du Bureau de poste général de Dublin, avait été collée sur des affiches de recrutement de l'armée britannique.
— Trinity College Library Digital Collections, Irish Workers Co-operative Society Press, 1916.
Au Canada, la situation est différente: «La référence au nationalisme canadien-français disparait. À partir de 1916, les affiches francophones sont identiques à celles destinées aux Canadiens anglais; on y retrouve la même iconographie, les mêmes thèmes, les mêmes messages. Malgré certaines différences dans la traduction, on constate un effort de créer une culture de guerre unique et bilingue qui s'étend à l'ensemble du Canada.»
Dès lors, les affiches misent sur le nationalisme autonomiste canadien. Exit les références à l'Empire britannique ou à la France. L'objectif: mobiliser les citoyens autour d'une guerre pour le Dominion du Canada. «Ces affiches véhiculent des objectifs de guerre plus consensuels pour les Canadiens français, ce qui permet d'éviter que la crise de la conscription ne dégénère en révolte généralisée devant des tensions ethniques recrudescentes», écrit Aimée Dion dans son mémoire.
Si la suite de l'histoire a été beaucoup plus violente en Irlande, il n'empêche que les deux peuples ont des similarités en matière de nationalisme. «D'un côté comme de l'autre, il y a eu un refus de la conscription, ce qui a donné lieu notamment aux émeutes de Québec de 1918, un événement qui est resté dans la mémoire collective. En Irlande, la crise de conscription a allumé la mèche de la guerre d'indépendance. Des événements similaires ont eu des résultats très différents à cause d'un passé historique très différent.»
Les images, précieuses alliées des historiens
Maintenant inscrite au doctorat, Aimée Dion poursuit son analyse des affiches de guerre. Cette fois, elle élargit son corpus, pour y inclure des affiches d'autres provenances, ainsi que son angle d'approche. «Je veux étudier la représentation de la guerre en général et voir comment les idées, les valeurs et les normes de la société sont véhiculées par les affiches pour mobiliser les citoyens. Je dépasse l'angle du nationalisme pour aborder notamment les rôles de genre en temps de guerre, le culte du sacrifice et le devoir martial.»
Avec ses recherches, elle espère démontrer la richesse des images d'archives, une ressource parfois boudée par les historiens. «On peut tirer beaucoup d'informations à partir de sources iconographiques. Dans mon cas, les images offrent une richesse importante et intéressante à étudier. Il s'agit d'une avenue très prometteuse, surtout pour une approche comparée», conclut la chercheuse.